Bzz, Bzz ! L’abeille, C’est LA grande cause nationale de l’année 2022 ! Si si, je vous jure. L’abeille était sur les devants de la scène mais vous n’étiez certainement pas au courant… Les derniers rapports de l’IPBES sur la biodiversité (par pitié, dites-moi que vous avez au moins déjà entendu parler de cet acronyme) sont sans grande surprise toujours plus terrifiants, donnant à voir une diminution massive de l’abondance du vivant et des écosystèmes terrestres et marins. Les invertébrés, largement moins suivis que les vertébrés, sont les grands perdants de l’affaire – peu de gens semblant vraiment y porter attention. On retrouve néanmoins parmi eux quelques espèces d’abeille qui, par leur intérêt pour la production apicole et leur sex-appeal social, bénéficient d’un traitement de faveur.
Le déploiement des outils numériques en apiculture ne date pas d’hier mais force est de constater qu’à part des balances connectées et des capteurs de température, on ne trouve finalement pas grand-chose d’opérationnel sur le terrain. Vous pourriez donc être surpris de la sortie de ce dossier de blog tant ce constat semble lapidaire. Malgré tout, vous verrez qu’en creusant un peu le sujet, les dispositifs numériques sont finalement assez variés et offrent la promesse non seulement d’accompagner le suivi des ruchers et colonies pour la production apicole mais aussi d’apporter de la connaissance pour un suivi environnemental et une biosurveillance à large échelle. Promesse ou illusion ? Comme d’habitude, la réponse est complexe et loin d’être binaire. Je tenterai de vous apporter des clés de lecture assez variées.
Ce dossier sur l’apiculture est également l’occasion de valoriser toute la connaissance qui commence à être capitalisée sur l’annuaire des outils numériques pour l’agriculture (https://www.lesoutilsnumeriquesdesagriculteurs.com/). A l’heure où j’écris ce dossier, nous avons dépassé les 1500 outils numériques référencés ! En plus de servir la veille collaborative, cette plateforme est maintenant utilisée pour prendre du recul sur les outils numériques en place et de dégager des tendances.
Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.
Bonne lecture !

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee
Retrouvez-ici les principales infographies du dossier :
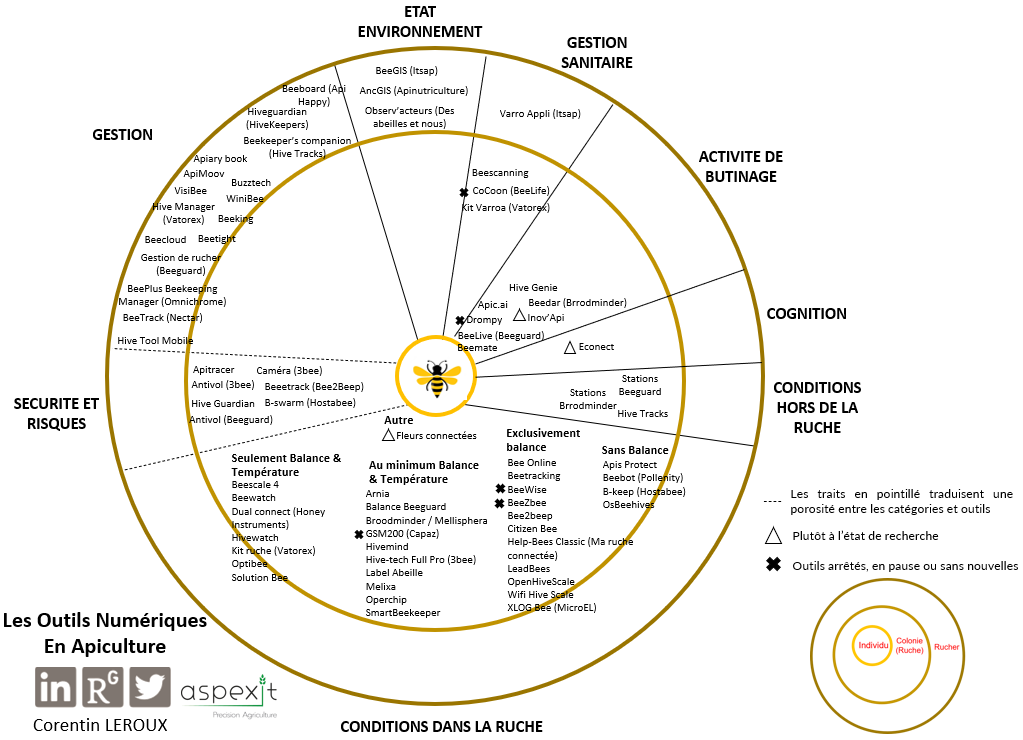
Infographie 1. Les outils numériques en apiculture. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020).
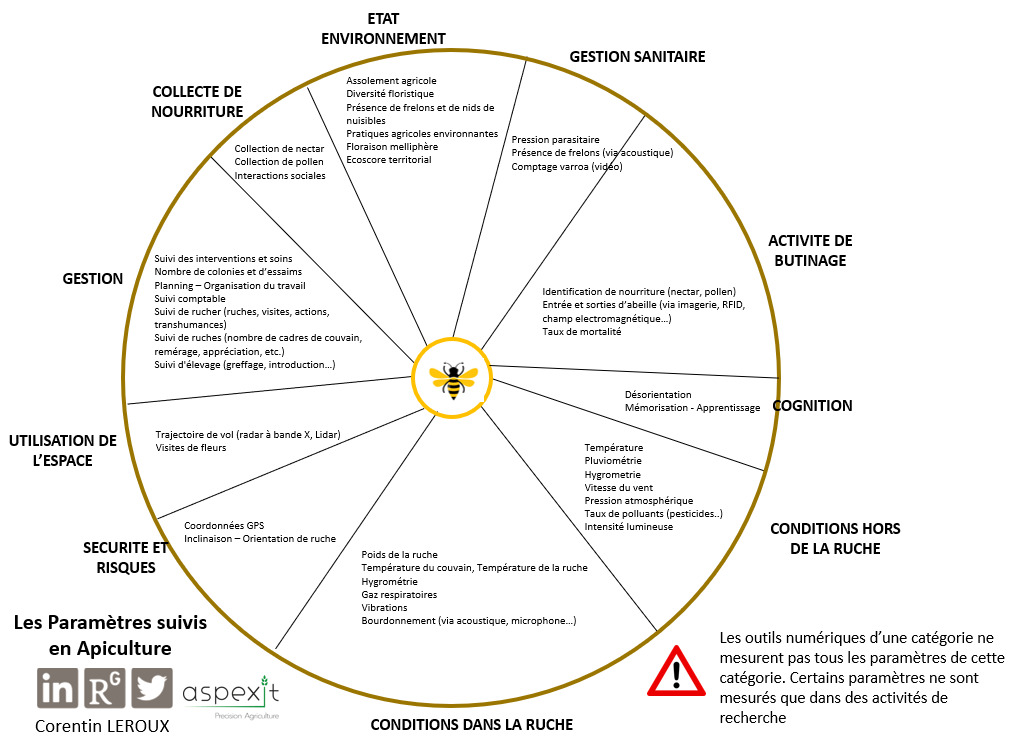
Infographie 2. Les paramètres suivis en apiculture avec les outils numériques. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020). Attention :Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche
Préambule important
Mes précédents dossiers se sont principalement concentrés, de près ou de loin, sur la filière végétale. Je me prête ici à l’exercice sur une filière animale, filière que je connaissais finalement très peu avant de commencer à travailler dessus. En rédigeant ce dossier, j’ai donc naturellement été foudroyé par le syndrome de l’imposteur, ce malaise classique qui vous pousse à questionner continuellement votre légitimité à ne serait-ce qu’oser donner votre avis sur un sujet que vous êtes loin de maitriser complètement malgré la quantité d’heures passées dessus. Je me positionne donc ici avec humilité et j’espère que mon entrée naïve sur cette filière et mon expérience sur l’écosystème numérique en agriculture de manière générale vous offrira des éléments de lecture pertinents. Ai-je donc le droit de demander un peu d’indulgence pour cette première tentative malgré les quelques piques que je n’aurais pas pu m’empêcher de lancer =) ? Difficile de me séparer de mon style d’écriture un peu cash. Haters gonna hate…
Je rajouterai que ce travail sur l’apiculture m’aura permis d’aborder des sujets d’ouverture orientés vers la bio-surveillance et l’environnement – thématiques que mes précédents dossiers de vulgarisation avaient plutôt tendance à relativement peu exploiter au profit du climat et de l’énergie. Les liens entre biodiversité et climat sont pourtant très étroits et notre propension à se tourner vers le climat semble nous faire oublier tout ou partie de ce qui arrive à la biodiversité. C’est d’autant plus grave que la quasi-totalité des actions de sauvegarde du vivant sont également bénéfiques pour le climat – la réciproque étant nettement moins vraie.
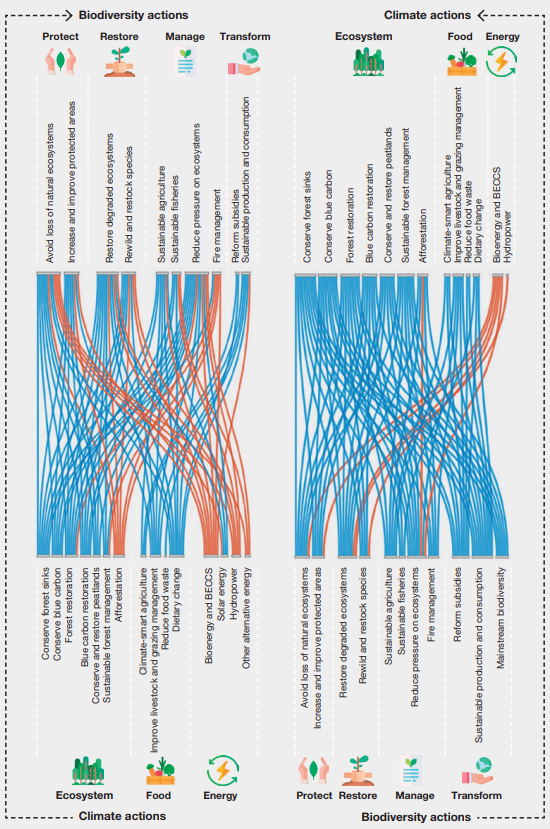
Figure 0 : Effets (positifs et négatifs) des actions visant à atténuer le changement d’atténuation du changement climatique sur les actions visant à atténuer la perte de biodiversité (en haut), et des actions visant à d’atténuation de la perte de biodiversité sur les actions d’atténuation du changement climatique (en bas) (IPBES-IPCC, 2021). Le graphique semble être un peu dur à lire mais en gros, si on part sur des actions en phase avec le sujet climat (en bas à gauche), ça conduit à du positif (bleu) et négatif (rouge) pour la biodiversité (en haut à gauche). Alors que si on commence à s’intéresser à des actions de sauvegarde du vivant (en bas à droite), on a quand même nettement moins d’actions négatives sur le climat (rouge).
Quelques ordres de grandeur de l’apiculture
Etat du marché apicole
Vous aviez déjà entendu parler d’apidologie ? Moi non, et c’est pourtant le nom donné à la branche d’étude qui concerne les abeilles ! On dormira tous moins bête ce soir … De chataigner, de luzerne, d’acacia, ou encore de tournesol, le miel sous toutes ses formes – liquide ou solide – n’aura pas fini d’enchanter nos papilles (Figure 1). Même si un vrai miel ne sera jamais vraiment composé à 100% d’une même fleur – certains apiculteurs vendront plutôt leur miel sous un nom un peu plus vague « miel de printemps », « toutes fleurs » – c’est aussi le mélange des végétaux butinés qui donnera son identité propre au miel. On pourra certes toujours faire de la recherche pollinique dans les miels pour en étudier la pureté (et les apiculteurs devront le faire pour certifier un miel espèce-spécifique), et certaines caractéristiques visuelles du miel (blancheur de la cire pour un miel de lavande, aspect très liquide du miel d’acacia…) permettront de lever certains voiles, il reste néanmoins assez difficile de suivre complètement la trajectoire de nos butineuses et de vérifier qu’elles ne s’intéresseront qu’à un type de fleurs en particulier (difficile donc de s’assurer qu’un miel soit vraiment complètement bio également). Est-ce qu’un peu de ronce et de trèfle dans un miel de chataigner a vraiment déjà fait du mal à quelqu’un ?
En France, le recensement de France Agrimer de 2020 fait état d’un peu plus de 70.000 apiculteurs déclarés (j’insiste bien ici sur le fait que ce sont ceux qui sont déclarés) pour un peu plus d’ 1.7 millions de ruches. La filière apicole est totalement différente des autres filières d’élevage pour une raison toute simple : plus de 90% des apiculteurs ont moins de 50 ruches (France Agrimer, 2022b). Ces apiculteurs sont ainsi considérés comme des amateurs dans le sens où il est difficilement envisageable de vivre de cette seule production artisanale avec « si peu » de ruches. Attention néanmoins aux contresens. Si la majorité des apiculteurs en nombre sont effectivement des amateurs, ce ne sont pas eux qui produisent la majorité du miel français mais bien les apiculteurs dits professionnels ou semi-professionnels (autour de 5000 professionnels pour un peu plus de 75% du volume total), c’est-à-dire ceux qui, à la grosse louche, ont au moins 150 à 200 ruches. Le chiffre d’affaires de la filière apicole avoisine les 100 millions d’euros (France Agrimer, 2022b), très loin derrière les autres filières animales. La production de miel est principalement conditionnée en pot, surtout par les amateurs, que les français achèteront de manière prioritaire en vente directe. Les professionnels quant à eux se tournent aussi vers une conservation en fût ou en cuves à miel pour éviter d’avoir des milliers de pots à remplir eux-mêmes…
Toujours en France, la production apicole aurait sensiblement baissé entre les années 90 et les années beaucoup plus récentes. L’année 2021, particulièrement défavorable en termes de conditions météorologiques, aura conduit à une production de près de 20 T de miel de consommation, bien au deçà des précédentes moyennes annuelles (globalement autour de 30-40 T dans les années 90). Qu’ils soient amateurs, professionnels, sédentaires ou itinérants, l’enjeu principal des apiculteurs reste le même : maintenir en vie les colonies d’abeille pour produire le miel tant convoité. La pression économique ne sera bien évidemment pas la même pour un apiculteur de loisir, potentiellement plus intéressé par un de ses passe-temps favoris et par le côté sublime du fonctionnement d’une ruche, que pour un apiculteur professionnel qui aura besoin de casser la croute… Les colonies d’abeille resteront pour ce dernier son outil de travail. Rajoutons à cela que la concurrence est rude, avec beaucoup de miel importé et des contrefaçons toujours plus originales : miels mélangés avec de l’eau, importations aléatoires, miels mixés avec des miels importé, miel coupé au sirop de glucose. L’étiquetage des miels UE (Union Européenne) et hors UE reste un sujet de crispation important.
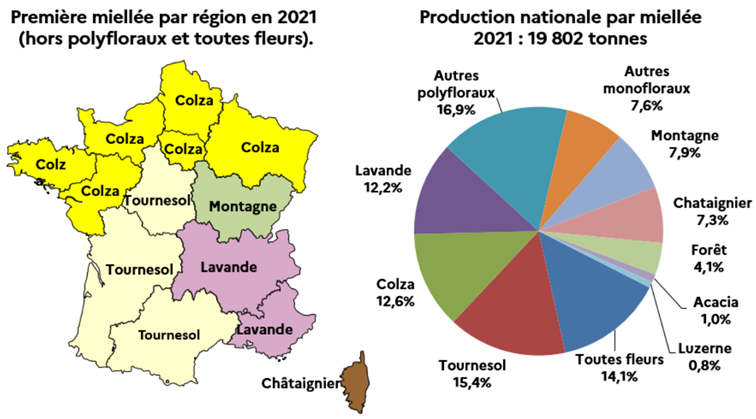
Figure 1. Production nationale française de miel en 2021. Source : France Agrimer (2022b).
Le miel, mais pas que…
En France, la très grande majorité du chiffre d’affaires des apiculteurs est liée à la production de miel (France Agrimer, 2022b). Le reste se répartit entre :
- L’élevage et la vente de reines, qui sont ensuite réintroduites dans les ruchers
- L’élevage et la vente d’essaims d’abeilles : même si la quantité d’abeilles semble rester relativement stable, elle cache en réalité un turnover assez effarant, nous aurons l’occasion d’en reparler
- La production de gelée royale comme complément alimentaire pour l’homme, qui demande à des apiculteurs spécialisés d’élever des ruches sans reine (la reine se nourrissant exclusivement de cette substance produite par les abeilles nourricières)
- La production de cire d’abeilles pour faire des bougies
- La production de pollen
- La production de propolis utilisée principalement en pharmacopée
- Les services de pollinisation lorsqu’un apiculteur met à disposition des ruches en système de location pour augmenter la présence de pollinisateurs sur des parcelles agricoles. Petit rappel de vos cours de biologie : La pollinisation est le transport du pollen depuis les anthères (la partie mâle de la fleur qui produit le pollen) jusqu’à la partie femelle, le stigmate. Ce pollen peut soit provenir de la même fleur ou d’une autre fleur de la même plante ou d’une autre plante (on parle alors de pollinisation croisée)
Ca en fait un paquet de services humains-centrés, me direz-vous… J’aimerais réinsister ici également sur les services de pollinisation qui, en France, sont finalement assez peu monétisés par rapport à d’autres pays du globe. On pense par exemple aux gigantesques champs d’amandiers des Etats-Unis dans lesquels certains apiculteurs arrivent avec des centaines de ruches pour appuyer la pollinisation. Pour certains détracteurs, les abeilles sont ainsi envoyées aux piloris, les champs d’amandiers étant assez largement traités avec des produits phytosanitaires.
Les « services de pollinisation » – qu’ils soient monétisés ou non – posent des enjeux forts en termes de sécurité et gouvernance alimentaire. Ce ne seraient pas moins de 75% des principales catégories de cultures vivrières mondiales et près de 90% des plantes sauvages à fleurs qui dépendraient, au moins en partie, de la pollinisation par les animaux – les pollinisateurs sauvages jouant également un rôle absolument fondamental (Figure 2). Plus particulièrement, la pollinisation par les insectes est nécessaire à la fécondation d’une majorité d’espèces de plantes à fleurs que nous cultivons pour leur graine (colza, tournesol, sarrasin), leur fruit (pomme, poire, kiwi, melon), leur racine ou leur bulbe (carotte, radis, oignon), ou encore leur feuillage (chou, salade). Et le volume de la production de cultures dépendantes des pollinisateurs ne ferait qu’augmenter, nous rendant toujours plus tributaires de ces services de pollinisation naturels. Ces chiffres sont bien évidemment à relativiser en fonction de la typologie de cultures et des économies agricoles régionales mais ils permettent de mettre le doigt sur les principaux ordres de grandeur.
Certaines études ont tendance à mettre en avant le fait que les cultures les plus dépendantes de la pollinisation par les insectes sont aussi celles qui ont la valeur économique la plus importante. Même si ce type d’études doit nous alerter, il reste néanmoins important de prendre un peu de recul et d’étudier les hypothèses de ces travaux-là. Les études ne prennent par exemple pas nécessairement en compte l’impact d’un déclin des pollinisateurs sur la production de semences, très important pour de nombreuses cultures fourragères, légumières et horticoles, ni les effets sur la flore sauvage. D’autres de ces études imaginent une disparition totale et non pas un déclin graduel des populations de pollinisateurs, et n’intègrent pas forcément les réponses stratégiques auxquelles nous répondrions (apiculteurs et société civile) pour faire face à cette disparition.
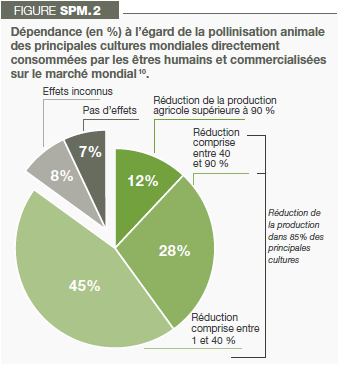
Figure 2. La dépendance des cultures mondiales à la pollinisation. Source : IPBES (2018).
Si l’on sort d’un prisme uniquement alimentaire, les pollinisateurs – tous autant qu’ils sont – servent aussi directement à la production de médicaments, de biocarburants (comme le colza et l’huile de palme), de fibres (le coton et le lin), de matériaux de construction (bois d’oeuvre), d’instruments de musique, ou encore d’objets d’art et d’artisanat. Ce sont ainsi également tout un tas d’arguments économiques et sociaux qui viennent se rajouter à l’équation puisque ce sont en réalité des millions d’emplois qui dépendant de près ou de loin, de ces services de pollinisation.
Tout cela étant dit, je vous laisser aller vous jeter sur la Fresque de la Biodiversité – un atelier collaboratif pour découvrir les enjeux de la biodiversité – histoire de vous octroyer une bonne dose d’humilité et de remise en question.
La vie des abeilles
Les pollinisateurs visitent les fleurs principalement pour collecter du nectar (la source de sucre) et/ou du pollen (la source de protéines, lipides, vitamines et éléments minéraux) ou s’en nourrir, même si quelques pollinisateurs spécialistes peuvent également collecter d’autres substances telles que des huiles, des fragrances et des résines produites par certaines fleurs (on parle par exemple de miellat comme liquide sirupeux fabriqué par les pucerons qui aspirent la sève des arbres). Dans les régions tempérées, les abeilles hivernent pendant l’hiver, commencent à produire au printemps et continuent pendant tout l’été, arrêtent la production et retournent à l’état d’hibernation en automne. Dans les régions chaudes et tropicales, les sources de pollen et de nectar peuvent être disponibles toute l’année et les abeilles n’hibernent donc pas.
Capables d’effectuer des recherches jusqu’à environ 3km de la ruche pendant la journée, nos abeilles melliphères aux poils branchus visite prioritairement une seule espèce végétale lors d’un voyage, ce qui améliore considérablement l’efficacité du transport du pollen.
Lorsqu’elles découvrent de nouveau lieux de nourriture, les abeilles ont cette capacité fascinante de communiquer à leurs camarades de ruches la distance et la direction de leur butin avec des oscillations abdominales et des vibrations, à la fois par un système de « danse » en rond ou en huit dans la ruche mais aussi en navigation en vol. Cette communication n’est néanmoins pas d’une précision redoutable et les abeilles utilisent leur odorat une fois se place pour aider à se diriger. Les abeilles auraient ainsi un odorat extrêmement développé et sensible à tout un tas de signaux chimiques. Les abeilles sont d’ailleurs mises à profit soit en laboratoire sur des tables d’essais, soit sur le terrain en tant que biocapteurs traçables en vol libre (par exemple pour le suivi de polluants métalliques ou chimiques sur des zones étendues et/ou dans des mines terrestres, ou pour le suivi de cadavres ou des signaux chimiques produits par des plantes et des animaux malades). Certains auraient même utiliser les abeilles comme détecteur de Covid, on arrête plus le progrès… D’autres se serviraient des abeilles pour faire du biocontrôle, en utilisant les abeilles domestiques et les bourdons pour transporter ou vectoriser des produits microbiens de biocontrôle
Ames sensibles, s’abstenir ! Les abeilles butineuses stockent le nectar dans leur jabot, à l’extrémité de l’œsophage, et le régurgitent dans le jabot des abeilles nourricières (on parle de trophallaxie) une fois retournées à la ruche qui, elles-mêmes, le régurgiteront dans les alvéoles dédiées dans la ruche pour le stocker (le nectar n’est quasiment pas consommé par les butineuses). Le nectar, en passant de bouche en bouche si l’on puit dire, se transforme en miel grâce aux enzymes présentes dans le jabot des abeilles. Les courants d’air dans la ruche aident à déshydrater le miel et des dernières abeilles ferment les alvéoles de miel avec des opercules de cire une fois que le miel est au bon degré d’hygrométrie.
L’abeille n’a aucune notion de stock de miel. La colonie continuera à stocker tant qu’il restera de la place dans la ruche. C’est donc pour cela que les apiculteurs installent des hausses (les cadres) pour récupérer le surplus de miel dont les abeilles n’auront pas besoin pour tenir l’hiver (encore faut-il que les apiculteurs leur laissent suffisamment de nourriture de base et qu’ils ne leur piquent pas la totalité de leur collecte…) [Figure 3]. Le pollen est quant à lui transporté à la ruche via de petits sacs sur les pattes postérieures des abeilles – une abeille butineuse étant capable de transporter la moitié de son poids en pollen.
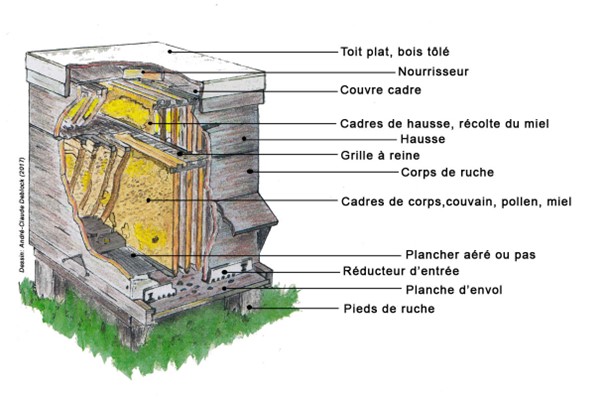
Figure 3. Schéma d’une ruche Dadant.
Dans le rucher, les alvéoles sont séparées en deux grandes catégories qui n’ont d’ailleurs pas le même couleur : celles qui accueillent le nectar (et donc le futur miel – il y a aussi des alvéoles à pollen), nous en avons déjà parlé au-dessus – et celles qui accueilleront les futures abeilles (femelles) et faux-bourdons (mâles) de la colonie (on parle ici de cellules à couvain). La reine des abeilles, nourrie depuis sa naissance à la gelée royale est finement choisie parmi les larves de la colonie par les ouvrières. Après son vol nuptial où elle sera fécondée par les faux-bourdons de la colonie (qui ne serviront d’ailleurs à pas grand-chose d’autre), la reine revient dans la ruche pour pondre des milliers d’œufs par jour et empêche ces mêmes ouvrières de pondre de leur côté à partir des sécrétions qu’elle émet (les spermatozoïdes restent féconds pendant plusieurs années dans la reine). Comme nous l’avons dit plus haut, gardez en tête que certains apiculteurs élèvent des reines sélectionnées pour les introduire dans les colonies. Les larves, nourries au miel et au pollen, deviennent, 21 jours plus tard, des futures abeilles ouvrières ou des faux-bourdons. Le rôle des abeilles dans la ruche, en tant qu’ouvrière, nourricière ou butineuse est défini au fur et à mesure du temps.
Pour élever le couvain, les abeilles thermo-régulent la température de la ruche de manière extrêmement fine (je reviendrai dessus en abordant la question des outils numériques). L’environnement proche de la reine est maintenu à une température de près de 30° quand les abeilles en périphérie peuvent être à plus d’une dizaine de degrés de différence. Les poils des abeilles sont comparables à des duvets d’oie. Ils ont certes un rôle pour la collecte de nourriture mais aussi beaucoup pour retenir la température à un niveau acceptable quand il fait froid. L’abeille domestique possède la capacité d’hiverner dans son nid grâce à la survie d’une partie des ouvrières adultes (la grappe) qui vont maintenir des températures positives par la production de chaleur endothermique, et permettent ainsi la survie de la reine.
En fonction des conditions de santé de la colonie et/ou de la vieillesse de la reine, la colonie d’abeille est susceptible d’essaimer, c’est-à-dire de s’en aller de la ruche actuelle pour aller trouver un nouveau lieu de vie. Cet essaimage est certainement une des craintes les plus fortes pour les apiculteurs qui verront alors leur ruche se vider allégrement. Si la reine est trop vieille, les ouvrières l’empêchent de pondre et la poussent à partir avec ses fidèles courtisanes. Les abeilles choisissent alors un nouveau lieu de vie (et peuvent même aller jusqu’à mourir si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le lieu), aèrent le lieu et secrètent des odeurs pour que leurs congénères se repèrent. Les abeilles sont même capables de mesurer la taille et la profondeur du lieu envisagé en formant une longue chaine main dans la main (ou patte dans la patte – je ne sais pas si ça se dit vraiment).
Quelques ordres de grandeur à garder en tête :
- Les abeilles peuvent effectuer des vols jusqu’à 3 km de distance de la ruche (parfois même un peu plus)
- Les ruches contiennent entre 30 et 40.000 abeilles. Dans les colonies sauvages, le chiffre peut être bien plus élevé
- La production d’1L de miel demandera aux abeilles de récolter du nectar sur environ 10 millions de fleurs ce qui, pour les butineuses, représente un total de 10.000 heures de vol et 60.000 km de distance.
- La production d’1kg de cire nécessitera la consommation de 7kg de miel par les abeilles
- Une ruche peut contenir plusieurs milliers d’abeille et les butineuses sortent en moyenne 4 fois par jour pour aller polliniser une cinquantaine de fleurs différentes.
- Seule une petite partie de la totalité des fleurs est pollinisée
L’abeille est loin d’être la seule pollinisatrice !
L’élevage apicole reste quand même concentré sur quelques espèces d’abeilles spécifiques, notamment la bien connue Apis Mellifera (l’abeille à miel occidentale), ou encore l’Apis Cerana (l’abeille à miel orientale). On retrouve dans une beaucoup moins grande mesure certains bourdons, certaines abeilles sans aiguillon et quelques abeilles solitaires
L’abeille à miel occidentale – Apis Mellifera – représente en réalité une infime partie des espèces de pollinisateurs ; il faut bien se rentrer ça dans le crâne ! La grande majorité des espèces pollinisatrices sont sauvages (Figure 4). On y retrouve notamment plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde (et autour de 2000 en Europe), certaines espèces de mouches (les syrphes par exemple), des papillons de jour et de nuit, des guêpes, des scarabées, des thrips, des oiseaux, des chauves-souris, des lézards, j’en passe et des meilleures. On pourrait jouer au jeu des 7 familles (ou d’espèces) pour les insectes : diptères, hyménoptères, lépidoptère, coléoptères … Alors, on met quoi dedans ?
Ne croyez pas non plus que tous ces pollinisateurs sont des espèces vivant en groupes. Certaines espèces sont au contraire très solitaires – notamment pour les abeilles sauvages. Toutes ces espèces, sauvages et domestiquées, interagissent entre elles. On parlera également d’espèces de pollinisateurs spécialistes (celles qui visitent un nombre assez faible d’espèces de plantes à fleurs) et de généralistes (celles qui, au contraire, visitent de nombreuses espèces). Le corolaire est le même pour les plantes – les plantes spécialistes n’étant pollinisées que par un nombre assez restreint d’espèces, alors que les plantes généralistes (certainement beaucoup plus open-minded) sont pollinisées par de nombreuses espèces. Certaines fleurs vont par exemple avoir une pollinisation unique à cause de la taille des insectes (certains pollinisateurs sont petits, d’autres ont un trop gros rostre…). Notre chère Apis Mellifera est donc loin d’être la seule à laquelle nous devons nous préoccuper – toutes les autres espèces étant impactées par des problématiques similaires (néonicotinoïdes, changement climatique…). Nous en reparlerons plus loin.

Figure 4. Cartographie simplifiée de quelques pollinisateurs dans le Monde. Source : IPBES (2018).
Le numérique en apiculture
Théoriquement, chaque activité des abeilles (y compris le vol, la défense, le nettoyage et l’élevage du couvain) nécessite une énergie spécifique qui est transférée :
- en chaleur (entraînant des changements de température, d’humidité et de teneur en gaz),
- en son (qui peut être détecté par des capteurs de son et de vibration)
- et en d’autres activités mesurables.
Si l’on rajoute à cela toutes les choses qui peuvent inquiéter l’apiculteur (l’essaimage, la disponibilité en eau et en nourriture, l’absence de reine, l’absence de couvain, la mort de la colonie, la famine et le premier vol de nettoyage au printemps ; les maladies et pressions parasitaires…), on peut dès lors difficilement s’étonner du développement d’une pléthore d’outils numériques pour chercher à mesurer tout un tas de paramètres de façon directe ou indirecte. J’insiste sur le fait que nous n’avons pas attendu les outils numériques pour faire du suivi d’abeilles ! Transects, Observations florales, Pièges, Science citoyenne (Crowdsourcing en anglais)…. Ce dossier de blog est bien évidemment orienté et nous évoquons ici plutôt des approches utilisant de près ou de loin des dispositifs numériques.
On pourrait imaginer plein de façons d’organiser la présentation des outils numériques en apiculture, et on en trouve d’ailleurs pas mal dans la littérature. Certains travaux ne s’intéressent qu’aux capteurs – c’est vrai qu’il y en a pas mal de différents mais il est dommage de se limiter seulement à ça – et proposent par exemple de les différencier en quatre catégories principales : (1) le poids ; (2) la température, l’humidité et les gaz ; (3) les sons et les vibrations ; et (4) le trafic des butineuses. D’autres préféreront travailler à différentes échelles en catégorisant par exemple les outils numériques en fonction d’un suivi au niveau d’une abeille individuelle, d’une colonie d’abeille dans une ruche, ou même d’un rucher complet composé de plusieurs ruches. D’autres auront préféré une approche plus fonctionnelle, en catégorisant les outils en fonction de ce qu’ils permettaient de suivre d’un point de vue agro-environnement. Je vous propose dans cette section deux grandes infographies qui mixent un peu toutes ces approches :
- Une première sur les outils numériques existants en apiculture (Figure 5)
- Une deuxième sur les paramètres suivis en apiculture avec ces outils (Figure 6)
J’insiste ici sur le fait que la deuxième infographie est plus à visée théorique et informationnelle. Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche. Ne faites donc pas un lien direct entre les deux infographies…
Ces infographies sont amenées à évoluer et à être mises à jour.
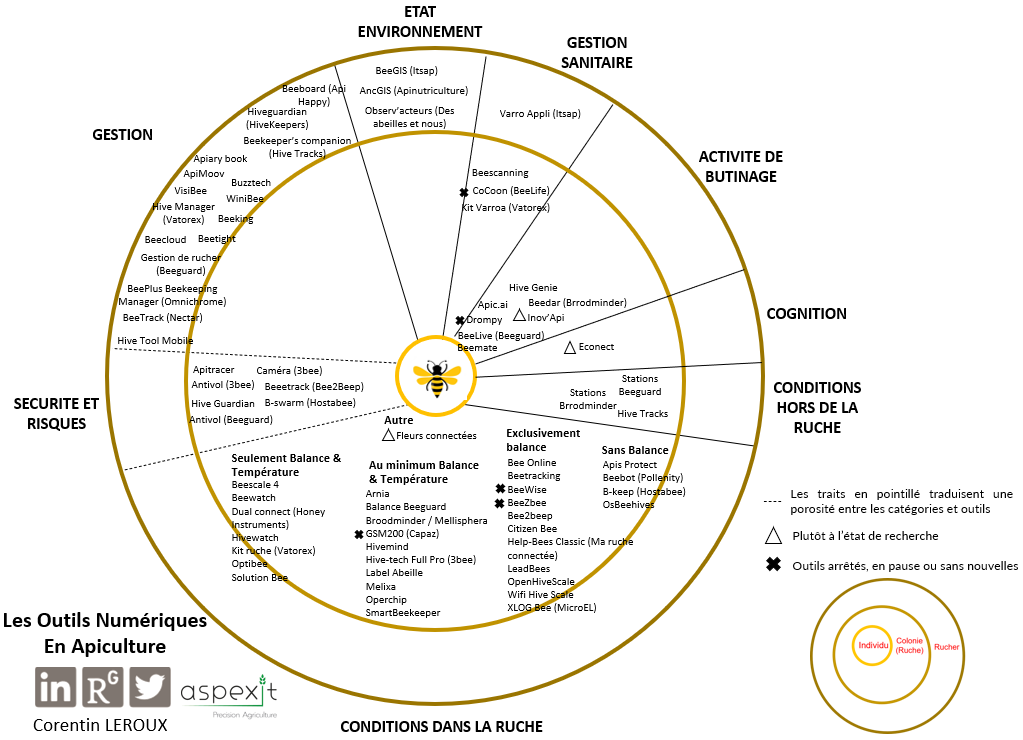
Figure 5. Les outils numériques en apiculture. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020).
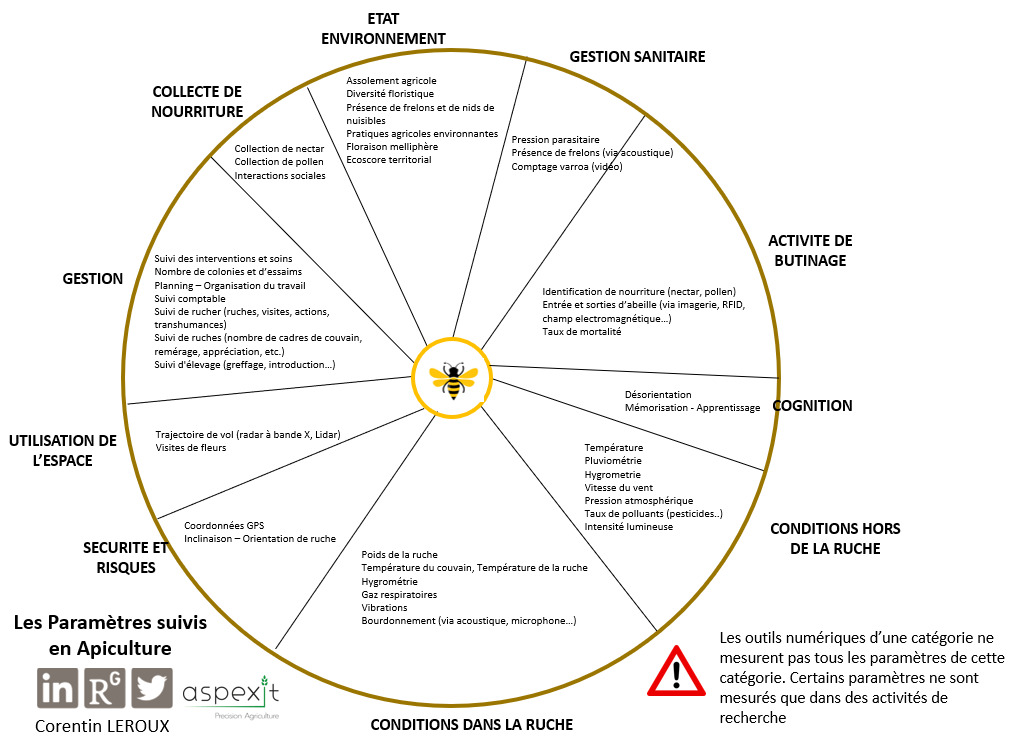
Figure 6. Les paramètres suivis en apiculture avec les outils numériques. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020). Attention :Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche
Les conditions dans la ruche – entre poids et température
Les balances connectées – c’est relativement parlant. On les imagine assez bien placées sous les ruches pour suivre l’évolution du poids de la ruche au fur et à mesure du temps. Et certaines ont d’ailleurs des formes assez originales (Figure 7). C’est bien ici la mesure relative du poids qui nous intéresse – le poids instantané d’une ruche n’ayant finalement que peu d’intérêt. Les augmentations de poids de la ruche peuvent renseigner sur tout un tas de paramètres directs ou indirects : l’occurrence du flux de nectar pendant la saison de butinage (début et fin du flux de nectar) ou le gain quotidien des réserves de nectar, la consommation de nourriture pendant les périodes sans butinage, l’occurrence d’événements d’essaimage par une diminution du poids de la ruche, ou encore l’estimation du nombre de butineuses (je vous laisse aller lire les paragraphes autour des compteurs d’abeilles). L’idée étant derrière de tenter d’imaginer un lien avec l’état de la colonie ou un stress environnant (pesticides, disponibilité du nectar et du pollen aux alentours…)
Le suivi de la courbe de poids n’est pas si évident que ça. Le poids d’une ruche habitée, c’est déjà la somme de tout un tas de chose : le poids de la boîte, le poids des rayons contenant les réserves de nourriture et le poids des abeilles qui vivent dedans (je vous rappelle qu’il y en a un sacré paquet). Les séries temporelles de poids de ruches sont très fluctuantes, et ce même au sein de la journée, et c’est d’ailleurs pourquoi leur analyse n’est pas complètement triviale – nous en reparlerons plus loin. Les courbes de poids peuvent effectivement être perturbées par la perte d’eau suite au séchage du nectar, la respiration pendant la nuit, le départ des butineuses tôt le matin, ou encore la pluie accumulée sur le toit de la ruche.
L’état des colonies d’abeilles peut être aussi approché par des suivis de température à l’intérieur de la ruche parce que les abeilles la régulent de façon assez impressionnante. Cette capacité de la colonie à réguler sa température est dépendante de tout un tas de choses dont notamment la sous-espèce d’abeilles ou encore la diversité génétique au sein de la colonie. Les abeilles augmentent la température en se regroupant et en contractant leurs muscles, ou au contraire abaissent la température en se dispersant et en évaporant de l’eau via leur battement d’ailes. Tout cela jouant incidemment aussi sur l’humidité de la ruche. Le suivi de l’hygrométrie dans les ruches n’aurait visiblement pas encore trop permis de faire d’applications très concrètes.
La complexité du suivi de la température réside dans les gradients de température au sein de la ruche qui imposent une attention toute délicate à la localisation des capteurs de température pour ne pas se tromper de gamme de valeurs. Le couvain – là où sont bichonnées les larves – est dit sténotherme parce que sa survie et son développement dépendent du maintien de la température dans une gamme réduite (33 à 36°C), alors que les adultes peuvent supporter des variations de températures élevées (on parle alors d’adultes eurythermes). Les capteurs dans la grappe d’abeilles (plutôt bien à l’intérieur de la ruche) seront moins affectés par les conditions de température extérieures à la ruche que les capteurs proches de la sortie de la ruche. En s’éloignant du couvain, la température et l’humidité relative vont être plus influencées par les conditions atmosphériques et seront moins représentatives de l’intégrité des fonctions d’homéostasie de la colonie. Une sonde de température proche du couvain traduira ainsi plutôt une activité de ponte de la reine et une population d’ouvrières en capacité de maintenir l’homéostasie thermique alors que des sondes plus loin du couvain, aux extrémités de la ruche par exemple, serviront plutôt à évaluer l’augmentation de la taille de la population en ce sens que la ponte de la reine aura atteint, au fur à et mesure, ces zones périphériques.
Les abeilles se déplacent et modifient la taille de la grappe au cours de l’année et la réduisent ou l’éliminent en hiver lorsque les gradients de température sont par exemples plus intenses entre l’extérieur et l’intérieur de la ruche, ou entre le haut et le bas de la ruche. Outre les capteurs de température, d’autres travaux auront par exemple proposé d’utiliser l’infrarouge pour examiner les profils thermiques des nids de couvain et des abeilles chauffeuses (ou pour étudier le mouvement des abeilles à l’intérieur des ruches pendant la période d’hivernage).
Certains capteurs ont été également développés pour le suivi de la teneur en gaz respiratoires dans la ruche. Les abeilles maintiendraient des faibles niveaux d’oxygène dans la ruche pour abaisser leur activité métabolique et ainsi conserver leur énergie pendant plus longtemps. Les capteurs de gaz dans la ruche doivent être vérifiés assez régulièrement parce que les abeilles ont la manie de recouvrir tous les objets étrangers avec de la propolis ou de la cire, ce qui interfère avec le mouvement de l’air à travers le capteur.
Les dynamiques de la colonie
On commence également à voir s’opérationnaliser des compteurs d’abeilles pour mesurer les flux d’entrée et de sortie des butineuses au cours de la journée. Vous pourriez rétorquer qu’un observateur avec un bon vieux chronomètre pourraient suffir certes (cet observateur pourrait regarder la vitalité des abeilles sur la planche d’envol, la vitesse d’entrée/sortie des abeilles, et le nombre de butineuses…) mais l’activité des abeilles sur une planche d’envol ressemble plus au métro parisien qu’à une douce balade au bord d’une plage en hiver. Ces compteurs ne datent pas d’hier mais les utilisations restaient encore principalement cantonnées au monde académique au vu de la complexité de la mesure : plusieurs dizaines de milliers de butineuses d’abeilles transitent dans une ruche sur une journée (et les trains d’abeilles au sein des canaux complexifient l’identification de chaque individu). On peut rajouter que certaines abeilles ne font que des vols de propreté (et ne vont donc pas chercher de nourriture) mais les mesures issues des compteurs permettent au moins de dégager des tendances.
La reconnaissance des abeilles est ainsi faite sur la planche d’envol de la ruche (Figure 3) avec deux velléités particulières. Soit celle de suivre la colonie dans son ensemble – on utilisera alors plutôt des caméras classiques à différentes résolution et possiblement un éclairage complémentaire ou alors des compteurs avec des émetteurs et récepteurs infrarouges dont les faisceaux sont bloqués par la présence d’abeilles. Soit celle de suivre chaque abeille individuellement (une butineuse, une ouvrière, la reine…) ou plutôt une petite cohorte d’abeilles. Pour ce suivi assez fin, on retrouve par exemple des dispositifs assez classiques comme des puces RFID (ou des codes-barres sur du papier plastifié) placées sur le thorax des abeilles et qui sont lues par des lecteurs dans la ruche. On peut trouver aussi des pastilles métalliques, elles aussi installées sur le thorax de nos petits hyménoptères. Ces pastilles seront détectées grâce à un champ électromagnétique créé par un capteur inductif installé dans la ruche. Les abeilles marquées par une puce ou pastilles sont marquées manuellement et une par une – vous imaginez donc bien qu’on ne peut pas en suivre une quantité infinie non plus.
Et les applications de ces compteurs semblent multiples :
- Suivi du taux de mortalité dans la colonie et détection de la temporalité d’effondrement de la colonie. Quand la nuit tombe, les abeilles ne sortent plus, et il est alors possible de faire la différence entre le nombre d’abeilles en début et en fin de journée
- Compréhension de la réaction des abeilles à tout un tas de stress extérieurs. Le profil classique d’entrée/sortie d’abeilles s’apparenterait à un trapèze avec un flux d’entrée/sortie qui augmente (plus de sortie que d’entrée), se stabilise, puis diminue (plus d’entrée que de sorties). En période de canicule, des pics importants de sortie d’abeilles apparaissent le matin. Les abeilles ventilent plus la ruche pour sauver le couvain et les conditions ne sont pas bonnes pour la nectarification lorsque les fleurs sont séchées. Dès qu’il fait moins chaud, les abeilles ressortent en priorité chercher de l’eau.
- Le suivi individuel d’abeilles est aussi en cours pour continuer à évaluer l’effet des néonicotinoides sur la cognition des abeilles (nous en reparlerons plus loin). Les abeilles, équipées de puces RFID, peuvent être soumises à des doses sub-léthales de néonicotinoides de manière à pouvoir étudier leur comportement et juger de la dangerosité des pesticides avant leur mise en marché.
- Evaluation de la dynamique de la colonie ou des abeilles à l’intérieur même de la ruche : on peut imaginer par exemple suivre le comportement de la reine au cadre près dans la ruche et son interaction avec les abeilles environnantes.
De manière générale, le fait de marquer les abeilles offre tout un tas d’application potentielles dont nous reparlerons au cours du dossier : visualiser et analyser les schémas de mouvement des abeilles en vol libre, décrypter la danse et l’agitation des abeilles, explorer l’état de la ruche (taille de la population, santé, dynamique), utiliser des capacités sensorielles chimiques des abeilles contraintes et en vol libre, évaluer l’acceptation d’une nouvelle reine ou l’échec de la reine, suivre la santé des colonies pendant l’hiver. Les possibilités paraissent infinies.
Le son joue un rôle crucial dans la vie des abeilles. Les abeilles transmettent de tels signaux grâce à la vibration de leur thorax et des muscles de leurs ailes, et au mouvement de leurs ailes. Le son est transmis par l’air et les vibrations se propagent à travers les rayons de cire ou par contact entre deux individus. Les sons produits par les colonies d’abeilles seraient non seulement modifiés lorsque les abeilles sont exposées à différents facteurs de stress, et même potentiellement discriminants en fonction d’un type de produit chimique, de parasite ou de maladie. Les apiculteurs l’ont d’ailleurs bien compris. Ils écoutent leurs ruches et certains sons ne leur sont plus du tout inconnus (pour l’essaimage par exemple) et les abeilles n’émettent pas les mêmes fréquences le matin que l’après-midi
En soi, la mesure du son n’est pas une tâche compliquée, mais l’emplacement du capteur et l’influence des bruits de l’environnement autres que ceux des abeilles doivent être analysés. Il est également important de déterminer la fréquence correcte à laquelle la surveillance sonore des colonies d’abeilles peut être effectuée. Les vibrations et les sons sont difficiles à suivre parce qu’on peut les analyser à la fois sous un angle temporel (le suivi dans le temps) mais aussi sous un angle de fréquence et d’amplitude. Les abeilles possèdent des récepteurs spécialisés dans leurs pattes pour recevoir des signaux à basse fréquence. Mais visiblement, c’est un très large spectre de fréquence de vibrations que les abeilles seraient capables de générer – et nous ne savons finalement qu’assez peu de la gamme réellement utilisée pour communiquer. De là à prédire un essaimage quelques jours, voire quelques semaines avant sa réalisation (et ainsi récupérer l’essaim ou empêcher l’essaimage) nous n’y sommes pas complètement encore…
On retrouvera donc ici des capteurs sonores pour le suivi des bourdonnements et des fréquences dans les ruches. Certains chercheurs ont proposé des dispositifs de vibrométrie laser en focalisant un laser sur la paroi d’une cellule de rayon à côté d’abeilles avec des comportements particuliers. La connaissance fine des fréquences de vibration pourrait même permettre aux chercheurs d’imposer des fréquences et de voir comment les abeilles réagissent et ainsi détecter un état particulier de la colonie.

Figure 7. Exemples de dispositifs numériques en apiculture : balances numériques, antivol, capteurs de température, compteurs d’abeilles.
L’utilisation de l’espace par les abeilles
Les entrées et sorties d’abeilles nous renseignent sur un flux mais ne nous apprennent finalement pas tant de chose sur ce que font les abeilles à l’extérieur de la ruche. Certains chercheurs ont ainsi proposé de suivre les abeilles avec des radar à bande X, en utilisant toujours le même système de puces électroniques placées sur le thorax des abeilles. Le radar resterait quand même plutôt adapté aux grandes masses d’insectes, mais il peut détecter les petits insectes à courte distance et les grands insectes à longue distance. D’autres utiliseront des systèmes Lidar pour étudier des trajectoires de vol et les zones de rassemblement.
La gestion des pressions
Les abeilles sont soumises à des pressions virulentes. Parmi elles, on retrouve principalement certaines espèces de frelons qui viennent littéralement dévorer les abeilles en sortie de ruche et d’autres, comme le varroa, qui viendront s’immiscer dans les ruches et s’accrocher aux abeilles. Des projets de recherche sont en cours autour de microphones et capteurs de sons pour détecter des fréquences de vibrations caractéristiques des frelons. Certains iraient visiblement même jusqu’à développer des systèmes laser qui, appuyés par un système d’analyse d’images, viendraient ôter la vie aux frelons avec un faisceau à haute intensité et courte distance.
Pour revenir aux compteurs d’abeilles utilisant des systèmes vidéos présentés un peu plus haut, les applications peuvent être déclinées aussi au comptage de pressions parasitaires – notamment le varroa accroché sur les abeilles (les autres pressions parasitaires sont plutôt visibles au niveau de la colonie dans son ensemble : frelon asiatique, petit coléoptère des ruches, loque, fausse teigne). Des systèmes de miroirs, pour à la fois détecter la présence d’un varroa sur la face ventrale de l’abeille, et pour éclairer dans des longueurs d’ondes spécifiques, peuvent être mis à profit. On trouve aussi sporadiquement des applications smartphones destinées à prendre des photos de cadres sortis des ruches par les apiculteurs (pour un comptage de varroa en post-traitement) mais ces applications ne semblent pas encore très efficaces. Autre proposition : placer un linge en plastique blanc sous la ruche et compter les varroas qui tombent ou ceux dont les abeilles se débarrassent. Le comptage fin et la discrimination des varroas et des abeilles tombant dans le linge ne semble pas complètement trivial…
L’état de l’environnement et Conditions environnementales extérieures
Les conditions environnementales sont sensiblement différentes entre l’intérieur et l’extérieur de la ruche – nous avons d’ailleurs parlé des gradients de température à l’intérieur même de la ruche. La connaissance des facteurs météorologiques à l’extérieur de la ruche est peut-être plus utile pour recontextualiser l’acquisition de données réalisées à l’intérieur de la ruche que pour avoir de l’information factuelle sur ce qui se passe à l’extérieur. On pense par exemple à la pluie et au vent qui peuvent impacter la qualité des données mesurées – par exemple la pluie qui augmenterait artificiellement le poids mesuré de la ruche, ou le vent qui pourrait jouer sur des gradients de température ou des teneurs en humidité dans la ruche. Rajoutons à cela qu’une forte pression atmosphérique rend les abeilles sensibles et qu’avoir cette information au préalable permettrait de ne pas trop aller les déranger à ce moment-là.
Les abeilles évoluent également dans un environnement où les ressources peuvent être limitées et ce manque de nourriture et d’eau est peut-être en réalité une des raisons principales de déclin des populations d’abeilles (nous en reparlerons plus bas). Des outils sont en place pour cartographier les zones melliphères d’intérêt pour les apiculteurs et/ou pour utiliser des bases de données ouvertes d’occupation du sol (comme le registre parcellaire graphique ou les informations des sites du museum d’histoire naturelle par exemple) pour savoir ce que les abeilles auront la chance de trouver ou non autour des ruches et pour avoir indirectement de l’information sur les pratiques agricoles attenantes. Ces outils servent également indirectement à réfléchir la stratégie de transhumance pour les apiculteurs. Des caméras, utilisées au départ pour compter des flux d’abeilles, pourraient aussi être utilisées pour quantifier la quantité de pollen ramenées par les butineuses à la ruche.
Certains proposent d’utiliser ces informations pour calculer des éco-scores sur des sites et des territoires en croisant de l’information sur des bases de données ouvertes et sur de la donnée géo-localisée près des ruches.
Les capteurs conçus pour détecter la présence ou la concentration de composés particuliers peuvent contribuer à la surveillance des maladies ou des contaminations.
La cognition des abeilles
Vous pensiez peut-être que les insectes étaient des animaux machine. Ils ont au contraire un système nerveux et un cerveau comme le nôtre et sont en capacité de réaliser tout un tas d’opérations mentales. Les abeilles peuvent en effet copier d’autres abeilles, analyser des stratégies et les améliorer, compter, et ressentir des émotions positives. Des chercheurs ont par exemple montré qu’une solution de saccharose administrée à des abeilles leur avait permis de répondre de façon positive à des indices ambigus mais aussi que les abeilles s’étaient remises plus rapidement à butiner après une attaque simulée de prédateur (Perry et al., 2016). Certains se posent même la question de leur potentiel état de conscience et repoussent les frontières de l’intelligence animale.
Le projet Econect souhaite proposer des jeux cognitifs à des abeilles (le projet n’est pas que centré sur les abeilles mais aussi sur les oiseaux, poissons ou encore gastéropodes…) prélevées dans l’environnement avec des dispositifs variés (lumière, eau sucrée…) pour affiner nos connaissances sur la mémorisation et l’état cognitif des abeilles. Il est maintenant relativement clair que les abeilles déclinent parce qu’elles sont soumises à des stress environnementaux. Les métriques comportementales et cognitives sont intéressantes en ce sens qu’elles peuvent traduire des réponses sensibles là où, lorsque l’on mesure une mortalité ou léthalité, on n’observe en réalité souvent pas grand-chose. Même avec des biomarqueurs sur tissu biologique, nous aurions en réalité des réponses moins fines que sur des réponses comportementales ou cognitives des abeilles
Des chercheurs développent des labyrinthes plus ou moins automatisés pour évaluer la capacité des abeilles à apprendre par rapport à une consigne donnée (capacité à construire un apprentissage mais aussi déconstruire un apprentissage en changeant par exemple les règles du jeu). Des stimuli d’odeur ou des stimuli visuels (basées sur des LED de différentes couleurs) viennent récompenser les abeilles et des métriques sont mesurées pour évaluer à quelle vitesse les abeilles arrivent à apprendre ou à associer une récompense. Les abeilles sont marquées avec un code barre, reconnues par caméra à l’entrée du labyrinthe et notées individuellement pendant leur passage, et peuvent s’auto-entrainer pendant des heures et des jours pour fournir des courbes d’apprentissage et de mémoire. Ces tests permettent ensuite de comparer des situations de stress données en soumettant par exemple les abeilles à niveaux variés de pesticides, de métaux lourds ou encore de nutrition, et de mesurer par la suite comment les abeilles réagissent. On fait alors de l’éco-toxicologie au-delà de la survie puisqu’encore une fois, on ne voit pas forcément les abeilles mourir. Il existerait également des dispositifs sous forme de fleurs connectées mais il semblerait que le format de labyrinthe soit un peu plus prometteur.
Ces dispositifs numériques restent encore de l’ordre de la recherche et il sera fondamental de les tester en extérieur parce que les effets de stress sur les abeilles sont multi-factoriels (métaux lourds, manque de disponibilité de nourriture, polluants chimiques, micro-particules dans l’air…) et combinés – on parle d’effets cocktails. Il sera également nécessaire d’aller vers des approches populationnelles (sur l’ensemble de la colonie) et pas seulement sur des abeilles isolées.
Gestion des risques et Sécurité
C’est triste à dire mais les vols de ruches (souvent entre apiculteurs) semblent être une pratique assez courante. Avec la mortalité importante des colonies d’abeille et le problème de disponibilité des essaims, la revente (ou la réutilisation) des essaims est assez facile. Il y a également un risque de perdre la traçabilité (du miel, des abeilles…) parce que les abeilles ne sont pas chacune marquées à l’oreille. Des systèmes d’antivol ont ainsi été proposés pour la filière, soit basés sur un tracking GPS relativement simple (avec alerte ou pas en fonction de la distance à l’exploitation, au rucher, ou à un site de référence), soit basés sur des capteurs d’inclinaison ou d’orientation de ruches. Il est alors considéré que si la ruche change de position, c’est qu’il a bien dû lui arriver quelque chose…
Signalons quand même également les déprédations faites par la faune alentour : sangliers, ours, rongeurs, oiseaux, et voire même par d’autres colonies d’abeille en manque de miel.
La Gestion des ruchers
Dans la droite lignée des logiciels de gestion parcellaire (FMIS) dans les productions végétales et animales plus classiques, on retrouve aussi quelques penchants pour l’apiculture. Les outils numériques de gestion de ruchers sont utilisés par exemple organiser et planifier le travail de l’apiculteur, suivre sa comptabilité, ou encore tracer les transhumances (puisque certains parcours de transhumance peuvent amener plus ou moins de difficultés sur la pollinisation), les soins sanitaires, la position des ruchers ou encore les récoltes.
Tentons de prendre un peu de recul
Le numérique est-il la panacée en apiculture ?
Des intérêts principalement logistiques
L’apiculture de précision, comme l’appellent les principaux intéressés (je critique assez ouvertement ce terme de précision), tient la promesse d’une meilleure compréhension du rucher pour que l’apiculteur puisse se synchroniser au mieux avec elle, au jour ou au couple de jours près, pour ne pas passer à côté d’une miellée, d’éviter d’avoir des colonies qui déclinent s’il manque de l’eau ou de la nourriture (en complémentant leur nourriture), ou pour prévenir un essaimage ou un blocage de pontes (dès qu’une abeille nait et sort de son alvéole, les abeilles vont remplacer l’alvéole par du miel et ensuite la colonie va s’effondrer au fur et à mesure). L’apiculteur décidera alors de visiter ses colonies sur la base d’un premier diagnostic de la situation à distance. Au vu du contexte de super variabilité et d’incertitude dans lequel évoluent les apiculteurs, on pourra comprendre que tout outil pouvant les accompagner et réduire leur charge mentale pourrait trouver de l’intérêt. Une enquête de 2019 de l’ITSAP rend compte de principales pratiques de saisie de données, d’attentes et des réticences des apiculteurs pour le numérique. On ne sait finalement qu’assez peu de choses sur la quantité de ces dispositifs numériques présents sur le terrain. L’organisation de la filière avec plus d’amateurs laisse forcément un peu plus la place à des usages particuliers (certains vont par exemple travailler autour de l’électro-magnétisme) et à un aspect un peu culturel et empirique de la production. Ce petit côté mysticisme est peut-être aussi assez séduisant finalement.
Un apiculteur se déplace régulièrement pour contrôler l’activité et la santé de ses abeilles. Les contrôles restent encore assez visuels (en regardant la planche d’envol, les cadres) et manuels (en soupesant par exemple la ruche..). Ces pratiques résultent de la formation et de l’expérience de l’apiculteur. Actuellement, les outils numériques semblent intervenir principalement pour appuyer les apiculteurs sur des aspects logistiques. Le suivi à distance des ruches est surtout un moyen de repenser les déplacements de l’apiculteur, surtout lorsque l’on apprend que la transhumance des ruches est le principal poste de dépenses, pour environ 40% des coûts de production de miel. De là à aller étudier l’empreinte carbone mobilité d’une exploitation apicole, il n’y a qu’un pas ! Parce qu’il vit dans un climat d’incertitude et qu’il ne décide pas complètement de sa production, l’apiculteur doit soigneusement réfléchir sa stratégie de transhumance pour déplacer leurs ruches en fonction des différents théâtres de fleurs à disposition et faire en sorte que le calendrier de floraison coïncide correctement avec la santé des colonies d’abeille. Les ruchers ne sont pas nécessairement à côté du lieu où vit l’apiculteur et, pour les apiculteurs professionnels, la quantité de ruches à déplacer lors des transhumances est telle qu’il serait dommageable de ne pas chercher à optimiser les déplacements. Transporter plusieurs centaines de ruches impose une logistique très rigoureuse avec l’utilisation de larges remorques (et potentiellement en horaire de nuit).
L’Europe et la France semblent très axés sur la productivité des ruches et l’utilisation des balances connectées. Aux Etats Unis par exemple, la tendance serait plutôt à l’utilisation de capteurs internes à la ruche pour le suivi de température et d’état de la colonie. Les balances auraient en effet plus percé qu’autre chose en France. L’offre est pléthorique en ce sens (Figure 5). Pour le suivi des couvains, les propositions sont plus limitées et la complexité résidera dans l’analyse et l’exploitation de potentielles courbes de température.
Je rajouterais néanmoins ici une petite limite des balances connectées pour la gestion des transhumances. Premier problème : l’empilement des ruches les unes sur les autres génère un certain poids sur les ruches les plus en bas de la pile. Vous imaginez bien qu’une balance peut supporter une ruche voire peut être un peu plus, mais pas forcément toute une pile de ruches. Deuxième problème : les balances aussi prennent du poids et de la place. Si l’on imaginait une balance sous toutes les ruches, ça demanderait une logistique supplémentaire pour la transhumance. Et l’on ne peut pas laisser toutes les balances sur place non plus, à bon entendeur…
Du point de vue du temps travail, on peut effectivement questionner l’intérêt de se déplacer à son rucher si les hausses ne sont pas remplies de miel ou si les abeilles sont un peu trop excitées (j’en profite pour rappeler que les enfumoirs utilisés par les apiculteurs pour calmer les abeilles avant l’ouverture d’une ruche ne servent pas à endormir les abeilles mais bien à couper la communication entre-elles). Lorsque la ruche mielle bien, on peut voir l’intérêt de se revenir installer ou remplacer des hausses vides mais sinon, y-a-il vraiment intérêt de faire des aller-retours pour rien ? L’ouverture régulière des ruches n’est d’ailleurs pas vraiment recommandée tant il est long et coûteux en énergie pour les abeilles de ré-équilibrer la température à l’intérieur de la ruche une fois qu’elle a été ouverte. Avec les capteurs en place, les ruches peuvent être surveillées sans être dérangées, y compris pendant les périodes où les inspections invasives des ruches sont contre-indiquées, comme en hiver ou pendant les périodes de stress des colonies.
Il n’empêche que les apiculteurs ne sont pas prêts à partager n’importe qu’elle information. On commence à entendre pas mal parler de consentement à partager sa donnée dans l’écosystème numérique en agriculture, mais dans ce cas présent, le sujet est beaucoup plus terre à terre. Les apiculteurs ne sont pas forcément très ouverts à parler de géo-localisation et ce pour deux raisons principales. La première, et nous en avons déjà parlé, a trait aux vols de ruches. Pointer précisément la localisation de ces ruches peut soulever quelques craintes. Il existe également une compétition entre apiculteurs pour trouver les emplacements les plus intéressants en termes d’abondance ou de diversité floristique pour leurs abeilles. C’est un peu comme les coins à champignon, certains les protègent corps et âmes…
Travailler sur la saisie vocale ne parait pas non plus complètement exagéré pour faciliter la remontée et la gestion des informations au rucher par des apiculteurs souvent vêtus de tout un tas d’habits de protection.
En apiculture, peut-être plus qu’ailleurs, les capteurs se doivent d’être robustes et de tenir suffisamment longtemps pour ne pas avoir à les changer trop régulièrement. Et ces contraintes ne sont pas forcément évidentes à lever. Les capteurs de température peuvent en effet être perturbés par la cire, la propolis ou le miel dans la ruche. Les capteurs d’humidité, de gaz et de son doivent être nettoyés ou même remplacés lorsqu’ils sont contaminés. Avec les parcours de transhumance des apiculteurs, on ne peut pas non plus s’amuser à devoir recharger la batterie d’un capteur à tire larigot. Certaines zones, particulièrement isolées (en montagne ou ailleurs) ne peuvent même d’ailleurs qu’utiliser une communication par satellite. Restons clair sur le fait que de toutes les manières, une part relativement faible de l’activité d’un apiculteur peut être automatisée, ce qui laisse donc toute la place à la fois aux technologies numériques et aux apiculteurs.
Biosurveillance ou surveillance du bio ?
Malgré les 100 ans de recherche professionnelle que nous avons sur l’abeille, nous devrions en fait plutôt dire que nous avons travaillé pendant 100 ans sur l’abeille apis mellifera. Pour un insecte comme l’abeille qui a 80 millions d’années d’existence, nous avons encore des choses à apprendre. Nos connaissances ont bien évidemment évolué, à la fois sur sa façon de se reproduire, de vivre, d’utiliser son cerveau, de se nourrir, et tous les liens entretenus avec la pollinisation mais il y a encore énormément de choses que nous ne comprenons pas encore bien (par exemple autour de l’essaimage).
Mailler des ruchers sur les territoires – en s’appuyant par exemple sur des syndicats et ou des apiculteurs référents – permettrait d’obtenir des chaines de données sur différentes régions pour centraliser de l’information, détecter des signaux faibles, et générer de la connaissance, à la fois pour la filière apicole, mais aussi pour suivre l’état de la biodiversité. On retrouve par exemple beaucoup de ruches dans les vignes, chez des agriculteurs polyactifs, ou encore en ville – ruches qui, si elles étaient équipées de capteurs, passeraient de ruches « vitrines » à ruches « témoins ».
Sortis du prisme logistique que nous avons discuté dans la section précédente, les dispositifs numériques pourraient-ils être vus autrement que comme des gadgets ? Si l’on voulait être un peu piquant, on pourrait arguer que les boitiers n’empêchent pas les ruches de mourir (ça resterait néanmoins un bon argument pour dire que les technologies numériques ne sont que des outils), ou qu’une ruche renversée restera reversée le temps qu’un apiculteur intervienne. Mais ces outils servent surtout à apporter un lot de données qui ne sont pas encore beaucoup interprétées. Savoir que la ruche est vide ou pleine ? Mouais ok… Les courbes de poids et de température montrent des variabilités journalières et saisonnières de grande amplitude mais, de là à savoir quoi en faire, c’est une tout autre paire de manches. Les outils collectent de la donnée et permettent d’aider à générer de la connaissance mais ne sont finalement pas encore très utilisés pour générer une décision et l’appliquer sur le terrain (je fais ainsi ici référence au cycle fermé « acquisition-caractérisation-préconisation-application » que l’on présente souvent pour parler d’agriculture de précision).
Malgré tous les paramètres potentiellement mesurables pour le suivi des colonies d’abeilles, force est de constater que la réalité opérationnelle fait nettement moins rêver. Les outils se concentrent quand même principalement sur des mesures de poids et de température de ruches, parfois un peu loin de toutes les applications que l’on a pu détailler auparavant (Figure 6). La connexion à distance et en temps réel permet de voir si le vivant est en bon état mais ne permet finalement pas tant que ça de surveiller la biologie (et donc potentiellement les stress environnants) ni toujours à prendre des décisions concrètes. Pour pousser l’explication jusqu’au bout, c’est un peu comme si l’on installait un thermomètre en disant que l’on mettait en place une action contre le déréglement climatique. Mesure et pilotage sont deux choses différentes. L’image est peut-être un peu (trop) forte mais elle a le mérite d’être parlante.
En dehors de l’activité purement production de miel, il n’est finalement pas si certains que les données collectées pour un usage en biosurveillance soient valorisées par les apiculteurs eux-mêmes. On pense plutôt aux territoires ou aux entreprises qui pourront bénéficier de tout ça. Les données remontées à des échelles bien plus larges que les ruchers peuvent avoir de l’intérêt pour développer une connaissance plus fine des productions de miel par type de territoire et par période de miellée, ou encore pour participer à la création d’observatoires régionaux et national de la production de miel. Il faudrait d’ailleurs arrêter de parler de biodiversité à l’échelle d’un site, mais toujours de voir comme ce site est inclus dans son territoire, pour essayer d’avoir une vision un peu plus macro du sujet traité.
L’abeille est certes une toute petite goutte d’eau dans l’ensemble des espèces de pollinisateurs mais son étude, permise aussi par le fait que l’apiculture existe, aide à renseigner sur l’état général des populations d’insecte. En étant tout à la fois une espèce phare (suscitant l’adhésion du public), une espèce parapluie (dont les besoins en matière de conservation protègent accessoirement d’autres espèces), une espèce indicatrice (sensible aux changements/dégradations) et espèce clé (dont l’impact écologique est disproportionné par rapport à son abondance), les insectes pollinisateurs dont l’abeille domestique offrent une vitrine sans commune mesure du vivant. Parce qu’elle est un maillon important de l’écosystème, l’abeille – comme sentinelle de l’environnement ou marqueur du vivant – va représenter des impacts variés sur la faune, la flore, les humains que nous pouvons tenter d’approcher en traduisant ce que vit l’abeille dans son quotidien, dans les difficultés de sa vie et d’adaptation à son environnement. En prenant du recul sur l’enveloppe de recherche couverte par les abeilles (quelques km de diamètre autour d’une ruche), ce sont en réalité plusieurs centaines de millions voire milliards de végétaux qui sont butinés par les abeilles d’une même ruche donnant ainsi accès à une quantité assez impressionnante sur l’état de l’environnement alentour.
Outre les abeilles, il y a en réalité plein de matrices différentes à creuser : pollen, miel, nectar, cire, – toutes apportant leur lot d’informations sur le contexte autour du rucher. Le pollen est d’ailleurs particulièrement intéressant parce qu’il est possible d’en récupérer dans des trappes avant même que l’abeille n’ait pénétré dans la ruche (une sorte d’information brute à disposition). Le pollen fixe des polluants et contient en plus de l’information sur les végétaux butinés par les abeilles, même à l’état de trace.
Contrairement aux autres filières animales, force est de constater que l’abeille évolue dans un environnement complètement différent. Les abeilles travaillent dans leur ruche et sont en mesure d’explorer l’environnement à plusieurs kilomètres de distance – parfois même jusqu’à complètement s’épuiser si les ressources alimentaires sont trop éloignées (ce n’est donc pas forcément bon signe si les abeilles s’éloignent vraiment beaucoup de leur ruche). Lorsque l’on parle d’élevage apicole, toute la sémantique associée aux élevages plus classiques est elle aussi utilisée : reproduction, sélection génétique, transhumance… Mais dans les faits, la notion de liberté entourant l’abeille et son rucher rentrent fortement en ligne de compte.
S’il n’y avait aucune espèce d’abeille domestiquée, serions-nous ou aurions-nous été capables de commencer à quantifier la diminution du taux d’abeilles ? C’est vrai que la pratique de test de cognition (voir la partie sur les outils numériques) parait un peu plus compliquée avec des abeilles sauvages. Ce n’est bien sûr pas pour autant qu’il faut détourner le regard des autres insectes pollinisateurs. Certains gros projets européens commencent à inclure d’autres espèces comme les bombus et quelques abeilles solitaires. Peut-être arriverons-nous même à installer des capteurs également sur les abeilles solitaires. Les ruches connectées peuvent être en effet un moyen d’avoir un curseur indirect sur les pollinisateurs sauvages. Pourrait-on aller jusqu’à dire que ça serait un nouveau marqueur de biodiversité ?
L’abeille est une espèce étendard qu’il nous faut continuer d’étudier, que l’on connait de mieux en mieux et qui nous permet de comprendre tout un tas de chose sur la biologie et la cognition. Il est nécessaire d’aller plus loin et d’aller voir ce qui se passe chez les autres espèces pour, en quelque sorte, passer d’une vision centrée sur l’abeille à une vision ouverte sur la biodiversité. Et je ne parle pas simplement de considérer d’autres espèces de pollinisateurs mais bien, pour l’abeille, de ne plus simplement l’étudier en tant qu’individu, mais de bien la voir en tant que super-organisme dans son environnement, de manière à pouvoir imaginer une approche plus écologique et holistique de l’apiculture. L’abeille domestique ne semble pas être réellement être en danger. Nous les reproduisons, et il y en a peut-être de plus en plus. Par contre, la biodiversité dans son ensemble, elle, diminue. Nous ne pouvons plus simplement nous contenter d’extrapoler les résultats obtenus sur nos abeilles domestiques aux abeilles sauvages.
La donnée mesurée reste encore assez compliquée à exploiter
Mais pourquoi la donnée brute est-elle laissée telle quelle et rarement exploitée derrière par les principaux outils du marché ? Tout simplement – si j’ose dire – parce que c’est compliqué… Le biais, le biais, le biais, il y en a partout ! La plupart du temps, le temps d’acquisition de la donnée varie de quelques minutes à quelques jours, quel que soit le type de données collectées. Comme chaque colonie est unique, l’analyse de quelques ruches pour une petite partie du cycle de vie des abeilles ne suffit pas à comprendre toutes les subtilités d’un rucher complet. Les biais sont encore plus présents avec les modèles formés à partir des données d’une seule ruche. Les initiatives de recherche qui visent à comprendre la vie des abeilles doivent inclure au moins les données d’une année entière, car les abeilles ont des modes de vie radicalement différents entre l’été et l’hiver, et leur comportement au début et à la fin de la haute saison diffère également
Florilège de situations à prendre en compte :
- Sur les mesures de poids
- La courbe de poids d’une ruche en bois est susceptible d’être affectée par les changements de teneur en humidité du bois, par de l’eau stagnante sur la ruche après une pluie, ou encore par des interventions rapides de l’apiculteur sur la ruche (pose, retrait de hausse…)
- La courbe de poids informe plutôt sur l’état de la colonie (adultes, couvain et réserves alimentaires) que de l’individu uniquement. Même si l’on pourrait théoriquement avoir une information plus précise sur les butineuses spécifiquement (par rapport aux autres abeilles), le risque de confusions avec les gains et les pertes d’eau et de pollen restent gênants.
- Sur les mesures de température
- La surface destinée à l’élevage de couvain varie fortement selon la colonie, et aussi selon la période chez une même colonie
- La localisation de la sonde de température est encore plus complexe en hiver qu’en saison car la grappe d’abeilles peut se déplacer dans la ruche. Sur moins de 15 cm, on peut observer un gradient de températures allant de 5°C en périphérie de la grappe à 25°C au cœur de celle-ci
- Sur les mesures de gaz
- Les dispositifs de mesure de la teneur en gaz nécessitent un flux d’air contrôlé, ce qui peut influencer le microclimat du nid d’abeilles.
- Sur les mesures d’humidité
- Les capteurs d’humidité sont plus coûteux et doivent être maintenus propres et protégés des abeilles car la vapeur d’eau ne peut pas surmonter la cire ou la propolis pour atteindre le capteur
- Sur les mesures de vibrations et sons
- Les données de vibrations d’une ruche sont très bruitées.
- Compteurs d’abeilles
- Les abeilles peuvent avoir tendance à s’agglutiner autour du capteur, provoquant des lectures faussées d’entrée et de sortie d’abeilles de la ruche
- Les abeilles peuvent faire marche arrière
- Les compteurs d’abeilles mécaniques et électroniques modifient au moins le mouvement de l’air, l’élimination des abeilles mortes de la ruche et probablement d’autres activités des abeilles.
- Pour les compteurs avec caméras, les mesures sont affectées par la place et l’orientation de la caméra autour de la ruche, mais aussi par les ombres des abeilles en arrière-plan qui peuvent conduire les modèles à compter chaque abeille deux fois, ou à compter une abeille même si elle n’est pas dans l’angle de la caméra
- Les ruches sont parfois modifiées pour permettre de meilleures conditions de prise de vue (éclairage ou forcer les abeilles à suivre un chemin spécifique) ce qui peut rendre plus compliquée la comparaison des données entre ruches différentes.
Des modèles économiques encore compliqués à trouver
Comme pour tout outil numérique demeure la lancinante question du modèle économique associé aux principaux capteurs apicoles. Certains affirmeront sans détour que les balances et capteurs de température sont trop chers, justifiant leur constat par le fait qu’à plusieurs centaines d’euros l’outil, on ne peut économiquement pas imaginer en installer un par ruche et encore moins un par abeille – même en prenant en compte la durée de vie du matériel. Sur les filières végétales où l’on raisonne sur plusieurs hectares ou sur les filières animales où l’on travaille avec des animaux bien plus imposants (une vache, une brebis), le coût de revient à l’hectare ou à l’animal n’est bien évidemment pas comparable. En apiculture, même s’il est vrai qu’en bon comptable, il est difficile de trouver des arguments contradictoires, est-ce finalement si grave de ne suivre qu’une partie de son rucher ? C’est alors toute l’expertise de l’apiculteur qui doit être mobilisée pour positionner ces outils dans des zones et des ruches représentatives du rucher complet. Des capteurs plus évolués et plus chers peuvent être placés dans des sites et ruches prioritaires pour s’assurer de la fiabilité de données de référence alors que des capteurs à bas coût peuvent être déployés plus massivement – en acceptant leur moindre fiabilité ou en les étalonnant en fonction des capteurs de référence – pour dégager des tendances sur le rucher. Les questions deviennent alors plutôt : est-ce que j’en équipe ou pas ? Et, si oui, combien j’en équipe et où je les positionne au mieux ? Même si cela parait évident, on imagine bien que les usages diffèrent en réalité grandement entre tous les apiculteurs : amateurs, semi-professionnels, professionnels.
Si les capteurs en eux-mêmes sont trop chers, de nouveaux modèles économiques sont à imaginer : parrainage de boitiers, parrainages de ruches par des particuliers ou entreprises, services de pollinisation payées par des agriculteurs, services de suivi de l’éco-score du territoire par les abeilles. Se posera alors la question de savoir comment activer ces segments de biodiversité qui ne sont clairement pour le moment pas très rémunérateurs…
La filière numérique en apiculture souffre d’effets d’annonce et de de buzz en tout genre. Vous me direz qu’on peut élargir ce constat à l’écosystème numérique dans son ensemble…. Néanmoins, la lutte pour la sauvegarde des abeilles est un argument qui résonne dans de nombreuses oreilles et qui a souvent tendance à faire mouche. Résultat des courses : les nouveaux dispositifs numériques se multiplient et, pour beaucoup, avortent, tout simplement parce que, si le message initial était bien marketé, la construction et l’industrialisation des outils numériques rencontrent quant à elles une réalité plus douloureuse. Il suffit parfois d’aller sur quelques sites web d’entreprises pour se rendre compte que les pages ne sont soit plus maintenues à jour, soit qu’il est tout simplement impossible d’acheter quoi que ce soit de matériel à l’entreprise.
Certaines des solutions numériques proposées relèvent plus du bricolage qu’autre chose. En nombre, les apiculteurs sont beaucoup des amateurs passionnés et on peut comprendre qu’ils aient envie de prototyper par eux-mêmes, de copier des idées par-ci par-là et de déployer leur propre outil. Ne voyez pas ici une quelconque médisance – je ne remets absolument pas en jeu le fait que ces outils bricolés fonctionnent ou non – je dis simplement que l’optique du bricolage reste difficilement conciliable avec une industrialisation et opérationnalisation de l’outil. Le risque est grand que les promesses ne soient alors pas au rendez-vous et que des apiculteurs ayant testé une de ces technologies soient laissés sur le bord de la route quelques semaines ou mois plus tard. Des capteurs bricolés seront forcément low-cost mais des effets d’annonces sur des capteurs à très bas prix risquent de faire exploser en vol toutes les structures qui auront cherché à industrialiser leurs capteurs. Une ruche connectée à 100€ devrait mettre la puce à l’oreille.
Difficile également de savoir qui fait quoi. La figure 5 montre effectivement tout un patchwork de dispositifs numériques mais lorsque l’on cherche à rentrer un peu plus dans le détail en termes de paramètres réellement suivis ou d’interprétation de données brutes ; on n’est souvent pas au bout de ses peines. Non, tout le monde ne fait pas d’analyses de mortalité, tout le monde ne fait pas non plus de prédictions d’essaimage ou de détection de miellées automatiques. Pour beaucoup, la donnée consiste « simplement » à être au moins présentée ou affichée sur une application mobile ou un outil web.
Est-ce que les outils numériques dérangent les abeilles ?
Plusieurs capteurs utilisés en apiculture sont intrusifs – ils viennent s’installer directement à l’intérieur de la ruche. Est-ce qu’on peut pour autant dire qu’ils perturbent complètement le fonctionnement de la colonie ? Les abeilles vont certes s’adapter un peu à l’intrusion. Les abeilles produisent également de la propolis qu’elles utilisent généralement pour boucher les trous indésirables et les isoler des corps étrangers comme les dispositifs numériques. Le débat sur le caractère invasif des outils numériques n’est pas complètement clos. A côté de ça, les ondes basses fréquences peuvent déranger les abeilles et l’arrivée de nouveaux dispositifs numériques pose nécessairement question quant aux bandes de fréquences utilisées par ces outils-là.
Une extinction de masse de la biodiversité des invertébrés
Pour beaucoup, nous avons l’intime conviction que la population d’insectes diminue. Nous l’avons ressenti récemment pendant les brèves périodes de sortie pendant la Covid-19 où nous avions l’impression de voir une biodiversité beaucoup plus abondante qu’avant (ou peut-être tout simplement y faisions-nous plus attention). Le phénomène du pare-brise est souvent brandi comme un argument d’autorité pour témoigner du fait qu’avant (on ne sait d’ailleurs pas bien quand), nous avions le souvenir d’avoir des vitres (et notamment le pare-brise) constellées d’insectes après n’importe quel voyage en voiture. Le principal problème est que nous n’avons pas de données quantifiées anciennes d’état de population et que nous ne pouvons ainsi pas jauger de l’abondance et de la diversité des populations quand nos pare-brise (ou ceux de nos parents et arrière-grand parents) étaient parsemés d’insectes. Nous ne comparons donc ainsi finalement que les nouvelles données que nous acquérons à une référence potentiellement faussée (ou largement sous-estimée) datant des premières mesurées réalisées. Nous avons alors affaire au concept de ligne de base changeante ou de décalage du point de référence (Shifting Baseline) en ce sens qu’il y a un risque important que les plus jeunes générations considèrent comme normale l’abondance actuelle, déjà réduite, des pollinisateurs.
La très grande majorité des études populationnelles pointe des déclins importants des espèces de pollinisateurs en termes d’abondance mais aussi de distribution géographique plus restreinte des espèces. Même si vous allez voir que ces études ont leur limite et que la compréhension du déclin est partielle (je vous invite à lire la section suivante), ces déclins observés sont très inquiétants à plusieurs égards.
Si l’on centre notre regard sur l’apiculture, en France, le cheptel ne semble pas en déclin. Il cacherait en réalité un turnover très important. Mais ce constat n’est pas identique en tout point du globe. En Amérique du Nord par exemple, il semble plus difficile d’avoir assez de production d’essaims pour répondre aux demandes de services de pollinisation. Pour les abeilles melliphères, certains parlent de 20% de mortalité annuelle moyenne dans les ruchers, avec des pics parfois au-dessus de 30% (voire plus). Il y a ainsi énormément de colonies à renouveler.
Plus particulièrement sur les abeilles, même si l’on peut bien évidemment penser que la diminution régulière observée du nombre d’espèces soit due à des changements dans le stratégies de collecte de données (difficulté d’acquérir certaines donénes, réduction de la couverture d’échantillonnage…), il est quand même probable que tous les travaux témoignent en réalité d’un déclin mondial de la diversité des abeilles étant donné que de nombreuses espèces deviennent plus rares et moins susceptibles d’être trouvées tandis que des espèces moins nombreuses deviennent dominantes et peut-être même augmentent en abondance (ou diminuent elles-aussi, à un rythme peut-être plus lent)
De manière générale, les insectes en voie de disparition ne seraient pas seulement cantonnés à des espèces spécialistes aux exigences écologiques étroites (qui dépendraient de plantes spécifiques elles-aussi) ou à des niches écologiques mais bien aussi à des espèces généralistes tout à fait communes. On pourrait effectivement s’attendre à ce que les espèces dont les besoins en pollinisation sont les plus spécialisés soient les plus menacées, mais rien ne semble le prouver concrètement.
Habituellement, les interactions plantes-pollinisateurs sont asymétriques et généralement imbriquées, avec un noyau d’espèces généralistes jouant des rôles clés, des pollinisateurs spécialisés dépendant souvent de plantes généralistes et des plantes spécialisées dépendant souvent de pollinisateurs généralistes. Les espèces généralistes étant souvent moins vulnérables au changement que les espèces spécialisées, elles pourraient soutenir en partie la structure du réseau dans des conditions modifiées. Ces réseaux asymétriques sont particulièrement redondants ce qui les rend relativement robustes à la perte d’espèces et d’interactions en cascade. Les espèces de plantes et de pollinisateurs ont également un taux de recâblage (acquisition de nouvelles interactions) relativement élevé. Cela suggère que ces espèces seront flexibles dans une certaine mesure pour changer de partenaires en réponse à l’extinction des partenaires précédents Avec un changement global en cours qui affecte non seulement la présence des espèces, mais aussi les interactions entre les espèces et les voies d’interaction, on pourrait craindre que les réseaux de plantes-pollinisateurs atteignent un point de basculement et s’effondrent malgré la structure maillée et en réseau qui est prépondérante.
Même si certains insectes en déclin peuvent être remplacés par d’autres, il est difficile d’imaginer comment une baisse nette de la biomasse globale des insectes pourrait être compensée.
Une revue synthétique des causes du déclin
Les causes du déclin sont tellement diverses et variées qu’on ne sait plus où donner de la tête. J’admets qu’il est ici assez difficile de sortir d’une liste à la Prévert mais je tenterai d’être le plus synthétique possible et d’apporter quelques clefs de lecture :
Le déréglement climatique impacte potentiellement tous un tas de niveaux d’organisation différents : le niveau individuel, la génétique des populations, les changements au niveau des espèces (phénologie des plantes, utilisation de l’eau) mais aussi des changements au niveau communautaire. Le changement climatique menace actuellement les pollinisateurs et ce facteur est susceptible de gagner en importance à mesure que des découplages et des désynchronisations temporels et spatiaux majeurs se produisent dans les interactions entre plantes et pollinisateurs (phénologies perturbées, ‘évolution de la répartition des espèces). Les aires de répartition des espèces peuvent se transformer à la fois en taille mais aussi en localité – et certaines espèces ne peuvent tout simplement pas déplacer leur aire de répartition ce qui les rend alors très sensibles à des changements climatiques rapides.
Les espèces d’abeilles peuvent avoir des tolérances thermiques différentes. Les années de sécheresse à venir et les fortes pluies sont susceptibles de continuer à toujours plus affaiblir les abeilles (celles qui n’ont pas de tolérance thermique par exemple), aggraver les autres causes de déclin (moins de disponibilité en eau due aux sécheresses, moins de nectarification) et augmenter leur mortalité. En Corse par exemple, l’apiculture a souffert d’un manque d’eau chronique due à la sécheresse sur plusieurs mois d’affilé. Le manque de données de référence dans de nombreuses régions du monde entrave notre capacité à suivre les effets du changement climatique au fur et à mesure de leur déroulement. Petite note positive pour terminer : le déréglement climatique pourrait malgré tout avoir un impact positif sur les espèces aux tolérances thermiques supérieures.
Les scandales du Gaucho, Régent, Cruiser ou encore Poncho ont révélé l’impact puissant des insecticides systémiques (qui se retrouvent dans tous les organes des plantes) sur les populations d’insectes et la présence des lobbys phytopharmaceutiques pour protéger l’homologation de leurs produits. Les insecticides systémiques peuvent être soient pulvérisés tels quels ou être enrobés autour des graines à semer (on parle alors de traitement de semences). Ces insecticides ont une rémanence forte et on les retrouve ainsi dans tout un tas de matrices différentes (eau, sol, pollen, nectar de fleurs sauvages…) ce qui implique qu’ils n’agissent pas « que » directement sur les populations d’insectes mais sur tout l’écosystème environnant (réseau alimentaire des insectes, mécanismes naturels de contrôle biologique…).
Ces produits systémiques, et notamment les néonicotinoides (dont nous avons récemment vu le retournement de veste en France sur les betteraves), sont particulièrement insidieux parce qu’ils ne provoquent souvent pas directement la mort des insectes (pollinisateurs ou non) mais agissent plus pernicieusement à des niveaux sub-léthaux ou chroniques en affectant leur comportement et leur durée de vie. Leur présence, même en faible quantité, a tendance à désorienter les abeilles, à affecter leur capacité de mémorisation et d’apprentissage (les abeilles risquent donc de ne pas retrouver leur ruche), à jouer sur leur état physiologique (malformation des ailes, diminution de la croissance), à impacter leur activité quotidienne (chute drastique de la production de miel), ou encore à induire des effets métabolique (phénomènes d’hypoglycémie par exemple). Les colonies d’abeilles masquent souvent ce qu’elles sont en train de subir et, lorsqu’une colonie meure, cela faisait en réalité assez longtemps qu’elle était en train de tenter de s’adapter. Ces produits sont en plus difficiles à doser et souvent présents en quantités infimes dans des cadavres d’abeilles qui, de surcroit, se décomposent très vite. Par leur impact pernicieux, les preuves ne sont pas encore accablantes sur la totalité des espèces d’insectes, les effets sur les colonies d’abeilles à miel domestiques sont par exemple encore contradictoires. Les impacts à long terme, eux aussi, restent encore controversés. Est-ce que les herbicides eux-aussi pourraient jouer tous ces rôles ? Les recherches sont en cours.
Les pratiques agricoles sont intimement liées à l’état des populations insectes. Nous avons bien sûr parlé des produits systémiques et particulièrement des néonicotinoides mais l’agriculture a un rôle bien plus large que ça. Les monocultures réduisent également la disponibilité des ressources de nidification et des micro-habitats (haies, bois mort, zones humides, arbustes…). Les fauches précoces des prairies, la simplification à outrance des assolements et le manque de surfaces en légumineuses limitent la quantité et diversité de nourriture (pollinifères et nectarifères) à disposition pour les abeilles. Rappelons également que la lutte contre les traitements de semences (je vous renvoie à la section sur les néonicotinoïdes) ne doit pas non plus nous faire oublier d’autres questions comme l’éventuelle toxicité de certaines espèces cultivées. Les OGM font également peser le risque d’une diminution des ressources alimentaires parce qu’ils concourent directement ou indirectement à une réduction des populations de mauvaises herbes avoisinantes.
Le manque de disponibilité en nourriture est une des conséquences terribles d’une grande partie de ces effets, cumulés ou non. Et ne nous concentrons pas seulement sur la quantité, mais ouvrons également les yeux sur la qualité des ressources fournies aux abeilles parce que la composition du nectar et des abeilles joue sur l’attraction et la fidélité des abeilles. La diversité et l’abondance des abeilles sauvages sont fortement liées à la disponibilité des ressources florales dans la zone de butinage (continuité spatiale interannuelle des plantes et des ressources florales). Les efforts doivent se concentrer sur les périodes de déficit de manière à pouvoir retravailler sur l’équilibre de l’alimentation des abeilles tout au long de la saison, histoire d’être sûr d’avoir des éléments nourriciers supplémentaires et des ressources à disposition. L’installation de ruches ou l’acceptation de nouvelles ruches sur un site (par exempl eun parc naturel) doit être réfléchie au regard de la quantité de ressources à disposition.
Nous avons parlé des pratiques agricoles, certes, mais il serait bien trop simple de limiter le périmètre aux seuls agriculteurs. Les apiculteurs eux aussi ont leur rôle à jouer mais attention à ne pas non plus se tromper de combat. Dans des milieux toujours plus anthropisés, le travail apicole n’est pas de tout repos. Certains apiculteurs peuvent être considérés comme des chasseurs de miel parce qu’ils cherchent à optimiser leur nombre de ruches et parce qu’ils déplacent régulièrement les colonies (une sorte de transhumance à outrance), ce qui génère forcément du stress pour les abeilles. Le nourrissage des ruches au sirop de glucose, pain de sucre et aux antibiotiques, l’ouverture régulière des ruches (qui crée des chocs thermiques importants pour les abeilles qui passent un temps démesuré pour retrouver un équilibre de température), l’utilisation de plaques de cires toutes faites (au lieu de laisser les abeilles produire leur cire et ainsi donner une identification claire à leur ruche), l’ajout trop régulier de hausses vides pour booster la production de miel (les abeilles ne vont alors pas réussir à chauffer correctement le cœur de la ruche) ou encore la récupération d’un stock de miel qui aurait dû être laissé aux abeilles pour passer l’hiver, sont autant de pratiques qui viendront elles-aussi alimenter le déclin des abeilles. Quelques apiculteurs arracheraient même les ailes de la reine pour éviter les essaimages… La tendance générale reste bien évidemment à la bienveillance mais certaines pratiques doivent évoluer.
Connu comme le loup blanc dans les élevages apicoles, le Varroa Destructor (on se croirait dans un vieux nanard hollywoodien) est un des acariens qui a pointé son nez suite aux déplacements dans le monde entier des abeilles à miel occidentales classiques hors de leurs aires de répartition d’origine. Ce n’est néanmoins pas le seul enjeu sanitaire (le petit coléoptère de la réunion, la lope américaine…) mais tous ne sont pas encore arrivés en France… Force est de constater que les apiculteurs, eux aussi, utilisent des insecticides avec des molécules organiques ou de synthèse (et ce dans leur ruche) pour protéger leurs abeilles de ces invasions-là. Il n’y a donc pas que les méchants agriculteurs mais le sujet est peut-être un peu trop tabou. Le Varroa ne supporterait pas des températures trop élevées que le corps chaud de la grappe d’abeille pourrait atteindre relativement facilement. Les rapports de l’IPBES témoignent du fait que l’ensemble de la filière gagnerait à travailler sur l’hygiène et la lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes chez les insectes pollinisateurs domestiques. Les agents pathogènes ne datent pas d’hier et ont continuellement coexisté et évolué avec les espèces d’abeilles mais c’est bien l’introduction nouvelle d’organismes, plus ou moins exotiques, qui contribue plus ou moins au déclin des populations d’insectes.
Comme dans tout système écologique, les invasions biologiques d’abeilles et de plantes exotiques sont susceptibles de menacer la stabilité des réseaux d’interaction plantes-pollinisateurs indigènes. Les plantes envahissantes peuvent diminuer localement l’abondance des espèces végétales indigènes et des communautés de pollinisateurs associées. Certaines espèces d’abeilles envahissantes peuvent rentrer en compétition pour la nidification et les ressources florales avec d’autres espèces d’abeilles et faciliter la propagation d’agents pathogènes. On peut imaginer également que des croisements entre pollinisateurs indigènes et exotiques jouent sur la diversité génétique des populations indigènes. N’oublions pas néanmoins que les plantes exotiques peuvent aussi constituer des sources supplémentaires de pollen et de nectar et ainsi servir de tampon contre les pénuries potentielles de nectar (et de pollen) dans le cadre de changements environnementaux. La compétition est elles ainsi si abrupte que ça ? Le sujet est lui aussi encore assez controversé
Les abeilles des élevages apicoles sont domestiquées, il est bien important de le rappeler. Ces abeilles ont ainsi été sélectionnées depuis longtemps et sont nécessairement affaiblies sur certains traits particuliers (qui ne servent peu ou prou l’intérêt direct des apiculteurs à savoir la production de miel). Très peu d’apiculteurs en France sont aussi sélectionneurs et seulement quelques apiculteurs se sont organisés collectivement pour conduire un programme de sélection. Les apiculteurs restent encore pour beaucoup dépendants d’une sélection qui vient des pays du sud de l’Europe et d’Amérique du Sud et qui, sans surprise, pose des questions légitimes sur le plan sanitaire et environnemental (je vous renvoie vers la partie sur les pathogènes et invasions diverses).
Et le remplacement d’une vieille reine par une plus jeune (on appelle ça le remérage) rentre aussi dans la balance. Certaines reines, elles-aussi, sont sélectionnées et élevées dans des conditions particulières pour être derrière réintroduites dans les élevages. On pourra alors questionner notre capacité à choisir de meilleures reines que les abeilles et ouvrières elles-mêmes (et à chercher ainsi par cette activité une manne financière) et à les réintroduire correctement dans les élevages pour ne pas les perdre au bout de quelques semaines. Les reines seront potentiellement sélectionnées pour avoir de faibles essaimages, ce qui implique une sélection contre la reproduction des colonies d’un point de vue évolutif. Les programmes de sélection ont aussi tendance à sélectionner la douceur comme paramètre privilégié pour ne pas avoir des abeilles trop excitées. Mais c’est alors risquer de favoriser l’entrée d’abeilles ouvrières étrangères et de leurs acariens. Les reines introduites ne sont pas les mères des abeilles présentes dans la ruche et il faudra alors beaucoup de temps pour que les abeilles meurent et soient remplacées par les dignes filles de la nouvelle reine. La reine qui reste après l’essaimage devra également être fécondée, et ce potentiellement par n’importe quel faux bourdon du quartier (de colonies gérées ou faux bourdon sauvage). En fonction de la génétique du bourdon, les abeilles à naitre sont susceptibles d’être agressives, peu productives et gourmandes en ressources.
Je vais m’arrêter là pour la liste mais on pourrait aller plus loin (pollution industrielle, pollution aux métaux, pollution sonore, pollution lumineuse…). Bref si l’on cherche on trouve.
Comprendre le déclin reste une tâche terriblement compliquée
Mesurer est une chose – et nous avons vu que les acteurs de la filière apicole ne manquaient pas d’idée en matière de développement d’outils numériques. Comprendre et interpréter en est une autre. La compréhension du déclin des pollinisateurs est diablement compliquée. Les causes de ce déclin – nous venons d’en parler – sont déjà extrêmement variées, donnant ainsi lieu à une analyse multifactorielle et une combinaison de paramètres bien entremêlés. Certains facteurs sont colinéaires, c’est-à-dire qu’ils impactent le déclin dans le même sens ou dans un sens opposé sans que nous y voyions très clair sur le facteur auquel pouvoir attribuer les tendances. D’autres facteurs sont confondants en ce sens qu’ils impactent indirectement le déclin. On pense par exemple au cas des OGM dont les effets varient en fonction du type de culture, mais sont relativement difficiles à séparer de l’assolement et de l’organisation des parcelles parce que les cultures OGM sont souvent produites en monocultures. Les monocultures ont tendance également à être un lieu plus privilégié pour l’utilisation de produits phytosanitaires. De la même manière, la majeure partie des cultures tolérantes aux herbicides s’accompagne généralement d’une réduction des populations de mauvaises herbes, diminuant les ressources alimentaires disponibles pour les pollinisateurs. Les effets peuvent aussi être interactifs et additifs ou non (on parle alors d’effets cocktails) – et malgré les efforts de recherche à saluer, la plupart des études travaillent encore sur des facteurs de manière isolée. Les preuves de ces effets d’interaction ou de cocktails sont donc relativement rares. Cause ou conséquence, Corrélation ou Causalité, nous en revenons toujours aux problématiques que les statisticiens connaissent bien…
Il est toutefois important de reconnaître que l’importance d’un moteur particulier varie en fonction du contexte géographique et écologique, ainsi que de l’espèce de pollinisateur en question. Il est donc très difficile de classer universellement les moteurs sur une base quantitative. Certains de ces facteurs peuvent également n’avoir qu’une influence visible à long terme. On peut penser par exemple ici aux effets du déréglement climatique qui n’apparaitraient que trop tard en raison du temps de réaction et d’adaptation des écosystèmes.
Un deuxième enjeu de taille est le fait que jusqu’à présent, nous avons essentiellement mesuré des déclins locaux – à la fois en termes de répartition spatiale mais aussi en termes d’espèces surveillées. Le statut mondial du déclin des abeilles (et des autres pollinisateurs) n’a ainsi pas vraiment été réellement mesuré (IPBES, 2018). La grande majorité des études populationnelles est concentrée dans quelques pays bien ciblés, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Ce sont donc essentiellement dans ces localités (et à différentes mailles spatiales) que l’on est le plus susceptible d’avoir accès à des historiques de données. On pourrait même rajouter la tendance à échantillonner des zones bien peuplées et plus accessibles plutôt que des zones plus éloignées et potentiellement plus riches en biodiversité. Les études (à la fois en recherche mais aussi celles en sciences participatives) sont principalement orientées vers des taxons facilement identifiables. Et la tendance à la baisse de la richesse des enregistrements d’espèces s’accompagne d’une tendance à la domination croissante des enregistrements par quelques espèces. On peut alors craindre de manquer la disparition de certaines espèces clés avec des rôles fonctionnels importants qui réduiraient la résilience de l’écosystème dans sa globalité. Certaines espèces en déclin sont d’ailleurs peut-être devenues suffisamment rares dans certaines parties de leur aire de répartition pour être difficiles à détecter.
Les données sont donc manquantes, que ce soit sur le suivi des espèces en tant que telle (abeilles domestiques, sauvages et autres pollinisateurs) mais aussi en rapport avec les facteurs susceptibles d’affecter le déclin des abeilles. Nous manquons cruellement accès à des données ouvertement disponibles et hautement résolues (comme celles en rapport avec l’utilisation de pesticides). L’établissement officiel d’une extinction locale nécessiterait un échantillonnage plus intensif que ce qui est réalisé actuellement. Il faut assumer le fait qu’il est relativement difficile d’observer des abeilles dans leur environnement normal sans bouleverser de manière significative le fonctionnement des colonies. L’abeille à miel domestique est une espèce eusociale qui vit en colonie de plusieurs milliers d’individus avec des tâches bien réparties entre castes.
En plus du manque, les données sont également désordonnées et les programmes de surveillance rarement coordonnés en ce sens que les méthodes et pratiques d’acquisition de données varient d’un territoire à un autre, ce qui rend d’autant plus compliqué la reconstruction des aires de répartition géographique et des abondances d’espèces, et les tentatives de synthèse des modèles mondiaux en écologie de la pollinisation. Des changements dans les tendances de collecte (dus à des changements de priorités dans les musées, à des restrictions sur les mouvements de matériel biologique en provenance de points chauds de la biodiversité, à l’abandon de la recherche en histoire naturelle et de la taxonomie, ou à la mise en œuvre de programmes de surveillance systématique) pourraient conduire à un déplacement des espèces rares vers les espèces communes, créant ainsi un faux signal de déclin de la richesse apparente des espèces. Autant le suivi de population à un instant « t » est difficile, autant le suivi dynamique (spatial et temporel) de cette même population est d’autant plus singulier parce qu’il demande d’avoir des mesures répétées dans le temps et l’espace.
Les études centrées sur la compréhension du déclin – et pas simplement sur la quantification et mesure du déclin – donnent souvent à voir des résultats obtenus dans des conditions contrôlées en laboratoire. Ces travaux rendent ainsi toute forme d’extrapolation assez touchy parce que, comme nous l’avons discuté plus haut, les conditions environnementales entourant un rucher sont extrêmement variées et les facteurs d’influence sur le déclin des abeilles sont multifactoriels et potentiellement confondants, additifs ou encore interactifs. L’exposition réelle des abeilles sur le terrain doit être prise en compte pour pouvoir en tirer des explications générales (mais la connaissance de cette exposition réelle est elle-aussi manquante). Pour revenir sur l’exemple des pesticides, les abeilles – dans leur environnement naturel – sont souvent exposées à des mélanges de pesticides qui, appliqués individuellement, n’ont aucune toxicité, mais qui peuvent induire des effets négatifs lorsqu’ils sont testés en cocktail. Les protocoles de nourrissage des abeilles doivent ainsi se rapprocher au plus près des conditions d’exposition du terrain.
Avoir des suivis densifiés spatialement avec des méthodes d’échantillonnage harmonisées est très certainement un enjeu fort pour une meilleure appréhension du déclin des pollinisateurs, et les approches instrumentées peuvent avoir un rôle important à jouer là-dedans. Il ne faut pas non plus tout attendre des dispositifs numériques automatisés dans le sens où bien que la collection de données puisse être assez intense que ce soit au niveau de l’individu, de la colonie et du rucher, ces dispositifs n’informent pas nécessairement sur ce qui se passe concrètement à l’extérieur de la ruche.
Prudence et rigueur sont donc de mise…
Entre tabous et débats
Une filière dominée par les apiculteurs amateurs
Plusieurs interviewés m’auront présenté l’apiculture comme un des derniers métiers de chasseur-cueilleur, avec la capacité des apiculteurs à lire la nature et à tenter de trouver les meilleurs sites d’installation de ruches. L’engouement pour les abeilles sociales participe à augmenter le nombre d’apiculteurs amateurs. La filière apicole est caractérisée par un grand nombre de ces amateurs et on peut alors voir les choses sous deux auspices différents. D’un côté, on pourrait être tenté de dire que les amateurs travaillent nécessairement moins bien que les professionnels, parce qu’ils sont moins formés (tout simplement parce que ça n’est pas leur activité principale), qu’ils ne déclarent pas forcément toutes leurs ruches (et donc que leurs interventions sanitaires sont plus approximatives et moins protectrices que prévu), ou qu’ils pourraient avoir tendance à vendre un peu de miel sous le manteau. Il manquerait visiblement pas mal de chiffres en apiculture. Une autre façon de voir les choses serait au contraire de penser que les apiculteurs amateurs sont des passionnés et qu’ils accorderont justement énormément de temps à leur loisir-passion, à bichonner leurs colonies (moins nombreuses que chez les pros), et à mieux comprendre et suivre leur état de santé. La réalité est sans aucun doute entre les deux. Certains amateurs sont particulièrement techniciens dans le plus beau sens du terme, et d’autres professionnels sont à l’autre bout du tunnel, d’un assez faible niveau technique.
Maintenir une ligne de conduite et encadrer le marché reste de toute façon très compliqué dans une filière avec autant de non professionnels. Mais les gens passionnés ont l’avantage de développer une attention très forte. Dans les pays où l’apiculture est gérée de manière beaucoup plus intensive, est ce que les pratiques sont vraiment beaucoup plus propres ? On pourrait arguer que ceux qui arrivent à vivre de l’apiculture sont quand même des gens qui connaissent bien leurs colonies – ils auraient sinon mis la clef sous la porte depuis longtemps (ou sont en passe de le devenir).
Être apiculteur amateur ou professionnel est certainement beaucoup plus difficile maintenant qu’il y a quelques décennies. Les pressions vont grandissant, les aléas et les variabilités sont toujours plus incertains. Le coût des matières premières explose en apiculture, comme le nourrissement par exemple, essentiel dans un contexte de réchauffement, surtout quand il n’y a plus grand-chose à manger (le poids des ruches diminue). L’hivernage des abeilles est rendu plus compliqué par des rythmes de froid plus erratiques (en intensité et en répétition) sur lesquels les abeilles ont du mal à se synchroniser. Les parasites, ceux tout du moins qui devaient mourir par le froid, continuent à se développer. Le risque est élevé d’avoir un réveil très difficile du aux mortalité du printemps 2023. La génétique des abeilles peut ne pas être maitrisée et les colonies peuvent se croiser avec d’autres de ruchers voisins. Les parcours de production impliquent des parcours de suivi (carnet de suivi, traçabilité des transhumances, certification et contrôle). La production de miel bio pour les apiculteurs n’est pas évidente non plus : une bonne moitié minium de la surface en fleurs butinée doit être bio, en friche ou en zone naturelle. Le varroa doit être contenu avec des solutions bios (alors qu’il y a de toute façon toujours des produits phytosanitaires en dispersion un peu partout).
Les abeilles pollinisent une grosse partie des cultures mais les apiculteurs n’ont pas la compétence pour polliniser ; ils amènent les abeilles, un point c’est tout. Peut-être qu’une manière de valoriser leur métier pourrait être d’en connaitre autant que les agriculteurs pour leur apporter un vrai service à valeur ajoutée. Les apiculteurs pourraient conseiller d’amener des bourdons parce qu’ils savent qu’il va faire frais, ou amener des ruches près des parcelles parce qu’ils savent que les parcelles vont fleurir dans les jours à venir.
Les abeilles domestiques font-elles vraiment pression sur les abeilles sauvages ?
Est-ce que la présence des abeilles domestiques impacte vraiment significativement l’abondance et la diversité des espèces sauvages ? La question est un peu touchy et certains auront tendance à dire que le problème n’est pas vraiment là – et que notre regard devrait plutôt se tourner vers le manque de ressources généralisé à disposition pour les abeilles. Si on en revient malgré tout à la question posée, il semblerait que le lien entre les abeilles domestiques et sauvages soit assez intime au regard de la pollinisation. Les abeilles domestiques ne sont en réalité pas toujours les pollinisateurs les plus efficaces de toutes les cultures et il existerait une forte variation dans l’efficacité de la pollinisation des abeilles à la fois entre les espèces et au sein des abeilles domestiques. En réalité, les abeilles sauvages et domestiques, par leurs interactions comportementales multiples, amélioreraient ensemble le niveau de pollinisation dans les parcelles. Et cette capacité est particulièrement importante pour les plantes à fécondation croisée (une fleur pollinisée par le pollen provenant d’une autre fleur) comme le tournesol. Les espèces domestiques, parfois plus spécialisées sur les fleurs mâles ou femelles auraient en effet moins tendance à faciliter la pollinisation croisée alors que les abeilles sauvages, en butinant un peu les deux, augmenteraient la fréquence des transferts des abeilles mellifères des plantes mâles aux plantes femelles. Dans certaines études académiques où les populations d’abeilles domestiques étaient nombreuses, certaines parcelles n’avaient pas vu la totalité de leurs fleurs pollinisées, semblant alors indiquer que la production pouvait être limitée par un manque de pollinisation.
L’abondance et la diversité des communautés d’abeilles sauvages sont souvent associées à une augmentation de la pollinisation des cultures, et c’est d’ailleurs parfois plus la diversité d’espèces que leur abondance qui rentre dans la balance. Les espèces peuvent par exemple être complémentaires pour polliniser différentes parties d’une fleur grâce des taille variées, des langues plus ou moins longues, et des comportements de pollinisation par bourdonnement différents. Certaines cultures ne peuvent tout simplement pas être pollinisées par des abeilles domestiques. On pense par exemple aux fraises et aux tomates qui requièrent une pollinisation par sonication (il faut que l’insecte vibre très fort pour faire tomber le pollen et c’est principalement les bourdons qui font ça.
Malgré tout, la diversité des pollinisateurs (sauvages) ne peut pas prétendre, à elle seule, s’occuper de la pollinisation des cultures entomophiles dans leur ensemble. Même si les abeilles sauvages sont généralement plus efficaces, la diversité des abeilles sauvages qui visitent les cultures entomophiles ne représente qu’un sous-ensemble extrêmement limité des pools d’espèces régionaux, et inversement, l’abondance des espèces d’abeilles sauvages communes est plus importante que leur diversité pour assurer une pollinisation efficace des cultures. Il semble donc en réalité important de bien séparer les deux notions d’abondance et de diversité lorsque l’on s’intéresse aux causes du déclin des pollinisateurs et à leurs différentes interactions entre eux. Souvent, quelques pollinisateurs abondants fournissent la majeure partie des services de pollinisation aux plantes et les réductions de l’abondance de ces espèces communes pourraient être plus perturbantes pour la pollinisation que les pertes de richesse en espèces de pollinisateurs. Ce sont ainsi parfois seulement quelques espèces qui sont responsables de la majorité de la stabilité du réseau. La question de savoir si la perte de ces espèces centrales peut entraîner l’effondrement du réseau reste une question empirique ouverte.
Abeilles des villes ou abeilles des champs ?
Ville ou Campagne ? Il semblerait que nos sentinelles de l’environnement se plaisent plutôt bien en ville. Si certains l’interprètent par la fuite de conditions rurales trop intenses (néonicotinoides, manque de ressources), d’autres l’expliquent plus simplement par le fait qu’en ville, il existe finalement des mosaïques complexes de différentes utilisations des sols et d’habitats écologiques (jardins privatifs, espaces publics, jardins familiaux et communautaires, parcs fleuris, pelouses…). Les riverains et les villes, sensibles à la cause des abeilles, plantent des espèces melliphères (et utilisent parfois aussi des produits de synthèse largement pire que certains utilisés en agriculture). Et les villes regorgent de zones bâties avec des espèces végétales (cimetières, cours d’école, campus universitaires, zones industrielles, toits verts…).
Encore une fois, si l’on tente de prendre un peu de recul, les problèmes soulevés restent un peu les mêmes. Avec trop de ruches en ville, la compétition en ressources sera elle aussi exacerbée (leur nombre et leur localisation est donc à choisir précautionneusement). Rappelez-vous des chiffres donnés en introduction : une abeille explore jusqu’à 3km autour d’une ruche. Le choix des espèces à planter est également important pour que toutes les plantes ne fleurissent pas au même moment (on évitera donc de planter en mono-spécifique…). Les prairies et espaces fleuries avec des espèces ornementales (souvent produites de façon industrielles dans différents pays du monde) sont parfois plutôt à considérer comme des plantes tueuses d’abeilles parce que ces plantes – très vives et attirantes – sont carencées en pollen et épuisent ainsi les abeilles qui passent leur temps à faire des aller-retours.
La présence d’abeilles domestiques ne doit pas se faire au détriment d’une biodiversité plus large où l’on favoriserait une diversité taxonomique réduite, une perte de spécialistes et une surreprésentation de taxons super-généralistes. Les villes devraient surtout avoir la mission d’informer sur l’état des pollinisateurs avec leur ruche en présentiel.
Vers un changement de pratiques agris et autres et une prise de conscience
Il devient fondamental d’instaurer un dialogue entre apiculteur et agriculteurs pour que chaque corps de métier se rende compte de ses pratiques. Dans certains pays, au Québec ou au Canada par exemple, on retrouve des applications de mise en relation entre apiculteur et agriculteurs. Pourquoi n’avons-nous pas ça chez nous ? Le sujet est certainement encore trop tabou. A part quelques forcenés, la quasi-totalité des agriculteurs ne prend pas de malin plaisir à utiliser des produits phytosanitaires…
S’il doit y avoir collision avec la sortie d’un pulvérisateur ou la sortie d’un nouveau produit du marché, il parait normal que les apiculteurs autour soient tenus au courant (et/ou consultés). Si des couverts végétaux sont amenés à être broyés (c’est déjà super qu’il y en ait), le risque est que certaines butineuses soient broyées au passage de la machine. En collectant de l’information sur la pratique des agriculteurs aux alentours des ruches, il devient également plus simple de synchroniser la transhumance des ruches avec la floraison de certaines espèces melliphères. Et l’on peut bien sûr imaginer tout un tas de pratiques de conservation mis en état par les agriculteurs pour favoriser des actions de biodiversité : le renforcement des systèmes agricoles diversifiés existants, l’investissement dans des infrastructures écologiques, l’intensification écologique… Ce n’est pas non plus qu’aux agriculteurs de faire des efforts et il est nécessaire que les apiculteurs, eux aussi, remontent de la donnée sur leurs pratiques en cours parce que les logiciels de gestion parcellaire ne sont pas aussi développés que ceux que l’on peut trouver sur les autres filières végétales et animales.
De nombreuses politiques en place pour le suivi de la biodiversité
Après le tropisme assez inconditionnel sur le carbone (et toutes les méthodes de bilan carbone – je vous renvoie à un autre dossier de blog : https://www.aspexit.com/la-course-au-carbone-en-agriculture/), c’est maintenant la biodiversité qui commence à rameuter toutes les foules (et sans être un très grand prophète, on devrait passer sur l’eau dans pas très longtemps). En France, l’article 29 de la loi Energie Climat de 2019 impose aux investisseurs un reporting sur la biodiversité. Des réglementations commencent à arriver, notamment au niveau européen avec la Taxonomie Verte, la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pour cadrer le reporting, la transparence et l’intégration des impacts et des dépendances de la biodiversité dans la gestion des entreprises. Les acteurs qui ont élaboré les reporting sur le climat sont aussi souvent ceux qui s’investissent maintenant sur la biodiversité.
Les approches de suivi des impacts sur la biodiversité commencent à arriver à un peu tous les niveaux, déjà au niveau public (Globio, ABD Index, LPI), et au niveau privé (notamment la méthode GBS du CDC Biodiversité) en plus des méthodes plus générales des analyses du cycle de vie. Ces approches proposent des indicateurs agrégés ou non, des évaluations dynamiques ou non de l’état de la biodiversité, et s’intéressent généralement soit à une abondance en espèce (MSA pour Mean Species Abundance) ou à des fonctions écosystémiques potentiellement disparue (PDF pour Potentially Disappeared Function). Ces métriques peuvent également être transposées à une unité de surface en les multipliant par une surface impactée.
Suite à un vote à l’Assemblée nationale en 2021, l’abeille est devenue la grande cause nationale de l’année 2022. Réjouissons-nous même si, comme je l’ai répété plusieurs fois dans ce dossier, l’appel à sauver les abeilles ne doit pas masquer l’énorme complexité qui se cache derrière un déclin mondial des insectes. Si l’on ne s’intéresse qu’à la sortie de nouvelles politiques et propositions de loi, on pourrait croire que la biodiversité est une cause acquise. La France fait notamment état
- d’un plan ABC (atlas de la biodiversité communale) pour aider à réaliser des inventaires locaux sur les territoires,
- d’un plan biodiversité lancé par le gouvernement en 2018,
- d’un plan national d’actions (PNA) « France Terre de pollinisateurs » sur la période 2016-2020,
- d’un plan pollinisateur national sur la période 2021-2026 pour lequel chaque région devra déployer ses propres déclinaison.
- Une stratégie nationale Biodiversité 2030
Dans le cadre de son plan de relance, la France a également lancé son plan d’action PACTE pour la biosécurité et le bien-être animal. De là à savoir s’il n’y a pas de redondance et de chevauchement, c’est une autre histoire.
Au niveau européen, même combat :
- la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CBD) a lancé son initiative internationale sur les pollinisateurs avec un plan mis à jour sur la période 2018-2030 – initiative qui a donné lieu à tout un tas de plans d’actions et de stratégies nationales dont la stratégie nationale Biodiversité 2030 de la France et internationales.
- La Commission a également lancé en 2020 la ruche d’informations sur les pollinisateurs de l’Union Européenne pour recenser, sur une plateforme web commune, les actions de conservation des pollinisateurs sauvages.
- Le règlement européen « Loi de Santé Animale » (LSA) devrait également impliquer les acteurs de la filière apicole dans une démarche plus globale « One health » – une seule santé ».
- On pourra également mettre en avant le plan d’action Zéro Pollution (eau, air, et sol) qui, indirectement, servira lui aussi à la protection des insectes.
- Assez original, a Commission Européenne a également lancé l’initiative Pollinator Park pour immerger artificiellement (en réalité virtuelle) la population dans un monde sans abeille.
- Citons également quelques projets d’envergure : https://b-good-project.eu/ piloté par l’Université de Wageningen et https://worldbeeproject.org/
Les programmes européens de soutien à la filière apicole devraient également voir le jour dans les déclinaisons des plans stratégiques nationaux (PSN) de la PAC (politique agricole commune – on parle de PSN PAN) avec tout un tas de mesures existantes ou à pousser. On pense par exemple à la conditionnalité (maintien d’un surface minimum pour des éléments favorables à la biodiversité : jachères melliphères, des prairies permanentes, des zones humides, des bandes tampons le long des cours d’eau ou encore des prairies sensibles), aux éco-régimes, à la labellisation HVE (Haute Valeur Environnementale), ou encore plus spécifiquement aux mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) qui ont leur petite déclinaison en apiculture (MAEC API). Ces mesures spécifiques poussent à l’implantation de mélanges favorables au développement des insectes pollinisateurs ainsi que les engagements améliorant le potentiel pollinisateur des abeilles. On pourra néanmoins toujours s’inquiéter des avis critiques de l’Autorité Environnementale (Ae) sur l’ambition du PSN PAC de la France…
Comme le rappelle néanmoins l’IPBES, la mise en oeuvre de nombreuses mesures au bénéfice des pollinisateurs n’est pas si évidente que ça. Des unités administratives multi-niveaux qui ne communiquent pas forcément bien entre elles, ou encore le décalage entre la diversité des pratiques à l’échelle locale et l’homogénéisation des politiques gouvernementales à une échelle plus globale nuisent très clairement à la mise en place des pratiques. Les objectifs politiques entre secteurs sont encore assez contradictoires… On pourra citer un travail intéressant de chercheurs qui ont recensé l’ensemble des politiques infranationales adoptées par les législatures des États américains entre 2000 et 2017 sur les insectes pollinisateurs (Hall & Steiner, 2020). Rajoutons que l’efficacité de ces initiatives n’est en grande partie pas testée et certaines ont le potentiel d’affecter négativement les pollinisateurs et les plantes indigènes qui leur sont associées. On peut penser par exemple aux hôtels à abeilles qui pourraient en réalité être principalement utilisés par des abeilles invasives et peuvent même augmenter l’abondance des guêpes invasives au détriment des abeilles indigènes. Autre initiative souvent mise en avant : la plantation de fleurs connues pour attirer les pollinisateurs mais qui sont souvent introduites dans des zones (bande naturelle, jardins urbains…) sans nécessairement regarder en amont la proportion d’espèces indigènes présentes dans ces endroits-là, et donc potentiellement menacées par cette introduction.
Les données manquantes sur l’état des insectes pollinisateurs empêchent d’établir des listes rouges solides et de remplir correctement les critères de l’UICN pour évaluer le niveau de menace pesant sur les espèces de pollinisateurs. Sans ces listes, il est d’autant plus difficile d’intégrer les problématiques de conservation des pollinisateurs dans les politiques publiques d’aménagement et de préservation de la nature.
Notre anthropocentrisme autour de l’abeille
La biodiversité est encore très vue comme une charge ou une dépense pour le commun des mortels. Il semble toujours y avoir cette notion d’obligation de devoir porter de l’intérêt à la biodiversité (par exemple dans les dossiers d’évaluation environnementale). Nous considérons encore beaucoup trop la biodiversité non pas pour ce qu’elle est mais pour ce qu’elle apporte pour l’homme. Les fameux services écosystémiques – d’ailleurs largement critiqués par de nombreux auteurs – sont servis à toutes les sauces et sont utilisés comme ligne de défense dès lors que l’on pourrait questionner les actions de telle entreprise ou collectivité.
L’apiculture est à la mode et la tendance est à l’installation de ruches à tout va sur les toits, parcs naturels ou encore sur les sites protégés. Tout un tas d’acteurs s’en donnent à cœur joie et les arguments marketing des professionnels de la RSE et du greenwashing profitent de l’engouement généralisé et de l’enthousiasme du public à sauver les abeilles. Les effets d’annonce et les promesses technologiques sont également nombreux et assez largement soutenus à leur départ. Mais tentons-nous réellement de sauver les abeilles ?
Les campagnes publicitaires poussant au sauvetage des abeilles et les efforts en matière de sensibilisation et vulgarisation sont bien évidemment à saluer. Ils ont servi la cause et ont permis de rendre l’abeille attractive, de diminuer la peur de ces potentiels piqueurs, et ont augmenté l’intérêt et la volonté de protéger les abeilles. Plusieurs syndicats ont une volonté forte de sensibiliser autour d’eux avec des kits pédagogiques (numériques ou non) et en installant des ruchers écoles un peu partout. Très honnêtement, qui n’a pas envie d’aider Maya l’Abeille ? Mais ces actions de sensibilisation sont-elles assez suffisamment nombreuses ? Les médias ne semblent pas être d’un appui particulièrement solide. Certains chercheurs montrent par exemple que le sujet des pollinisateurs suscite beaucoup moins d’attention dans les médias que le déréglement climatique – qui n’est déjà pas particulièrement mis en avant. Les articles sur les populations de pollinisateurs resteraient encore largement marginalisés dans les rapports scientifiques et les dernières sections des médias classiques.
En réalité, les apiculteurs et les installateurs de ruches reproduisent une espèce domestiquée. Et l’appel à sauver les abeilles pourrait être interprété comme un appel à stabiliser notre agriculture industrialisée actuelle tant les insectes pollinisateurs ont un rôle important dans le succès de nos productions agricoles.
J’introduisais au début de ce blog la quantité absolument fascinante d’espèce d’abeilles, tellement plus large que les seules abeilles à miel qui sont sur le devant de la scène. La majorité des insectes sont invisibles pour le grand public et ce phénomène d’invisibilité est transposé à la science – les insectes sont beaucoup moins étudiés que les vertébrés. Nous sommes ignorants sur la diversité réelle des abeilles et l’appel généralisé à sauver les abeilles (domestiques) masque la complexité du déclin mondial des insectes (je vous renvoie à la section du dossier de blog correspondante) et cache des enjeux de biodiversité qui sont beaucoup plus grands que nous. C’est un peu comme si nous comparions le travail des ornithologues à l’étude des poulets. L’apiculture et l’apidologie sont un peu plus que les simples abeilles à miel…
Certains travaux en biotechnologie s’efforcent de réduire la demande en pollinisateurs, c’est-à-dire de limiter la dépendance des variétés de cultures vis-à-vis de la pollinisation par les insectes. On pense par exemple à la parthénocarpie, ce phénomène qui offre la capacité aux plantes de produire des fruits sans fécondation – et donc sans besoin de pollinisation extérieure ; avec la possibilité d’ailleurs de l’améliorer via la sélection ou les travaux de génétique.
Nous devons également nous inquiéter de toute action transhumaniste. Quand l’on sait que des millions d’années d’évolution auront permis d’améliorer la pollinisation par les plantes et les insectes, doit-on réellement essayer de se substituer à la nature et de se tourner vers le transhumanisme ? J’avais déjà commencé à aborder ce sujet dans un précédent dossier sur la robotique – certains robots (il n’y en a pas énormément non plus) étant justement mis en avant pour leur capacité remplacer la pollinisation des insectes. Certains pensent également au développement d’abeilles robotisées – avec des touches de dystopie à la série à succès Black Mirror, mais lorsque l’on s’y penche d’un peu plus près, les contraintes de coût, de faisabilité, d’efficacité ou encore d’éthique apparaissent très compliquées à surmonter.
Même si l’on peut imaginer qu’il existe effectivement des moyens et méthodes à court terme pour pallier un manque de pollinisation, on ne peut décemment pas penser que l’on pourra compenser à long terme une perte chronique des services de pollinisation. Peut-on imaginer un seul instant de toute façon le coût que représenterait une pollinisation à la main quand on voit les milliers d’heures de vol de nos chères sentinelles de l’environnement ? La Chine en fait les frais sur certaines cultures mais comment croire un seul instant que cette solution n’est pas vouée à l’échec.
L’étude des services écosystémiques et les propositions de conservation sont des quêtes anthropocentriques. Mais est-ce finalement tant un problème que ça ? Ce sont peut-être ces dimensions humaines, sociales et culturelles qu’il nous faut activer en premier lieu pour faire (ré)agir la population et entreprendre un véritable changement pour s’assurer de la diversité et de l’abondance des insectes de manière générale. Les premiers à bénéficier des services écosystémiques sont la faune et la flore eux-mêmes. Nous ne devons pas l’oublier.
En guise de conclusion
Si la première image du numérique en apiculture reste celle d’une filière jouant avec des balances et des capteurs de température, une analyse plus en profondeur montre toute la diversité des outils numériques à disposition. Les outils opérationnels se concentrent encore très principalement sur l’apiculture en tant que tel et indirectement la production de miel avec surtout des intérêts logistiques (éviter les allers-retours inutiles, baisse des charges de carburant, suivi à distance…). Il n’y a pas vraiment à craindre une numérisation complète des ruchers tant il reste difficile d’automatiser une grande partie du travail des apiculteurs. Et de toute façon, comme la filière est principalement représentée en nombre par des amateurs et des passionnés, on peut difficilement imaginer une automatisation complète.
Promesse est faite d’avoir des outils pour une biosurveillance plus large de l’environnement même si, comme nous l’avons vu, le suivi fin des insectes et le déclin des pollinisateurs est particulièrement complexe à appréhender. Entre des enjeux multifactoriels, additifs, colinéaires ou encore confondants, les outils numériques seront certes utiles pour naviguer et y voir plus clair mais ils ne sont pas la panacée. Les outils numériques doivent aider à sortir du prisme de l’abeille comme individu pour aller vers des approches paysagères et territoriales plus larges, et notamment pour suivre des pratiques sanitaires de manière coordonnée, ou encore discriminer les territoires et les facteurs d’influence de l’état de santé des colonies. Mais sommes-nous prêts à mettre de l’argent pour ça ?
L’abeille est une vitrine sans commune mesure sur le vivant. C’est à la fois une espèce phare (suscitant l’adhésion du public), une espèce parapluie (dont les besoins en matière de conservation protègent accessoirement d’autres espèces), une espèce indicatrice (sensible aux changements/dégradations) et une espèce clé (dont l’impact écologique est disproportionné par rapport à son abondance). Le public est prêt à sauver les abeilles, et nous devons jouer sur les dimensions humaines, sociales et culturelles pour aller plus loin et faire (ré)agir la population et entreprendre un véritable changement pour s’assurer de la diversité et de l’abondance des insectes de manière générale. La propension généralisée à sauver les abeilles ne doit pas nous faire oublier toute la diversité des espèces de pollinisateurs et d’insectes.
Le manque de données et notre méconnaissance de l’ensemble des processus en jeu ne doit pas nous empêcher d’agir. Nous n’avons plus le temps de simplement continuer à « compter les livres pendant que la bibliothèque brûle ». La surveillance des pollinisateurs et les activités de recherche (avec les outils numériques ou non) doivent s’inscrire dans des actions de planification et de gestion à tout un tas d’échelles spatiales.
Encore une fois, la majorité du tropisme actuel se concentre sur le déréglement climatique. Même si l’enjeu est louable, nous ne pouvons et ne devons pas oublier le vivant. La crise du vivant et de la biodiversité devrait beaucoup plus nous inquiéter que la « simple » crise climatique. Toutes les actions de sauvegarde du vivant sont également bénéfiques pour le climat – la réciproque étant nettement moins vraie.
Bibliographie complémentaire aux entretiens
Allier, F., et al. (2022). MIELLEES – Le Système Informatique (SI) MIELLEES, un outil de mutualisation des données des balances connectées de ruches pour décrire les miellées. Innovations Agronomiques, 85
Althaus, S.L., et al. (2020). No buzz for bees: Media coverage of pollinator decline. PNAS, 118, 2
Baldock, K.C.R (2020). Opportunities and threats for pollinator conservation in global towns and cities. Current Opinion in Insect Science, 38, 63-71
Bota, G., et al. (2022). Passive acoustic monitoring for estimating human-wildlife conflicts: The case of bee-eaters and apiculture. Ecological Indicators, 142
Bromenshenk, J.J et ak. (2015). Bees as Biosensors: Chemosensory Ability, Honey Bee Monitoring Systems, and Emergent Sensor Technologies Derived from the Pollinator Syndrome. Biosensors, 5, 678-711
Cameron et al., (2009). Patterns of widespread decline in North American bumble bees. PNAS, 108, 2
Decourtye, A., et al. (2019). La ruche connectée : labeille sous surveillance numérique. CAIRN.INFO. Sciences, eaux & Territoires, 29
Decourtye, A., et al. (2019). Toward the protection of bees and pollination under global change: present and future perspectives in a challenging applied science. Current Opinion in Insect Science, 35, 123-131
Dicks, L.V., et al. (2021). A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. Nature Ecology & Evolution.
European Commision (2020). FUTURE BRIEF: Pollinators: importance for nature and human well-being, drivers of decline and the need for monitoring. Science for Environment Policy, 23
France Agrimer (2022a). Observatoire de la production de miel et gelée royale 2022 (données 2021) https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Apiculture/2022/Retrouvez-la-synthese-de-l-etude-observatoire-de-la-production-de-miel-et-de-gelee-royale-donnees-2021
France Agrimer (2022b). Apiculture – Fiche Filière : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68209/document/FICHE%20FILIERE%20APICULTURE%202022.pdf?version=4
Greenleaf, S.A. & Kremen, C. (2006). Wild bees enhance honey bees’ pollination of hybrid sunflower. PNAS, 103, 37
Hadjur, H., et al. (2022). Toward an intelligent and efficient beehive: A survey of precision beekeeping systems and services. Computers and Electronics in Agriculture, 192
Hall, D.M. & Martin, D.J. (2020). Human dimensions of insect pollinator conservation. Current Opinion in Insect Science, 38, 107-114
Hall, D.M. & Steiner, R. (2020). Policy content analysis: Qualitative method for analyzing sub-national insect pollinator legislation. MethodsX, 7
IPBES (2016). Rapport d’évaluation sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Résumé à l’intention des décideurs.
IPBES-IPCC (2021). Co-sponsored workshop biodiversity and climate change. Scientific outcome.https://ipbes.net/sites/default/files/2021-06/2021_IPCC-IPBES_scientific_outcome_20210612.pdf
Knight, T.M., et al. (2018). Reflections on, and visions for, the changing field of Pollination Ecology. Ecology Letters, 21, 1282-1295
Meikle, W.G., and Holst, N. (2015). Application of continuous monitoring of honeybee colonies. Apidologie,
Ministère de la transition écologique & Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (2021). Plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 2021-2026, 96p
Lettman, M., & Chauzat, M-P. (2018). Les outils connectés en apiculture : évaluation de leurs applications auprès des apiculteurs français, Anses
Marchal, P., et al. (2020). Automated monitoring of bee behaviour using connected hives: Towards a computational apidology. Apilodogie
Mollier, P. et al. (2009). Le déclin des abeilles, un casse-tête pour la recherche. INRA Magazine, n°9
Panziera, D., et al. (2022). The Diversity Decline in Wild and Managed Honey Bee Populations Urges for an Integrated Conservation Approach. Frontiers in Ecology & Evolution, 10
Perry, C., et al.J. (2016). Unexpected rewards induce dopamine-dependent positive emotion–like state changes in bumblebees. Science, 353, 6307
Potts, et al. (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution, 25, 6
Ruckelshaus, M.H., et al. (2020). The IPBES Global Assessment: Pathways to Action. Trends in Ecology & Evolution, 35, 5
Sanchez-Bayo, F., and Wyckhuys, K.A.G (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation, 232, 8-27
Van Klink, R., et al. (2020). Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances. Science, 368, 417-420.
Zacepins, A. et al. (2015). Challenges in the development of Precision Beekeeping. Biosystems Engineering, 130, 60-71 Zattara, E.E, & Aizen, M.A. (2021). Worldwide occurrence records suggest a global decline in bee species richness. One Earth, 4, 114-123
Personnes Interviewées
| NOM | STRUCTURE |
| Dominique CASSOU RIBEHART | Des Abeilles et Nous |
| Alexandre DANGLEANT | Itsap |
| Arnaud ELGER | CNRS |
| Bertrand LAURENTIN | Apiculteur |
| Yves LECONTE | INRAE Avignon |
| Mathieu LIHOREAU | CNRS – Centre de recherche sur la cognition animale |
| Christian LUBAT | Beeguard |
| Lorenzo PONS | Mellisphera – Broodminder |
| Maurice RIVIERE | Abeille et Sagesse & Apiculteur |
| Charles VALLET | Beeodiversity |
D’autres structures ont été contactées mais les interviewés n’ont pas souhaité être nommés
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee
4 commentaires sur « Numérique & Apiculture : des promesses pour la production apicole et la bio-surveillance de l’environnement »