Après un premier tropisme généralisé sur le carbone et un second sur la biodiversité, il semblerait que l’eau soit la prochaine invitée sur le podium. Une conférence des Nations-Unies sur l’eau a eu lieu fin mars 2023 à New York (la dernière date d’il y a 50 ans) à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Le gouvernement français a lancé son Plan National Eau en début 2023. Et on ne compte plus les évènements et salons organisés en 2023 sur la thématique de l’eau.
Avec le phénomène El-Nino exceptionnel annoncé (très grande probabilité d’occurrence) pour la rentrée de septembre 2023, il est certain que le sujet n’est pas près de sortir de l’actualité.
En France, les sécheresses impressionnantes de la mi-2022 auront enfin mis tout le monde d’accord. On commence à avoir un sérieux problème… En témoignent les arrêtés préfectoraux dans la quasi-totalité des départements français et la livraison d’eau en bouteille dans plusieurs communes à l’été 2022. Hé oui, les ennuis commencent chez nous. Ca n’est pas faute d’avoir été alertés. L’état des nappes phréatiques en mai 2023 est assez critique dans certaines localités françaises, notamment sur le pourtour méditerranéen, même si l’absence de pluie pendant les mois de févriers/mars laissait présager des sécheresses bien plus terrifiantes.
Pour autant, sommes-nous vraiment légitimes en France pour parler du manque d’eau – j’entends bien par-là vraiment manquer d’eau ? Nous ne savons pas réellement ce que manquer d’eau veut dire. Nous commençons à peine à l’effleurer du doigt.
Le secteur agricole est de loin le secteur le plus consommateur en eau pour l’irrigation des cultures. En France, je rappelle néanmoins que seules 7% des surfaces cultivées sont irriguées en 2020, et cette irrigation est assez inégalement répartie sur le territoire, à la fois d’un point de vue spatial, mais aussi d’un point de vue cultural (certaines cultures comme le maïs, le soja ou les pommes de terre sont souvent irriguées). La gestion de l’eau ne se résume donc bien évidemment pas uniquement à l’irrigation.
Les outils numériques sont une des solutions parmi d’autres pour améliorer le pilotage de l’irrigation et l’efficacité d’utilisation de l’eau en agriculture. Ces outils numériques peuvent notamment :
- appuyer l’observation et la mesure de l’eau dans les compartiments du sol, de la plante, ou de l’atmosphère (connaissance de la ressource), et sur les pratiques agricoles (connaissance des pratiques et de leurs impacts)
- appuyer le pilotage de l’irrigation au travers de modélisations diverses et variées et d’aide à la décision (optimisation des systèmes d’irrigation à la parcelle et de gestion de réseau)
- appuyer le partage et la gouvernance de l’eau à différentes échelles spatiales (diffusion de l’information et appui à la concertation)
A l’heure actuelle, ces outils numériques servent en grande majorité à appuyer l’irrigation. C’est déjà bien évidemment une très bonne chose au regard de l’exigence que nous devons avoir sur cette ressource rare mais encore une fois, la quantité de surface cultivée irriguée reste minoritaire au regard de la quantité de surface cultivée non irriguée.
Ce dossier sur l’eau a également des liens étroits avec deux dossiers précédents, respectivement sur le stockage de carbone dans les sols agricoles, et le pilotage de la fertilisation azotée
Ce dossier sur l’eau est également l’occasion de valoriser toute la connaissance qui commence à être capitalisée sur l’annuaire des outils numériques pour l’agriculture. En plus de servir la veille collaborative, cette plateforme est maintenant utilisée pour prendre du recul sur les outils numériques en place et de dégager des tendances.
Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles scientifiques, rapports techniques, sites web, et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.
Bonne lecture !
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee
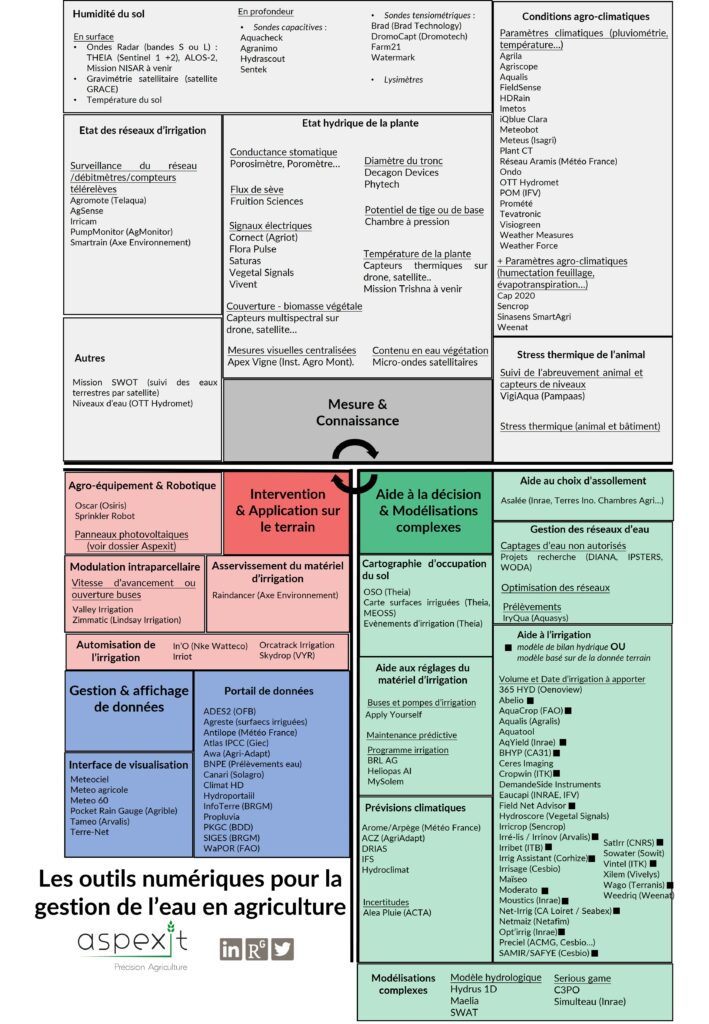
Préambule important
Comme à mon habitude, j’insiste sur le fait que j’arrive sur cette thématique de l’eau avec beaucoup d’humilité. Je suis agronome de formation – j’ai donc bien évidemment une sensibilité particulière pour le sujet – mais je ne suis ni hydrologue, ni hydrogéologue, et encore moins climatologue. J’apporte ici ma prise de recul et mes capacités de synthèse faisant suite à de nombreuses lectures et échanges avec des professionnels de la thématique.
Ce dossier se concentre sur la ressource en eau d’un point de vue quantitatif. L’aspect qualitatif est bien évidemment évoqué lui aussi mais dans une bien moins grande mesure. Une figure valant mille mots, vous ne serez pas surpris de voir de nombreuses cartes, schémas et graphiques présents dans ce dossier, certainement beaucoup plus que d’habitude. Au vu de l’inquiétude très récente sur le manque d’eau à venir, on trouve en ce moment une quantité absolument gigantesque de ressources en tout genre dans le domaine de l’eau, le tout sur un fonds d’actualité assez musclé. Ce dossier sur l’eau tombe donc à point nommé.
Je terminerai en rappelant que je rédige des dossiers de vulgarisation et non pas des articles scientifiques (même si j’ai pu en écrire dans le passé). Ces dossiers sont néanmoins largement creusés et fouillés. Ils sont la synthèse (parfois à peine remaniée) de ce que j’ai pu lire et/ou écouter de mes interviewés. La vulgarisation n’est pas pour moi une simplification outrancière de la réalité mais bien une façon de rendre la science plus accessible. J’essaye de rendre ce travail au maximum objectif même si je reste forcément engagé dans mon écriture.
Merci de bien garder ça en tête tout au long de la lecture de ce travail !
L’eau, une première entrée en matière
Quelques ordres de grandeur
A l’échelle du globe, l’eau ne manque pas – elle représente d’ailleurs une part largement prépondérante de la surface disponible.
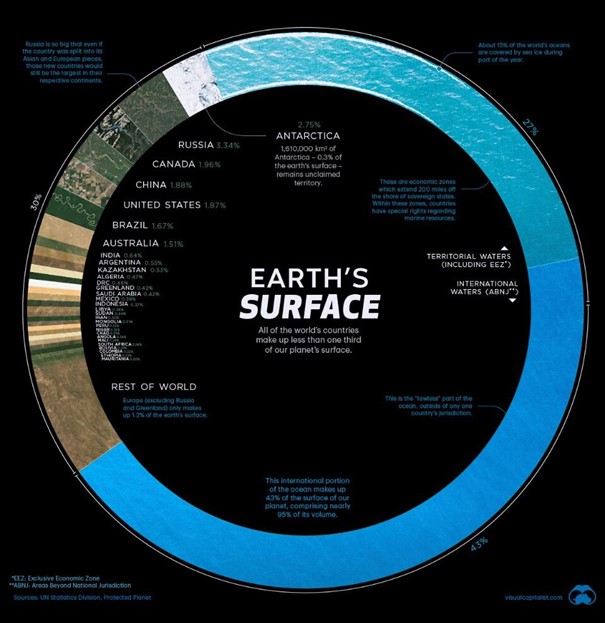
Figure 1. Répartition de l’eau à la surface de la Terre. Sources : UN Statistics Division.
Mais la quasi-totalité de cette eau – 97% – est en réalité salée (Fig. 1). Seule 3% de cette eau est qualifiée d’eau douce. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle est disponible pour nos usages. Les trois-quarts de ces 3% d’eau douce sont matérialisés dans les glaciers. Près du quart restant est présent dans le sol (dans le sol directement ou dans les nappes phréatiques – ces grandes poches d’eau présentes dans le sous-sol) et sera utilisé en parti par les plantes pour pousser si tant est qu’elles arrivent à la récupérer – nous en reparlerons plus loin. Une infime partie, 1% (nous parlons bien ici de 1% des 3% précédents, c’est-à-dire 0.03% de l’eau disponible sur terre), est présente dans les lacs (Figure 2), rivières ou encore dans l’atmosphère (et finira par retomber sous forme de pluie).
Cette eau est, sans grande surprise, inégalement répartie sur les territoires – que ce soit d’un point de vue hydro-géologique (en tant que présence naturelle) mais aussi anthropique (infrastructures en place, main mise sur l’eau, guerres d’accès à l’eau etc…)
L’eau a la propriété de pouvoir être stockée. Elle l’est d’ailleurs naturellement dans quatre principaux réservoirs naturels :
- La neige, dont la fonte génère un écoulement longtemps après sa chute, permet de soutenir les débits estivaux du Rhin, du Rhône et de la Garonne. De manière plus générale, la cryosphère (glaciers, couverture neigeuse, calottes glaciaires et, le cas échéant, pergélisol) est le plus grand réservoir naturel d’eau douce à l’échelle mondiale. Elle est essentielle pour la grande majorité de nos usages. Les montagnes peuvent être considérées comme des châteaux d’eau naturels car elles sont à l’origine de nombreux cours d’eau.
- Le sol, réservoir d’eau naturel très important par sa surface, est même la première source d’eau pour la végétation.
- Les nappes souterraines, qui peuvent stocker des volumes d’eau très conséquents, et contribuent à alimenter en eau les rivières.
- Les lacs naturels.
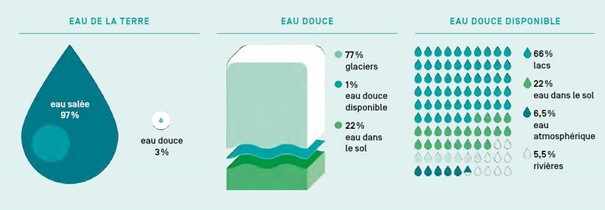
Figure 2. Répartition de l’eau sur terre. Source : Inrae (2022).
La géologie française est constituée d’une grande variété de types de roches, ce qui se traduit par des types d’aquifères très différents, allant des bassins sédimentaires aux plaines alluviales, en passant par les roches calcaires et les roches cristallines. On compte plusieurs milliers de nappes en France hexagonale, de taille très variable (les nappes les plus importantes étant la nappe de Beauce et la nappe rhénane), dont 650 sont suffisamment significatives pour faire l’objet d’une surveillance par des piézomètres. En France, les deux tiers du volume d’eau prélevé en vue de l’alimentation en eau potable sont d’origine souterraine. Les ressources en eaux souterraines représentent également 31 % de l’approvisionnement en eau industrielle et 37 % de l’utilisation totale de l’eau dans l’agriculture.
Les aquifères apportent plusieurs services dont :
- Production d’eau de qualité en quantité et d’une eau distribuée parce que les aquifères sont distribués sur l’ensemble du territoire. C’est un peu comme un réseau de distribution d’eau fourni par la nature, contrairement aux eaux de surface qui ne sont disponibles que sur le chevelu hydrographique.
- Production d’eau et de fourniture d’eau aux écosystèmes aquatiques dépendants des eaux souterraines. Les écosystèmes de zones huies, lacs, lagunes etc qui sont dépendant des eaux souterraines, dépendent de l’aquifère qui les alimente.
- Capacité, en période de pluie, à réduire les inondations en infiltrant une grande partie de l’eau qui pourrait ruisseler (sorte de service de régulation des inondations)
Les eaux souterraines comme les eaux de surface ne connaissent pas de frontières. 592 aquifères transfrontaliers sont identifiés, y inclus 226 masses d’eaux souterraines transfrontalières. Comme dans le cas du droit national, le droit international de l’eau s’est d’abord consacré aux eaux de surface. Quelle que soit l’étendue de l’aquifère, national ou s’étendant au-delà des frontières, le droit national a toute son importance car c’est à cette échelle que l’eau est gérée. En d’autres termes, même dans le cas d’une eau transfrontalière, l’eau reste gérée par le droit national, et ses dispositions doivent permettre d’appliquer le droit international, et ce qui peut être décidé par la commission de gestion ou l’autorité conjointe s’il en existe une.
Le sujet des eaux souterraines est souvent invisibilisé car ces eaux sont invisibles – et les conflits sont également assez peu rendus publics. En France, l’EFESE a défini 6 types d’écosystèmes (forestier, agricole, aquatique, cotier, montagneux, urbain…) mais s’est arrêté à la sub-surface. Le sous-sol et les aquifères n’ont pas été considérés. En les oubliant, le parti pris est de dire qu’indirectement, les aquifères ne seront pas impactés par les activités humaines mises en place (changement d’occupation du sol ou autre…), avec ainsi le risque de perdre une partie des services écosystémiques rendus par les aquifères
En France, une problématique importante est liée à la pollution des nappes. Selon la directive-cadre européenne sur l’eau, environ 33 % des masses d’eau souterraines étaient considérées en bon état chimique et 10 % en mauvais état quantitatif en 2013 (les agences de l’eau ont produit un nouvel état des lieux des nappes avec les 6 schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE 2022-2027). Ces pollutions peuvent être diffuses et sur de larges étendues (comme pour les nitrates ou les pesticides) ou être plutôt locales comme c’est le cas pour les sites industriels ou les stations d’épuration où, même si les effluents sont généralement bien traités en France, on retrouve toujours un peu un peu d’azote, de pathogènes et micropolluants (médicaments, phytos…) en cherchant bien. Ces pollutions, en se disséminant, se diluent voire se transforment et, en tout état de cause, ne disparaissent pas entièrement de notre environnement. Il faut quand même rappeler que la France a considérablement renforcé ces dernières années son arsenal de contrôle des pollutions des milieux aquatiques.
Une bonne partie des eaux souterraines n’a pas besoin d’être traitée. En France, la plupart des châteaux d’eau qu’on voit dans les campagnes sont reliés à des forages qui extraient directement l’eau brute. Les gestionnaires mettent un peu de chlore pour empêcher la prolifération de bactéries et l’eau qui est distribuée dans le robinet, hormis ce chlore qui a été ajouté, est l’eau directement tirée de l’aquifère.
Les cycles de l’eau – grands incompris de notre temps
L’eau n’est pas un minerai que l’on serait en mesure d’extraire à un endroit donné et de transporter n’importe où sur la planète. L’eau change régulièrement d’état – les états solide, liquide et gazeux (glace, neige, eau atmosphérique, eau de rivière..) et se déplace entre les trois grands compartiments de la planète : l’atmosphère, les continents, et les océans. Notez bien que ces compartiments sont connectés et interdépendants – l’eau se déplace bien continuellement des uns aux autres. Et les masses d’eau déplacées sont absolument gigantesques. On parle ainsi de cycles de l’eau en ce sens que l’eau, en changeant d’état, reviendra à un moment ou un autre dans son état initial mais pas forcément toujours au même endroit ni sur les mêmes périodes de temps (Figure 3). Gardez bien en tête que le cycle de l’eau est un cycle fermé. Il n’y a pas d’apports ni de pertes à l’extérieur de la planète. Cette notion de cycle fermé peut servir à questionner les soi-disants discours autour de la perte d’eau (suite à des usages agricoles par exemple).
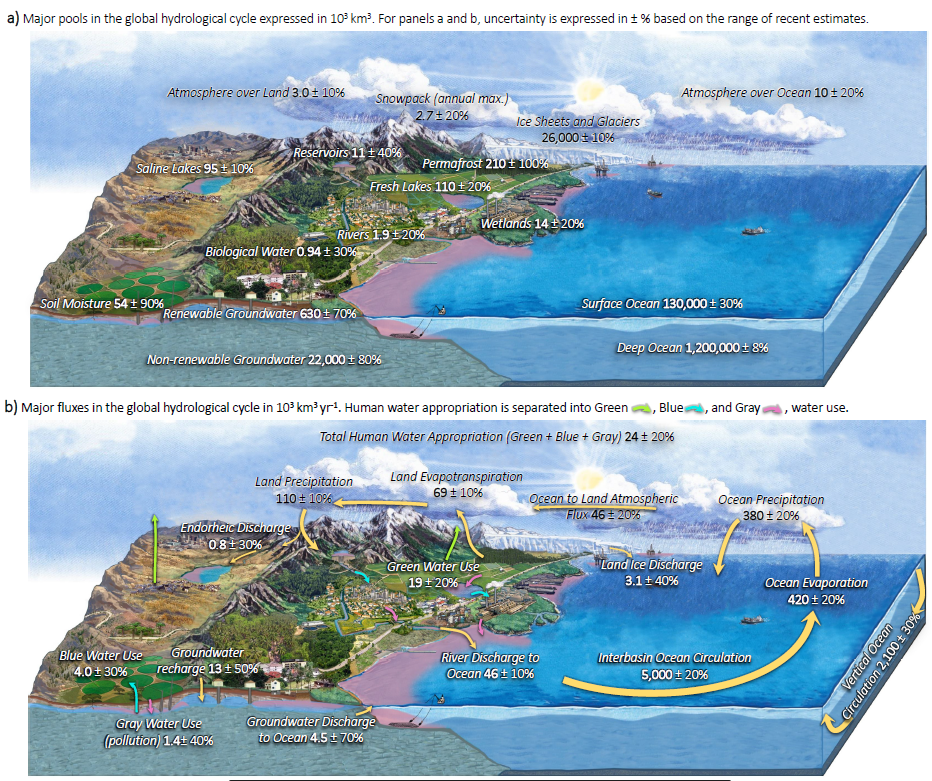
Figure 3. Les grand et petit cycles de l’eau. Source : Abbott et al. (2019). L’appropriation de l’eau par l’humain (le petit cycle de l’eau) y est représentée par les eaux vertes, bleues et grises.
La notion de cycle de l’eau peut vous apparaitre familière parce qu’elle vous a été enseignée très tôt en tant que jeune enfant. On vous a très joyeusement présenté les phénomènes d’évaporation ou encore de précipitation de l’eau et, plus tard dans votre parcours scolaire, vous aurez mis en relation ces termes là avec les changements d’état de l’eau (fusion, liquéfaction, sublimation, etc…). La notion de « grand cycle de l’eau » fait ainsi référence au cycle naturel de l’eau, celui qui existait avant l’intervention de l’humain. Le « petit cycle de l’eau », quant à lui, renvoie plutôt à un cycle domestiqué de l’eau, dans lequel on retrouve l’ensemble de nos infrastructures de captage, d’assainissement et d’approvisionnement d’eau.
Certains scientifiques parlent plutôt de petit cycle de l’eau dans le sens d’un cycle continental ou d’un cycle local par opposition au cycle global incluant les océans mais il n’est pas certain ici qu’ils considèrent les activités humaines. Tout comme il existe un petit cycle de l’eau sur la terre, il existe également un petit cycle de l’eau sur les mers et les océans. Des interactions mutuelles ont lieu entre les différents petits cycles de l’eau car ils se produisent dans l’espace et dans le temps sur de vastes zones présentant des morphologies et des surfaces différentes, avec des niveaux d’humidité et d’eau de surface variables. La circulation de l’eau dans le petit cycle de l’eau est donc partiellement horizontale (ruissellement, écoulements…), alors que dans celle du grand cycle de l’eau, le mouvement vertical est certainement le plus caractéristique (précipitation, évaporation…).


Figure 4. Zooms sur les petits et grands cycles de l’eau.
Plusieurs voix s’élèvent pour mettre en avant qu’il n’existerait pas un seul cycle de l’eau (le grand et le petit cycle étant souvent considérés ensemble) mais plutôt une foultitude. L’hydrologue Emma Haziza témoignait par exemple récemment à la radio qu’il y aurait des milliards de milliards de cycles de l’eau en ce sens que chaque goutte d’eau aurait son propre chemin et évoluerait suivant ses rencontres, ses changements d’état au gré des milieux qu’elle croiserait. Même si l’image est parlante, je vous propose plutôt de prendre un peu de recul en vous donnant à voir quelques cycles de l’eau plus ou moins imbriqués les uns dans les autres.
- Les « grands » et « petits » cycles de l’eau que je vous ai rapidement évoqués correspondent au cycle de l’eau « bleue », c’est le cycle classique que nous connaissons globalement tous.
- Comme nous, pour réguler leur température, les plantes transpirent. On parle en général plutôt « d’évapotranspiration » parce que nous avons tendance à synthétiser à la fois l’évaporation de l’eau du sol et de la transpiration de l’eau des plantes (eau qui a été absorbée du sol vers les organes de la plante avant). Cette eau, stockée dans le sol et la biomasse des plantes, est appelée l’eau « verte ». On pourrait dire en simplifiant que c’est le cycle qui permet aux plantes de pousser.
- Au sein du cycle de l’eau verte, on trouve également celui des « noyaux de condensation nuageux », comme celui qui fonctionne par exemple avec les spores des champignons (il y a d’autres agents de condensation que les spores – composés organiques volatiles émis par les arbres, pollens …). Les champignons diffusent leurs spores juste avant l’orage et, par effet venturi lorsque la pluie tombe, les spores montent en quelques minutes dans le ciel jusque dans les nuages, deviennent un noyau de condensation et provoquent une nouvelle pluie quelques kilomètres plus loin.
- Le cycle de la « rosée » nous évoque à tous quelque chose. Lorsque la température descend sous le point de rosée (par exemple quand il fait très chaud et qu’un arbre crée de l’ombre diminuant de facto la température), dans une atmosphère chargée en humidité, l’eau issue de l’évapotranspiration des arbres se condense. C’est en quelque sorte comme si l’arbre s’arrosait lui-même, reproduisant indirectement l’effet d’une pluie.
- L’eau est également impliquée dans le processus absolument fantastique de la photosynthèse. L’objectif de la photosynthèse – la création d’un sucre à 6 atomes de carbone qui servira d’énergie à la plante – demande la présence de 12 molécules d’eau.
Parler de « petit » cycle de l’eau (notamment sur les continents) peut donner l’impression que ce cycle ne concerne qu’une petite quantité d’eau. Ca n’est clairement pas le cas. La figure 3 montre d’ailleurs que les flux de précipitation continentaux sont supérieurs aux transferts d’eau depuis l’océan vers le continent. La Terre génère jusqu’à la moitié de ses propres précipitations à partir de sa propre évaporation terrestre, le reste provenant de l’évaporation sur les océans (Rockstrom et al., 2023).
Cette capacité pourrait être permise par la notion de « pompe biotique » de la Terre (la théorie de la pompe biotique n’est pas encore vraiment validée). En termes simples, comprenez ici que les continents boivent grâce aux végétaux. Dans un contexte tropical, un grand arbre évapo-transpire jusqu’à 1000 litres d’eau par jour pour résister à la chaleur équatoriale. C’est un véritable geyser vert. La résultante étant par exemple que la forêt amazonienne envoie plus d’eau dans le ciel que le fleuve Amazone dans l’Atlantique. Un arbre, c’est 1 m2 au sol, mais c’est aussi et surtout 150 m2 de feuilles qui transpirent. Les grandes forêts du globe envoient ainsi plus d’eau dans le ciel que tout l’océan. D’après les données du service statistique du Ministère de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, publiés fin 2021, nous recevons en moyenne chaque année environ 510 milliards de m3 d’eau sur le territoire métropolitain, soit de l’ordre de d’un peu plus de 900 mm de pluie par an. Mais seulement 40 % de ce total, soit 210 milliards de m3, constituent les pluies efficaces qui vont vers les nappes souterraines ou les cours d’eau, le reste retournant dans l’atmosphère du fait de l’évapotranspiration. Une diminution de la végétation sur un territoire se traduit ainsi par un cycle de l’eau qui oscille entre sécheresses et inondations
Pour les plus curieux, voici quelques explications pour mieux comprendre cette notion de « pompe biotique ».
L’eau évapo-transpirée par les arbres sous forme de vapeur d’eau va condenser et former des nuages, souvent autour de microparticules émises par les arbres eux-mêmes, dans le but de récupérer cette future eau de pluie. Quand les microgouttelettes d’eau s’accumulent, elles se collent entre-elles encore et toujours jusqu’à devenir de la pluie. Les nuages, avant d’éclater, aspirent donc l’humidité de l’air en dessous d’eux, ce qui crée une dépression. A l’échelle de la plante, l’activité de photosynthèse de la plante crée du froid en absorbant de l’énergie pour réaliser ce processus de photosynthèse. Ce froid créé à la surface des feuilles pousse l’eau à condenser (c’est aussi ce que nous avons discuté plus haut pour le cycle de la rosée). L’eau passe ainsi de l’état de vapeur dans l’air à l’état de liquide sur la feuille. L’air au-dessus s’allège et alimente ainsi la dépression. Les nuages d’un côté et les végétaux de l’autre allègent l’air en lui retirant son eau, ce qui crée un véritable appel d’air qui pompe l’air marin chargé d’humidité à des centaines de km.
Pour avoir des précipitations stables sur les terres, il apparait donc nécessaire d’assurer l’évaporation de ces mêmes terres. Pour se simplifier un peu la vie, on peut dire que l’évapotranspiration des eaux de pluie, c’est la différence entre les précipitations et le ruissellement (si l’on met de côté l’accumulation souterraine de l’eau). Des écoulements ou ruissellements d’eau trop importants sur le territoire diminueront ainsi la quantité d’eau évaporée et en conséquence la quantité de précipitations.
Pour certains chercheurs, la corrélation entre les températures mondiales et le CO2 atmosphérique serait en fait une corrélation entre la végétation et l’évapotranspiration, qui est le plus gros consommateur d’énergie de la planète. La végétation est principalement responsable de l’évapotranspiration sur terre ; collectivement, la surface des feuilles est beaucoup plus grande que la surface de l’eau libre. Si le rayonnement solaire tombe sur une surface bien pourvue en végétation et en eau, la majorité de l’énergie solaire est consommée dans l’évaporation et en chaleur latente qui ne modifie pas les températures, le reste est utilisé pour la photosynthèse, absorbé par le sol qui se réchauffe, réfléchi en chaleur sensible. Si les rayons du soleil tombent sur une surface non protégée par un couvert végétal et drainée, la majeure partie du rayonnement solaire est convertie en chaleur sensible, ce qui se traduit par une élévation des températures. Comprenez donc que les arbres, s’ils reçoivent suffisamment d’eau, ont une énorme capacité de réduction de la chaleur sensible.
Une réduction de l’évapotranspiration (suite à la déforestation, le changement d’usage des sols ou encore trop de sol nu) entraînerait la conversion du rayonnement solaire global à ondes courtes en émissions à ondes longues et en chaleur sensible. Des ruptures répétées dans le cycle continental de l’eau perturbent les processus de précipitation-évaporation- condensation et libèrent le rayonnement thermique et la chaleur sensible, et ce plusieurs fois. Qui de la poule ou de l’oeuf a précédé l’autre ? C’est en ces termes que se pose l’opposition entre, d’une part, les défenseurs de l’hypothèse dominante dans les rapports du GIEC, qui considèrent que le réchauffement induit par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère perturbe les cycles de l’eau, et, d’autre part, certains hydrologues qui considèrent que la perturbation des cycles hydrologiques est à l’origine du réchauffement climatique qui est une altération du système de climatisation de la terre et de son atmosphère.
Au vu des masses d’eau déplacées entre tous les compartiments de notre planète, certains chercheurs appellent à retravailler notre conception de l’eau au niveau des territoires. Plutôt que de parler de bassin versant ou bassin hydrographique, il faudrait peut-être en réalité parler de bassin atmosphérique (Rockstrom et al., 2023). Les bassins atmosphériques (Fig. 5) sont composés de bassins de précipitations, c’est à dire des régions qui agissent comme des sources de précipitations pour d’autres (comme la région Centre Afrique) et des bassins d’évaporation qui reçoivent l’humidité atmosphériques générée par l’évaporation depuis les Océans ou les Continents via les pays voisins.
Dans un article assez fédérateur, Ben Abbott et ses collègues s’insurgent contre la manière dont les cycles de l’eau sont présentés au grand public (Abbott et al. 2019). Très souvent, le petit cycle de l’eau est caché – volontairement ou non – laissant alors croire que les activités humaines auraient un effet quasi insignifiant sur les grands déplacements d’eau sur la planète. Les auteurs comparent le cycle de l’eau à celui du carbone, cycle pour lequel les émissions liées à l’activité humaine sont pourtant maintenant largement acceptées par la population. Il faut pourtant bien comprendre que l’humain perturbe les cycles de l’eau de trois manières distinctes mais interdépendantes et ce de manière incontestable.
Premièrement, l’homme s’approprie l’eau par l’utilisation de l’humidité du sol via les productions agricoles végétales et animales (c’est le concept d’eau verte que nous avons vu plus haut), les prélèvements d’eau (on parle d’eau bleue) et l’eau nécessaire pour assimiler la pollution (une partie de l’eau que nous utilisons peut être rendue inutilisable à cause de la pollution et retourner dans les cycles de l’eau). Les prélèvements et consommations d’eau pour les usages anthropocentrés sont importants (nous en reparlerons plus tard). Deuxièmement, l’homme a perturbé environ les trois quarts de la surface terrestre libre de glace par des activités telles que l’agriculture, la déforestation et la destruction des zones humides. Ces perturbations modifient l’évapotranspiration, la recharge des nappes phréatiques, le débit des rivières et les précipitations à l’échelle continentale. Troisièmement, le changement climatique – du fait de son origine anthropique incontestable – perturbe les schémas d’écoulement et de stockage de l’eau à l’échelle locale et mondiale.
Le plus important est peut-être que les nouvelles estimations de l’utilisation humaine de l’eau verte, bleue et grise totalisent maintenant environ 24 000 km3 par an. Cela signifie que l’appropriation de l’eau douce par l’homme redistribue chaque année l’équivalent de la moitié du débit des rivières mondiales ou le double de la recharge des nappes phréatiques mondiales. De nombreux chercheurs témoignent de ce que la modélisation des grands flux d’eau à l’échelle de différents territoires (par exemple lors de l’utilisation de modèles hydrologiques) est très largement faussée si les activités humaines ne sont pas considérées.
Notre imaginaire autour de la ressource nous donne l’impression d’une disponibilité largement surfaite de la ressource en eau. En ne distinguant pas les lacs salés des lacs d’eau douce, et les eaux souterraines renouvelables des eaux souterraines non renouvelables, nous ne nous rendons pas compte que la moitié du volume mondial des lacs est salée et qu’environ 97 % des eaux souterraines ne sont pas renouvelables sur des échelles de temps centennales (recharge insuffisante ou inadaptée à l’utilisation humaine en raison d’une salinité élevée). Et même quand nous parlons d’eau de manière quantitative, nous avons tendance à évoquer ces volumes totaux de réserve alors que la quasi-totalité n’est pas disponible. Cette surreprésentation est d’autant plus grave qu’il a été démontré récemment que le véritable volume des eaux souterraines renouvelables dans de nombreuses régions était inférieur à la moitié des estimations historiques – estimations souvent basées sur des extrapolations. Quand nous parlons d’eau, nous ne sommes pas non plus clairs sur la proportion de bassins et d’écoulements accessibles à l’homme. Moins de 10 % des précipitations terrestres annuelles et 25 % du débit fluvial annuel sont durablement disponibles pour la consommation humaine, et seulement 1 à 5 % des eaux souterraines fraîches sont durablement extractibles. Enfin, en masquant notre utilisation des eaux grises (pollution de l’eau), nous ne mettons pas en avant que les activités humaines ont encore réduit de 30 à 50 % la petite fraction d’eau douce encore accessible.
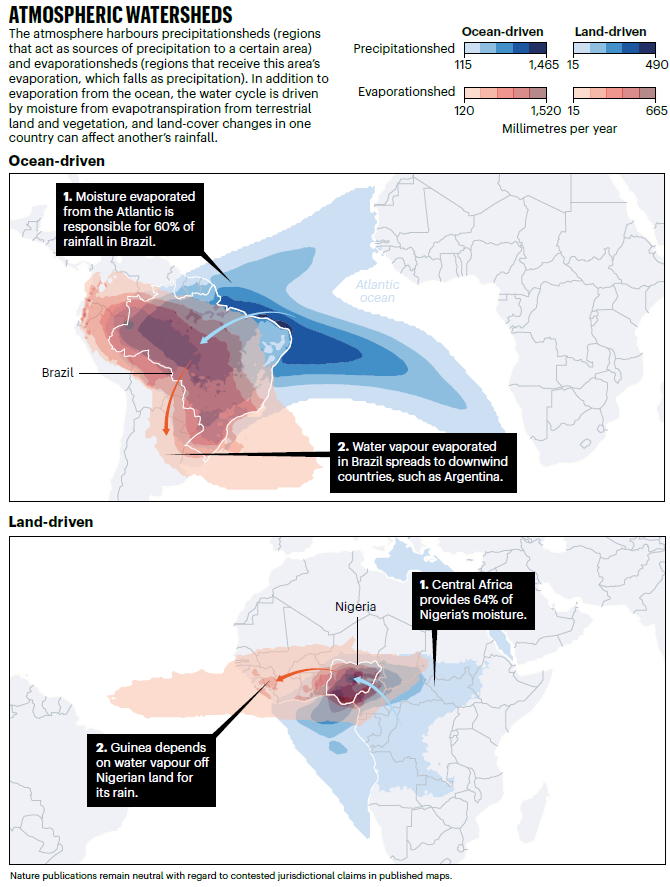
Figure 5. Les bassins atmosphériques. Source : Rockstrom et al., (2023).
Selon Rockstrom et ses collègues, les modifications du paysage peuvent altérer l’approvisionnement en eau dans les régions situées sous le vent, et modifier les climats locaux et le débit des cours d’eau. Par exemple, la déforestation dans le bassin du Congo réduit les précipitations dans les pays voisins et même de l’autre côté de l’Atlantique en Amazonie. L’irrigation intensive des cultures en Inde peut augmenter le débit du fleuve Yangtze en Chine grâce à l’humidité transportée dans le sens du vent. Rockstrom et al. (2023) ajoutent qu’environ 60 % des précipitations du Brésil proviennent de l’humidité évaporée de l’Atlantique et que 35 % de l’humidité provient elle directement des terres brésiliennes, y compris de la forêt amazonienne. Une grande partie de cette humidité atmosphérique resterait à l’intérieur du pays, piégée par les hautes Andes. A noter que le Brésil exporterait également 25 % de son eau verte vers les pays situés sous le vent, tels que l’Argentine, la Bolivie et la Colombie. La pluie venant de l’océan va être évapotranspirée par les forêts puis reprécipiter, et cela de 7 à 8 fois de suite, sur des distances de 500 km à chaque fois, allant par exemple en Europe de la côte atlantique jusqu’à l’Oural. Sans ce tapis roulant vert, la pluie ne tomberait que sur quelques centaines de kilomètres tout au plus à l’intérieur des côtes
Fait notable, aucun pays n’obtiendrait tout seul plus de la moitié de son humidité à l’intérieur de ses frontières. Même les plus grands pays dépendent donc de l’évaporation d’autres régions pour maintenir leurs précipitations. En vertu du droit international, il semble alors légitime de demander à chaque pays de protéger le cycle mondial de l’eau puisque toute action réalisée à un endroit donné aurait des répercussions à un autre endroit sur terre.
Notre relation intime à l’eau, j’entends par là le fait que nos actions ont des effets directs sur les cycles de l’eau sur la planète, nous invite à « semer » et « cultiver » l’eau (Gallabert et al., 2022). L’eau ne peut pas simplement être considérée comme une ressource que l’on prendrait et rejetterait par la suite, mais bien comme un tout intégré dans des cycles qui nous dépassent. Parler simplement de stock d’eau n’a pas de sens. Au vu de tout ce que nous avons décrit, il semble clair que la notion de flux est prépondérante.
La perturbation des cycles de l’eau me permet d’introduire également rapidement le concept de limites planétaires, développé par le chercheur suédois Johan Rockstrom et ses équipes (Fig. 6). En mai 2023, sept limites étaient déjà dépassées, dont celles autour du cycle de l’eau douce – séparée entre l’eau verte et l’eau bleue (voir les différents cycles présentés plus haut). Certaines des publications scientifiques les plus en vue ne prennent en compte que la consommation d’eau pour déterminer les limites planétaires durables en matière d’eau douce et d’autres présentent l’évaporation et la transpiration terrestres comme des pertes d’eau plutôt que comme les principales sources d’eau douce pour l’agriculture et les écosystèmes. A la-mi 2023, Rockstrom et ses équipes ont proposé une révision de leur concept de limites planétaires pour y intégrer une notion forte de justice sociale. On y retrouve les limites « sûres » qui sont celles qui remettent en cause la résilience du système quand on les dépasse (ce sont celles présentes dans l’infographie initiale – elles ont été légèrement remaniées entre temps). On y voit aussi les limites « justes » qui sont celles à partir desquelles les humains commencent à souffrir de manière significative (même si cela reste encore tenable pour la planète).
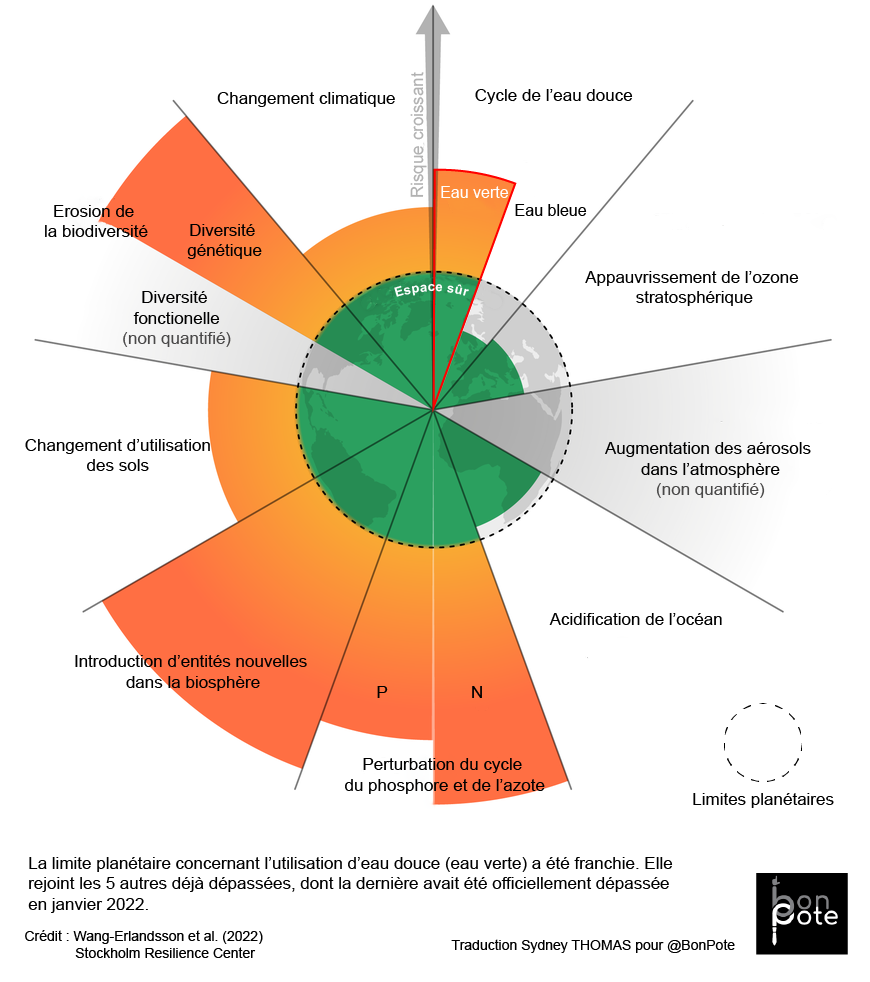
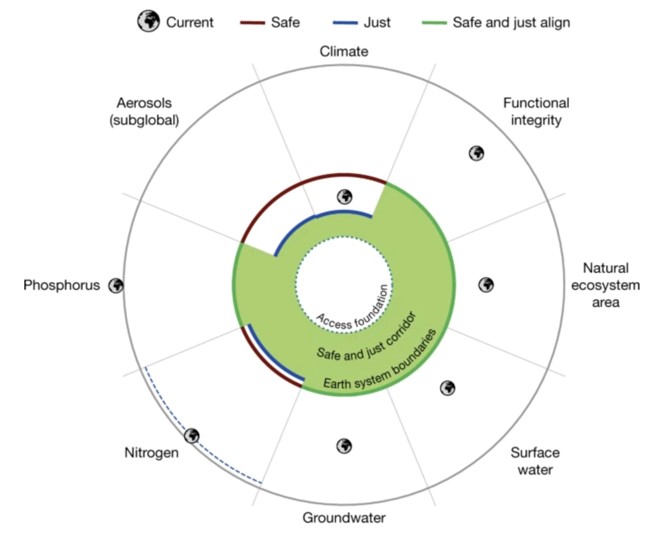
Figure 6. Les concepts de limites planétaires de Rockstrom et ses équipes. L’infographie du bas est la nouvelle version des limites planétaires proposées. Source : Safe and just Earth system boundaries (2023)
A quoi peut-on s’attendre dans les années à venir ?
Une diminution en tendance de la disponibilité en eau douce sur le globe
L’eau a une symbolique très forte. A la fois source de vie et de mort, l’eau peut venir à manquer ou alors bien au contraire à être en excès. Cette symbolique de l’eau peut se retrouver dans les textes religieux au travers du désert (manque d’eau) ou du déluge (excès d’eau).
En France, jusqu’ici, notre vision avait plutôt tendance à être portée sur l’excès d’eau avec le lot d’inondations et de crues qu’a pu connaitre notre territoire. Nous avons d’ailleurs une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) visant à mieux identifier les secteurs à risque et à mener des actions de réduction de la vulnérabilité des territoires, des plans de prévention du risque inondation (PPRI) qui visent à contrôler le développement urbain en zone inondable et à préserver les zones d’expansion des crues, et une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) portée par les établissements public de coopération intercommunale (EPCI), c’est-à-dire les intercommunalités.
Mais depuis la mi-2022, c’est plutôt le manque d’eau qui prend de la place dans l’actualité française. Et c’est peut-être d’autant plus perturbant lorsqu’au même moment, certains pays en première ligne des effets du déréglement climatique subissent quant à eux les ravages de crues et d’inondation meurtrières (par exemple le Pakistan en août 2022). Le Copernicus Climate Change Service publiait en avril 2023 une carte de comparaison des débits des cours d’eau en Europe à la date d’août 2022 par rapport à une période de référence 1991-2020 (Figure 7). La carte parle d’elle-même avec des débits notablement ou exceptionnellement bas en très grande majorité. L’année 2022 aurait été selon eux l’année la plus sèche jamais enregistrée (ils n’ont pas encore travaillé sur 2023, rassurez-vous), plus de 60% des cours d’eau ayant connu des débits inférieurs à la moyenne.
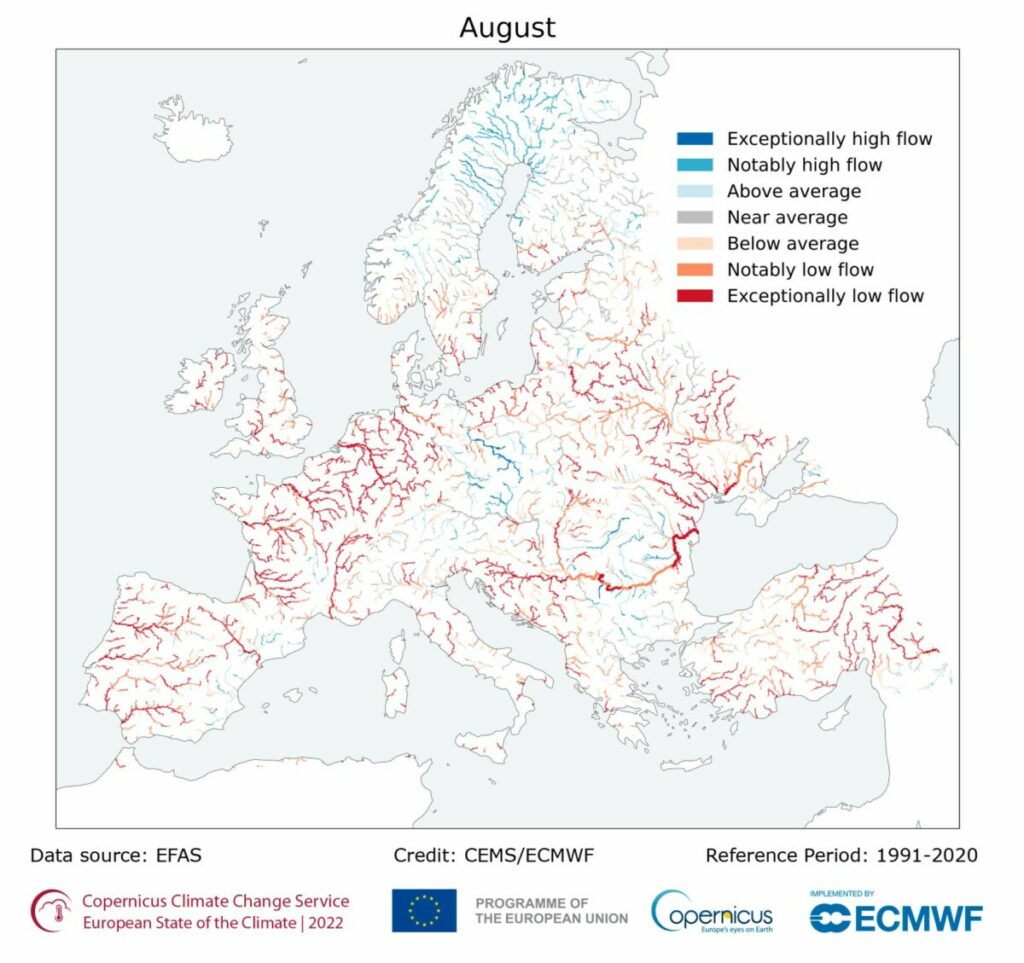
Figure 7. Comparaison des débits des cours d’eau en Europe entre août 2022 et la période de référence 1991-2020. Source : Copernicus Climate Change Service (2023).
En 2022, la World Meteorological Organization sortait quant à elle son rapport sur l’état des ressources en eau dans le monde (Figure 8). On y trouvait notamment une cartographie comparée des débits moyens de rivière en 2021 par rapport à une période de référence 1991-2020, une façon pour eux de regarder si, en moyenne, les débits de cours d’eau étaient supérieurs ou inférieurs à la moyenne temporelle. Les auteurs mettaient en avant que les zones où le débit était inférieur ou très inférieur à la normale étaient deux fois plus grandes que les zones où le débit des rivières était supérieur ou très supérieur à la normale.
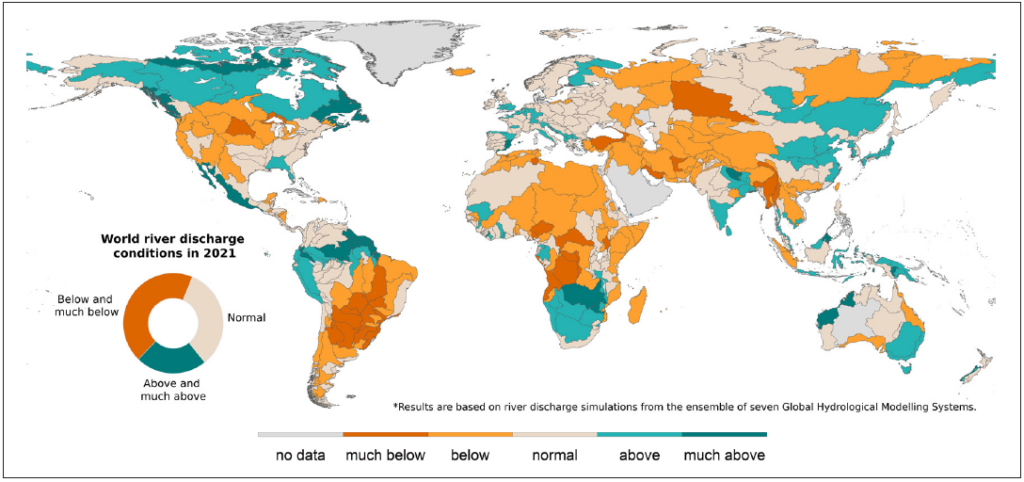
Figure 8. Débit des cours d’eau de rivière en 2021 par rapport à une période de référence 1991-2020. Source : World Meteorological Organization (2022).
Au niveau mondial toujours, un article publié dans Science en mai 2023 donnait à voir, en tendance, la quantité d’eau stockée dans les plus grands lacs mondiaux sur les 3 dernières décennies (Yao et al., 2023). Sur les près de 2000 lacs analysés (à la fois naturels et artificiels), plus de la moitié aurait subi une perte sèche de volume, surtout dans les régions arides du monde (Figure 9). Et la majorité de cette perte serait observée dans une minorité de lacs (certains grands lacs ont donc perdu énormément d’eau). Les raisons principales évoquées imputent la sédimentation (les sédiments laissent donc moins de place à l’eau), le déréglement climatique (augmentation de la température donc de l’évaporation, changement dans les régimes de précipitations donc sécheresse), et les activités humaines (pour nos consommations diverses et variées – nous en parlerons plus loin). Les impacts du changement climatique et la sédimentation apparaissent donc nécessaires à intégrer dans une réflexion plus large de gestion durable des ressources en eau.
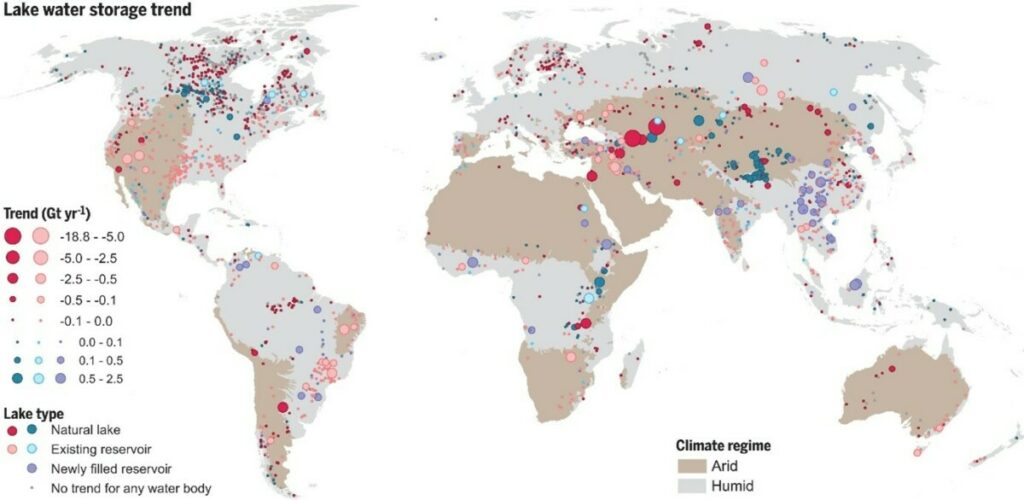
Figure 9. Evolution du stockage d’eau dans les plus grands lacs mondiaux Source : Yao et al. (2023).
L’année 2022 a été classée entre la cinquième et la septième année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température annuelle moyenne supérieure de 1.15°C au-dessus de la moyenne préindustrielle de 1850-1900, malgré les conditions du phénomène météorologique « La Niña » qui ont prévalu. Les scientifiques craignent qu’en 2023, le retour du phénomène « El Nino » (dont la probabilité d’occurrence est jugée très élevée) n’aggrave encore plus le réchauffement climatique.
La cartographie de 2008 ci-dessous (il n’y a pas de carte plus récente à ma connaissance) présente les ressources en eau souterraines dans le monde. Il est assez impressionnant de voir que tous secteurs confondus, entre 1960 et 2010, soit en l’espace de 50 ans, on constate une multiplication par trois des prélèvements d’eau souterraine. On estime qu’environ 60 à 70 % des prélèvements d’eau souterraine dans le monde sont pour les usages agricoles et les 30 à 40 % restants se répartissent équitablement entre usage industriel et usage urbain pour l’alimentation en eau potable.
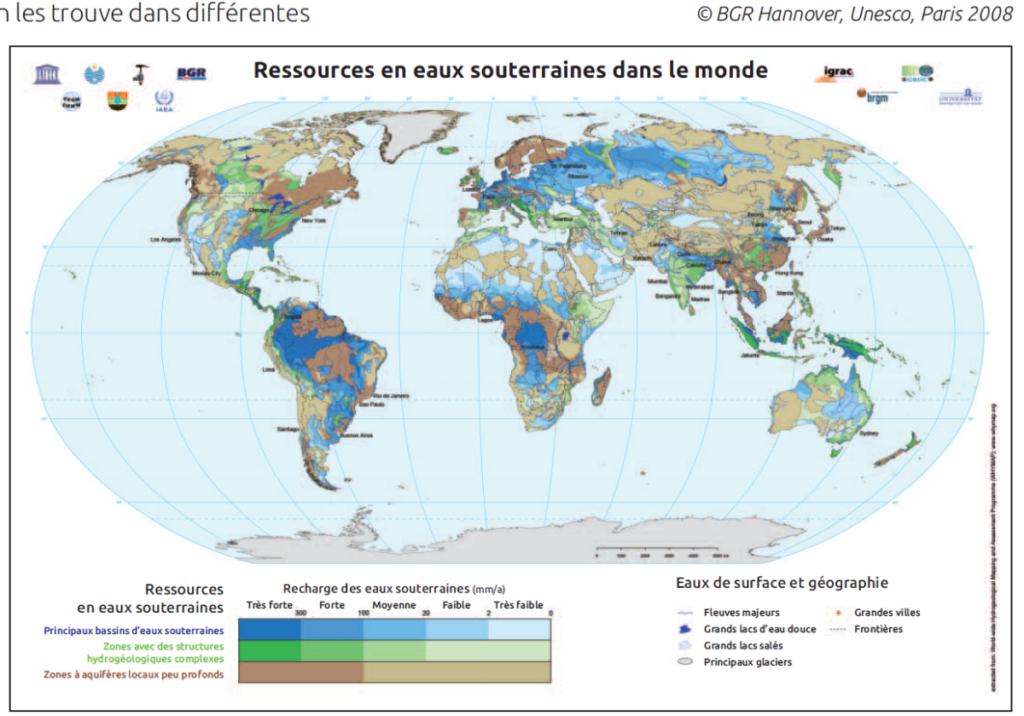
Figure 10. Ressources en eau souterraines dans le monde. Source : BGR Hannover, 2008
Des projections plutôt alarmantes en France
On ne compte plus les travaux de projection et prospective climatique en cours (Aqua 2030, Climator, Garonne 2050, Varennes de l’eau, Explore 2070…). Toutes les projections nous informent sur un changement à attendre dans les régimes de précipitations avec notamment un renforcement structurel des déficits hydriques (et notamment en période estivale). Les impacts sur la ressource en eau seront marqués avec des attentes en termes d’augmentation des températures moyennes de l’air, d’évolution incertaine des précipitations, et de diminution significative des débits moyens annuels des cours d’eau (les cartes actuelles présentées dans la section précédente parlent d’elles-mêmes). La chronique des dernières années, retracée par le Bulletin national de situation hydrologique (BSH) publié tous les mois sous l’égide de l’Office international de l’eau, montre que la sécheresse n’est plus un phénomène ponctuel (comme en 1949 et 1950, en 1976, en 1989-1990 ou encore en 2003), mais tend à devenir récurrente et généralisée.
Notez également que Météo-France a produit début 2021 de nouvelles projections climatiques régionalisées de référence en France, disponibles sur le site du DRIAS.
L’étude du projet Explore 2070 est peut-être la référence la plus fiable sur l’évolution des ressources en eau. Les résultats du projet montrent que le débit moyen des rivières en France devrait diminuer fortement d’ici 30 ans, et ce jusqu’à 50 % dans le Sud-Ouest et le Bassin parisien. Le projet Explore 2, en cours, s’intéressera à faire tourner des modèles hydrologiques pour décliner des scénarios climatiques en impact sur les débits futurs sur l’ensemble des cours d’eau français. Il faut comprendre que ces projets calculent des débits naturels reconstitués, c’est-à-dire une prospective sur l’état des ressources compte tenu des scénarios de changements climatiques et de l’occupation du sol. Ce qui sera vraiment présent dans les cours d’eau (en regard des résultats de simulation) dépendra bien évidemment de nos choix de société. Les conclusions du rapport Explore 2070 concernant le niveau des cours d’eau et le taux de recharge des nappes phréatiques attendus à l’horizon 2046-2065 sur le territoire national sont plutôt éloquents et tous à la baisse. Nous pourrions notamment attendre :
- Une baisse moyenne de la recharge des nappes de 10 à 25 %, marquée pour le bassin de la Loire (25 à 30 %) et le Sud-Ouest (-30 à -50 %)
- Une baisse du débit moyen annuel des cours d’eau entre 10 et 40 %, notamment pour les cours d’eau des contreforts pyrénéens et le bassin Seine-Normandie (entre -10 et -60 %)
- Une réduction des débits d’étiages estivaux de 30 % à 60 %, plus sévères, longs et précoces : jusqu’à -50 % de baisse du débit minimum mensuel pour le Rhône, -70 % pour la Seine
- Une diminution de la part des précipitations qui rechargent les nappes par infiltration ou ruissellement jusqu’aux cours d’eau et lacs, suite aux variations dans les précipitations et aux phénomènes d’évapotranspiration
- Une intensification de l’évapotranspiration entrainant une part plus importante des précipitations retenues dans les sols superficiels au détriment de l’alimentation des nappes
- Un manque de 2 milliards de m3 d’eau en 2050 si la demande reste stable
- Une diminution attendue du débit dans les rivières de -20 à -40 % dans le bassin Adour-Garonne
Les tendances climatiques auront un effet non négligeable sur les grands et petits cycle de l’eau, modifiant à la fois la couverture neigeuse (et la cryosphère en général) par une réduction significative du manteau neigeux et de la durée d’enneigement, les dynamiques des cours d’eau (débits, infiltration, évaporation), la gestion de l’eau superficielle et souterraine (quantité et qualité) en termes de disponibilité par une baisse du niveau moyen des nappes, d’approvisionnement et d’assainissement, la fragilisation des écosystèmes aquatiques et humides et de la biodiversité, ou encore le niveau de sècheresse du sol et, en conséquent, les productions agricoles. Le GIEC rappelle d’ailleurs que tous les scénarios climatiques projettent une augmentation des risques de sécheresse liés à l’humidité du sol.
Les résultats affichés des projets Explore 2070 et Climator seraient même d’ailleurs sous-estimés puisque les travaux font l’hypothèse que le déficit hydrique futur sera compensé par davantage d’irrigation, chose qui – comme en témoigne les évènements récents – ne met pas tout le monde d’accord (nous en reparlerons plus loin). Rajoutons que les systèmes d’irrigation sont confrontés à d’autres problèmes : la rareté de l’eau due aux effets de la sécheresse et du changement climatique, les perturbations environnementales, la nature non linéaire de la dynamique des plantes, la dynamique changeante des conditions météorologiques, ou encore l’absorption dynamique de l’eau par les plantes.
Retour dans le sous-sol. Les eaux souterraines sont déjà impactées et vont continuer à l’être toujours plus. Le déréglement climatique (augmentation de température et baisse des précipitations) en cours perturbe les cycles de l’eau, y compris dans les eaux souterraines, et est à l’origine d’une baisse des taux de recharge naturelle. La baisse de la disponibilité en eau aura un impact sur le débit d’étiage des rivières parce qu’en été, l’eau qui circule dans les eaux de surface est principalement de l’eau d’origine souterraine. C’est notamment le cas des aquifères alluviaux ou autres aquifères peu profonds reliés aux eaux de surface.
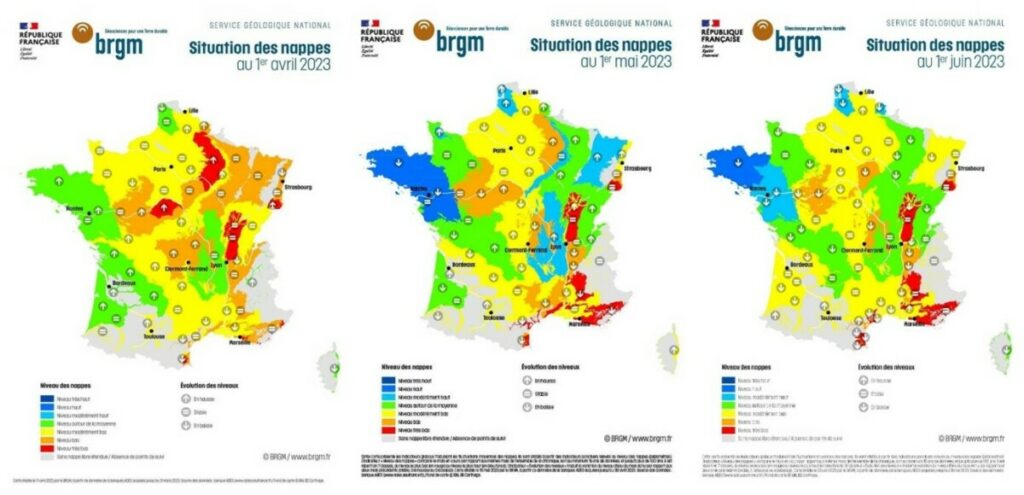
Figure 11. Situation des nappes phréatiques en France en avril et mai 2023. Source : BRGM. Cela faisait 𝟏𝟔 𝐦𝐨𝐢𝐬 que nous n’avions pas vu de bleu foncé sur la carte (c’était au 1er janvier 2022). Les niveaux sont majoritairement en baisse
En hydrologie souterraine, les résultats du projet Explore 2070 en France montrent, à l’horizon 2050-2070, une baisse quasi générale de la piézométrie associée à une diminution de la recharge en eau comprise entre 10 et 25 % due au changement climatique. Deux zones sont plus sévèrement touchées : le bassin versant de la Loire avec une baisse de la recharge entre 25 et 30 % et le sud-ouest de la France avec des baisses comprises entre 30 et 50 %. Cette baisse devrait entrainer une diminution des débits d’étiage des cours d’eau et une augmentation de la durée des assecs. Les scénarios de déréglement climatique peuvent être introduits dans des modèles de simulation d’écoulement des eaux (modèles souterrains) pour simuler l’impact sur les niveaux des nappes et les débits d’étiage qui vont arriver dans les rivières (et ainsi évaluer la durée de ces baisses de débits, avec un travail bassin par bassin…). Le principal scénario de changement est une diminution globale des prélèvements d’eau souterraine de 20 % d’ici à 2070.
L’abaissement de la nappe phréatique peut également menacer les zones humides. Le maintien d’une nappe phréatique à la surface ou près de la surface du sol pendant une période suffisamment longue chaque année pour permettre la survie des plantes aquatiques est un défi pour certaines zones humides. Par exemple, le Marais Poitevin présente un risque élevé d’impacts négatifs pendant les sécheresses en raison du pompage des eaux souterraines pour l’irrigation du maïs.
Pour les aquifères cotiers, une autre problématique a trait à l’intrusion saline. Pour ces aquifères en connexion directe avec la mer en profondeur, on peut assister à l’arrivée d’un biseau salé (intrusion saline) parce que l’eau de mer, plus dense, s’infiltre au fur et à mesure dans l’eau de nappe. Plus la nappe est haute, plus l’intrusion saline peut-être repoussée. La baisse du niveau des nappes avec le changement climatique et le pompage des eaux souterraines va augmenter les risques d’intrusion saline sur tous les aquifères cotiers. En France, le sujet n’est pas encore prépondérant mais il faut s’y préparer. Les déséquilibres quantitatifs, dus à un pompage plus élevé que la recharge naturelle (qui implique donc une baisse du niveau des nappes), semblent être moins préoccupants que les déséquilibres qualitatifs.
Les impacts potentiels d’un manque chronique d’eau
Sans rentrer dans une liste à la Prévert trop approfondie, nous pouvons dresser quelques constats généraux sur les impacts déjà présents et à venir.
En août 2022, plus de 500 communes françaises se sont retrouvées sans eau potable et ont dû s’approvisionner par camion-citerne. Même si certains ne semblent encore y voir qu’un signal d’alerte dans le sens où cet approvisionnement concernait essentiellement de petites communes et pas de grandes agglomérations dont le réseau d’approvisionnement est plus robuste, le risque de manque d’eau est réel et nous touche directement. En mai-juin 2023, certaines communes françaises se préparent déjà à reproduire les livraisons de l’année précédente…
A y regarder de plus près, le manque d’eau va bien plus loin qu’une « simple » fourniture d’eau potable à la population.
Avec des niveaux de fleuve en baisse et des débits non réguliers, le transport maritime se trouve de facto limité. Les niveaux du Rhin ont par exemple été exceptionnellement bas en 2018, bloquant les marchandises dans le port de Cologne. Vous vous souvenez peut-être d’avoir assisté béatement au blocage du canal de Suez en mars 2021 par un porte-conteneur géant. Ce blocage n’avait pas été causé par un niveau d’eau trop bas mais on pourrait l’imaginer. Actuellement, plus d’une tonne de marchandises est acheminée par voie navigable pour chaque habitant de l’Union Européenne – et l’on aimerait en plus que ce niveau augmente pour favoriser un fret plus décarboné que ce qu’il n’est actuellement.
Les barrages hydro-électriques tournent avec un rythme réduit lorsque le débit diminue avec, en conséquence, une production d’hydro-électricité en diminution et une industrie touchée. Et le fret fluvial transporte lui-aussi du charbon pour produire de l’énergie – et compenser la baisse de production de centrales hydrauliques suite à une diminution du débit des cours d’eau (on marche peut-être un peu sur la tête-là). Le niveau d’eau peut également nous interpeller quant à son utilisation pour le refroidissement des centrales nucléaires et thermiques (nous en reparlerons plus loin mais gardez en tête qu’en France, le risque d’un manque d’eau sur ce sujet est un arrêt de centrales et non pas un risque nucléaire).

Figure 12. Etat du lac de Serre-Ponçon (barrage hydro-électriques) à l’été 2022. Source : Resilience Montagne.
Une baisse du niveau d’eau peut également se traduire par des ruptures de chaines d’approvisionnement (non nécessairement dues à des problèmes de transport fluviaux). La sécheresse qui a touché Taiwan en 2021 a frappé de plein fouets l’entreprise TSMC qui fournissait des semi-conducteurs à l’ensemble de la planète.
Côté agriculture, les constats sont bien évidemment assez dramatiques (et nous les approfondirons plus loin). Les agriculteurs catalans ont décidé en début d’année 2023 de stopper net les semis de luzerne et maïs en raison de conditions très largement défavorables. En Italie, le niveau du Pô semble remettre en question l’irrigation des rizières et l’élevage de palourdes. Les baisses de niveau d’eau favorisent l’apparition de bans de sable mais aussi et peut-être surtout de biseau salé – c’est-à-dire de remontée saline. La montée du niveau de la mer (en conséquence directe du réchauffement climatique) et le pompage des eaux souterraines favorisent la remontée des eaux salées toujours plus loin (on pourrait aussi parler du salage des routes dont le sel se retrouve dans l’eau après une pluie mais ce phénomène est peut-être négligeable). Avec des eaux toujours plus saumâtres, les sols se salinisent une fois que l’eau a été absorbée par les plantes ou tout simplement par évaporation de l’eau du sol, affectant alors sensiblement la production agricole sur ces sols. L’augmentation des eaux saumâtres pourrait également appeler à une reconsidération de certaines productions qui ne seraient tout simplement plus praticables. Pourrait-on imaginer passer d’une culture de riz à celle de crevettes dans des eaux trop salées ?
Moins d’eau circulant dans les cours d’eau se traduit par une moindre dilution des polluants et donc, mécaniquement, par une plus forte concentration de ceux-ci. La baisse des débits a aussi un impact dramatique sur la biodiversité, en fragmentant les milieux et en empêchant la mobilité des poissons ou des amphibiens, notamment jusqu’à leurs lieux de frayères. Nous reparlerons plus loin des concepts de débits écologiques et biologiques mis au point pour limiter les impacts sur le vivant et les écosystèmes au sens large.
Le manque chronique d’eau appellera nécessairement à arbitrer entre les différents usages. Par exemple, à l’occasion du renouvellement des concessions de barrage hydro-électriques, les usages hydroélectriques et agricoles risquent entre autres d’être concurrents. La période de pointe de l’irrigation n’est en effet pas celle de la consommation de courant (comprenez que les barrages n’ont pas intérêt à lâcher leur source d’électricité lorsque les gens n’ont pas besoin de courant en été, sauf peut-être en période de canicule où les besoins en climatisation pourraient être importants). Chaque filière défendra alors son importance stratégique ainsi que la disponibilité, voire la sanctuarisation de ressources suffisantes, avec toutefois deux différences pénalisantes pour l’agriculture (CGEDD, CGAAER, 2020). D’une part, les usages de l’irrigant sont liés a une seule source d’alimentation (prise d’eau ou retenue) tandis que les modulations de la demande d’électricité peuvent être soutenues par un système autrement plus souple de centrales interchangeables et de réseaux connectés de distribution. D’autre part, le secteur énergétique peut être tenté d’optimiser ses recettes en délestant le moins possible ses capacités stockables de production pour s’en servir lors des pics de consommation qui sont aussi ses pics tarifaires.
Quels impacts attendre pour les plantes ?
Le potentiel de rendement d’une plante est le rendement que cette plante peut atteindre lorsque la quantité d’eau et de nutriments n’est pas limitée et que les potentiels stress d’origine biologique sont contrôlés. Dans ces conditions optimales, seuls le rayonnement solaire, la température, le CO2 atmosphérique et les caractéristiques génétiques de la plante impactent la durée de la période de croissance et l’interception de la lumière par le couvert végétal. Cette notion de potentiel de rendement est théorique. C’est une référence jugée pertinente lorsque l’on se place dans des contextes agricoles irrigués (puisqu’on fait l’hypothèse que l’eau ne manque pas) ou dans un climat humide avec un approvisionnement suffisant en eau pour éviter des déficits hydriques (Van Ittersum et al, 2012)
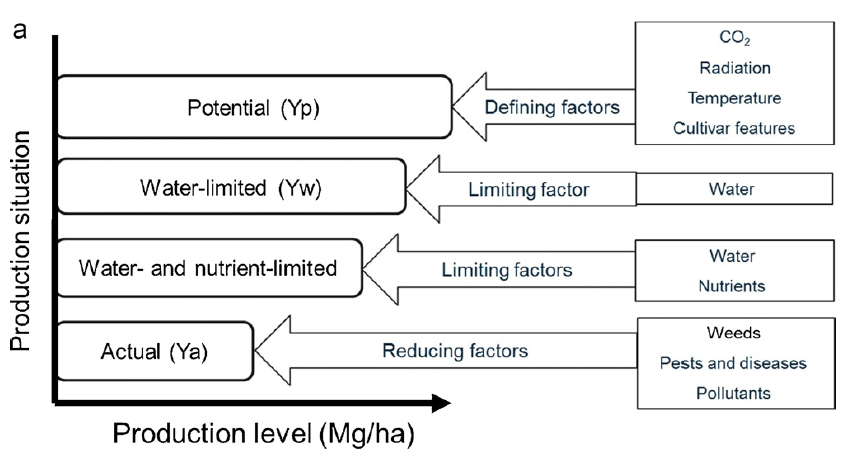
Figure 13. Présentation de différents niveaux de potentiels de rendement. Source : Van Ittersum et al. (2012).
Lorsque l’eau est un facteur limitant – c’est par exemple le cas pour les cultures pluviales – on préférera parler de potentiel de rendement limité par l’eau (et/ou limité par les nutriments si eux aussi viennent à manquer). On fait ici plutôt l’hypothèse que le type de sol et la topographie du terrain ont un impact suffisamment important pour influencer le rendement de la culture (capacité de rétention d’eau, profondeur d’enracinement, intensité de ruissellement). Notez que l’écart entre le rendement potentiel et le rendement limité par l’eau est une indication de l’écart de rendement qui pourrait potentiellement être comblé par l’irrigation (à conditions externes similaires).
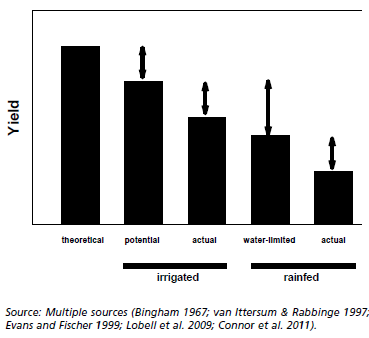
Figure 14. Potentiels de rendement en conditions irriguées ou pluviales
En conditions réelles, ces rendements théoriques sont assez rarement atteints. Le rendement est effectivement affecté par tout un tas d’autres facteurs biotiques comme l’infestation de maladies et la présence de ravageurs ou de facteurs abiotiques (disponibilité en intrants, agro-équipement disponible, formation des agriculteurs…). L’écart de rendement (ou « yield gap » en anglais) est ainsi la différence entre les rendements réels et ceux potentiellement atteignables, que l’on soit dans des situations où l’eau vient à manquer ou pas.
Pour avoir du sens, ces notions de potentiels de rendement doivent être estimés pour une unité géographique et une période de temps définie. Pour les approcher, plusieurs méthodes sont possibles :
- la simulation d’un potentiel sur un site donné à l’aide de modèles de croissance des cultures. C’est certainement la méthode d’estimation la plus fine mais également la plus gourmande en donnée d’entrée.
- les rendements maximaux ou des quantiles supérieurs de rendement mesurés par exemple dans les stations expérimentales ou chez des agriculteurs – c’est une méthode empirique, basée sur l’observation où l’on travaille avec des rendement réellement obtenus mais qui peut souffrir aussi de biais (les conditions agro-pédo-climatiques sont peut-être exceptionnelles dans ces zones). Cette méthode s’applique particulièrement aux systèmes pluviaux et permet d’identifier les saisons et les conditions qui favorisent le plus le rendement limité par l’eau et ainsi de suggérer des stratégies et des tactiques de gestion pour maximiser la productivité de l’eau dans l’éventail des conditions environnementales analysées (Van Ittersum, 2012).
- l’utilisation d’une fonction frontière « rendement vs eau » [souvent le modèle de French et Schult] obtenue suite à l’observation des relations entre le rendement des agriculteurs et l’approvisionnement en eau. Même si cette fonction frontière ne différentie pas les cas d’étude où l’approvisionnement en eau est identique mais les facteurs limitants sont différents (puisque l’on n’affiche que la disponibilité en eau et le rendement obtenu), elle peut quand même aider à déterminer la présence de facteurs limitants et a l’intérêt de couvrir des larges gammes de quantité d’eau à disposition. On pourrait également reprocher à cette méthode de ne pas considérer la temporalité de l’approvisionnement en eau dans le sens où certaines périodes sont plus critiques que d’autres pour la détermination du rendement. La saisonnalité et la structure des précipitations ont bien évidemment un rôle déterminant.
Les approches locales sont bien évidemment à privilégier dès que possible mais les données ne sont pas toujours évidentes à récupérer. Les approches globales, qui permettent une prise de recul plus large, peuvent être par contre limitées par une mauvaise représentation de ce qui se passe dans la réalité. Les systèmes de culture (rotation des cultures, la date de plantation, la maturité du cultivar…), largement impliqués dans la résultante de rendement, ne sont parfois pas considérés ou sont très hétérogènes dans les échantillons considérés.
Dans la mesure où l’eau est clairement un sujet de tension du moment, il apparait opportun d’introduire également la notion de « productivité » de l’eau. Le terme peut paraitre un peu surprenant pour une ressource considérée comme un bien commun mais c’est pourtant un sujet au cœur de la production alimentaire et de l’efficacité de l’utilisation des ressources. En écho à la productivité de l’usage de l’azote, la productivité de l’eau peut se comprendre de manière simplifiée comme le rapport entre le rendement et l’approvisionnement saisonnier en eau (précipitation, irrigation, eau du sol…). En conditions réelles, la recherche d’un rendement maximal est rarement la meilleure stratégie parce que l’on peut se retrouver dans une situation où l’on mettra en place des pratiques culturales qui soit ne sont pas économiquement rationnelles, soit sont trop risquées en termes économiques et environnementaux.
Le déréglement climatique provoquera nécessairement une augmentation de l’évapo-transpiration des plantes et des changements de régimes de précipitations, avec de fortes variabilités par régions. D’un point de vue relativement macro, on pourra notamment s’attendre à des déficits hydriques supplémentaires en été avec une limitation de la disponibilité de l’eau dans le sol et plus encore dans les sols dont la capacité de rétention d’eau est limitée. L’augmentation possible des précipitations hivernales pourrait entraîner des excès d’eau produisant des stress tout aussi pénalisants que les sécheresses estivales avec des anoxies racinaires qui conduiront à des baisses de rendements les années humides si des aménagements ou des changements de pratiques ne sont pas mis en place.
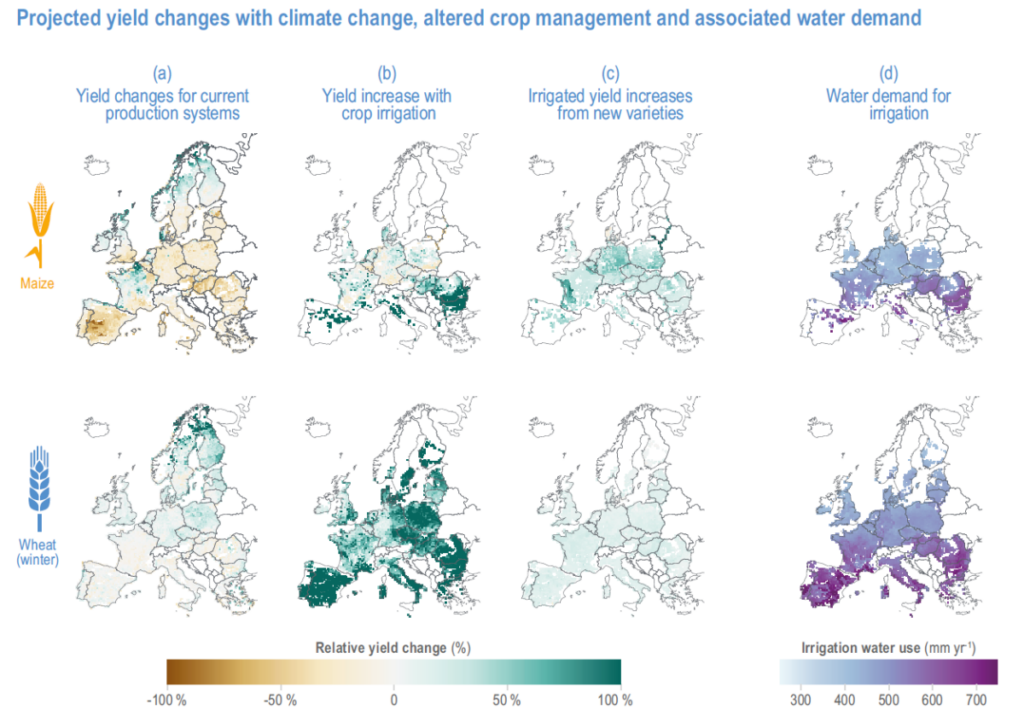
Figure 15. Evolution des rendements de blé et maïs en Europe suite au déréglement climatique et évolution de la demande d’eau associée. Source : GIEC (IPCC) 2022. Les preuves de différences régionales croissantes dans les risques climatiques projetés se multiplient depuis le rapport AR5 du GIEC. Si la direction du changement fait l’objet d’un large consensus, les pertes de rendement absolues sont incertaines en raison des différences de paramétrage des modèles et de la représentation des options d’adaptation. Les zones agroclimatiques d’Europe devraient se déplacer vers le nord de 25 à 135 km par décennie.
Les besoins en eau des céréales sont très différents suivant leurs stades de développement. La période de floraison est d’autant plus déterminante que les plantes sont sensibles au manque d’eau et que la probabilité d’un épuisement de la réserve en eau est forte. En cas de mauvaise alimentation hydrique durant ce stade, la fécondation est mal assurée, ce qui limite le nombre de grain par épi. La phase post-floraison jusqu’au stade maturité physiologique nécessite une bonne alimentation hydrique pour assurer le remplissage des grains d’une part, et limiter l’échaudage d’autre part grâce à la capacité réfrigérante de l’eau.
Les cultures n’ont pas la même sensibilité au manque chronique d’eau dans le sens où certaines sont adaptées à des environnements très limités en eau ou que leur demande en eau ne coïncide pas avec les moments où l’eau peut venir à manquer. La tolérance des cultures à la sécheresse dépend en partie de la profondeur des systèmes racinaires. Les cultures à racines profondes, comme la vigne, la luzerne et le sorgho, sont capables de puiser l’humidité plus profondément dans le sol que les cultures à racines peu profondes (par exemple, le maïs et les pois) et s’en sortent donc mieux pendant les périodes de stress hydrique. Les cultures implantées durant l’automne (céréales, oléagineux et protéagineux) réalisent une bonne partie de leur cycle en dehors des périodes de sécheresse. A côté de ça, ces plantes ont tout l’hiver pour que leur racines descendent profondément dans le sol, leur permettant de résister au sec. Les cultures de printemps font leur cycle sur 5 à 7 mois et assurent la croissance des racines et des feuilles en périodes plus sèches et plus chaudes. Elles sont donc plus exposées au risque de sécheresse.
Si les cultures d’hiver peuvent continuer à être pratiquées en pluvial (sans irrigation) avec le changement climatique (en intégrant toutefois les difficultés causées par les excès d’eau et anoxies racinaires liées aux augmentations des pluies hivernales), dans beaucoup de situations et, notamment dans le sud de la France, beaucoup de cultures d’été actuelles auront du mal à se maintenir en situation pluviale avec un rendement similaire sans irrigation et/ou modifications importantes des techniques culturales. Certaines céréales de printemps sont devenues dépendantes de l’irrigation et ont vu leur rendement augmenter grâce à des apports d’eau supplémentaires.
Les cultures varient également en ce qui concerne le moment où la demande en eau est la plus forte. La demande en eau du maïs, par exemple, est concentrée sur les mois d’été, lorsque le stress hydrique est maximal. En revanche, le calendrier des cultures de colza, de blé d’hiver et d’orge d’hiver est centré sur les mois d’automne et d’hiver, lorsque la quantité d’eau disponible est plus importante.
Au niveau de la plante elle-même, on peut s’attendre à ce que les cycles phénologiques soient complètement perturbés. Les cycles globaux seront déplacés, certaines phases du cycle seront raccourcies et/ou avancés ce qui se répercutera nécessairement sur les calendriers d’irrigation et donc sur les dynamiques intra-annuelles de prélèvement d’eau : date de démarrage de l’irrigation, accroissements des besoins en début de cycle, évolution des besoins maximaux en irrigation, décroissance des besoins en irrigation en fin de cycle. Le raccourcissement du cycle de croissance pourrait aussi conduire à une diminution de la quantité d’eau utilisée pendant la saison.
Les cultures d’hiver devraient subir une anticipation de leur cycle cultural avec une faible réduction de la durée des phases phénologiques clés. Les cultures de printemps quant à elle devraient voir elles aussi un cycle anticipé, couplé à une réduction importante de la durée de la phase de remplissage des grains.
Quelques exemples d’indicateurs agro-climatiques à suivre :
- Exemples d’indicateurs généraux : précipitations en mm/an, évapotranspiration potentielle pendant la période printemps / été, déficit hydrique annuel (mm/an), température moyenne annuelle (°C), somme de températures annuelle base 0°C, nombre de jours chauds (T > 25°C), température moyenne estivale, indicateurs de gelées (tardives ou non)
- Exemples d’indicateurs pour les cultures estivales : nombre de jours supérieurs à 32°C, déficit hydrique sur la période mai à août, nombre de séquence de sécheresse de 10 jours consécutifs pour la période mai – août.
- Exemples d’indicateurs céréales : nombre de jours échaudant (T > 25°C) pour la période u 15 mai au 15 juillet, déficit hydrique pour la période mai à juin, nombre de séquences de 10 jours échaudant consécutifs pour la période mai à juin.
- Exemples d’indicateurs vignes : indice héliothermique de Huglin, indice de fraîcheur des nuits en septembre, déficit hydrique pour la période avril à septembre.
Quels impacts attendre pour les animaux ?
Les conséquences du déréglement climatique sur la disponibilité en eau touche bien évidemment aussi les conditions d’élevage. Les besoins physiologiques des animaux sont directement affectés. Une vache a par exemple une zone de confort thermique entre 3 et 15°C. En dessous, la vache peut s’adapter tant que l’humidité et la vitesse de l’air ne sont pas trop basses. Au-delà des 30-35°C, l’adaptation est particulièrement compliquée.
Le stress thermique provoqué par des conditions caniculaires fortes a des impacts directs sur les performances de production. La production laitière baisse, les taux de gras et de protéine du lait chutent, les mammites se développent, la reproduction des animaux et rendue compliquée, la mortalité des jeunes animaux augmente et les problèmes métaboliques et zoosanitaires vont bon train. Cet état de stress thermique se ressent en extérieur mais aussi dans les bâtiments d’élevage qui ne sont pas nécessairement suffisamment isolés et où la circulation d’air pourrait être améliorée. Le manque d’eau pourrait également menacer l’abreuvement du bétail (qui constitue moins de 10% des usages de l’eau en agriculture).
Indirectement, et en lien avec la production végétale, ce sont également des problèmes d’alimentation pour les productions animales herbivores dues à une faible productivité des prairies ou des cultures fourragères touchées par la sécheresse (couplé à un changement dans la composition et qualité du fourrage). On pourrait également voir combinés, la même année, excès d’eau printaniers et sécheresses estivales, ajoutant des pénalités sur la production des maïs ensilage aux pénalités déjà existantes sur la production herbagère . L’allongement des périodes de sécheresse et des orages peut entraîner l’abandon de pâturages alpins éloignés, réduisant les services écosystémiques culturels et paysagers et entraînant la disparition des pratiques agricoles traditionnelles.
Les changements en cours quant à la disponibilité des prairies pour le pâturage (plus d’herbe plus tôt au printemps et plus tard à l’automne et de moins en moins en été) conduisent les filières herbivores à s’interroger sur le type de bâtiment à prévoir pour l’été ainsi que sur la gestion fourragère des exploitations d’élevage. La modification de la saisonnalité de la production herbagère interroge par ailleurs les cahiers des charges de différents labels de qualité type AOP ou autres.
Quelques exemples d’indicateurs agro-climatiques à suivre :
- Exemples d’indicateurs fourragers : date de redémarrage de la pousse de l’herbe, date de mise à l’herbe, date de récolte précoce de fourrages (ensilage, enrubannage), date des premiers foins, date des foins tardifs.
- Exemples d’indicateurs animaux : index de température humidité pour les bovins (ITH) = nombre de jours où un stress thermique modéré s’exprime (traduit une dégradation du confort physiologique des bovins).
L’eau – indispensable allié du secteur agricole
Agricultures irriguées et pluviales en France
Une grande partie de la surface agricole utilisée (SAU) est occupée par des cultures dites pluviales qui ne nécessitent pas d’irrigation. En 2020, en France, seules 6,8 % des surfaces agricoles ont été irriguées, soit plus de 1,8 million d’hectares (en 2010, on était à 5.8%) – et ce de manière assez irrégulièrement répartie sur le territoire (Agreste, 2020). Les surfaces irriguées dépassent par exemple les 20% sur des zones comme la vallée du Rhône, le sud-ouest de la France ou encore le sud-ouest du bassin parisien (Fig. 16). Et même au sein de ces régions plutôt bien pourvues en irrigation, les disparités d’irrigation sont fortes en fonction des cultures, des modes d’irrigation et les équipements hydrauliques des exploitations agricoles. En 2020, 34 % des surfaces de maïs sont irriguées (contre 40 % en 2010), près de 40 % des superficies de pommes de terre et de soja (contre 51 % en 2010 pour le soja), la moitié des surfaces de verger et plus de 60 % des surfaces de légumes.
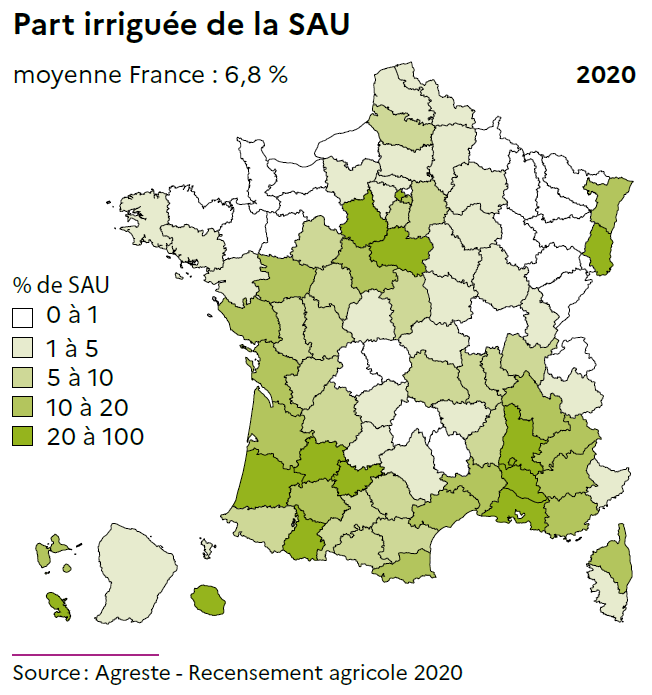
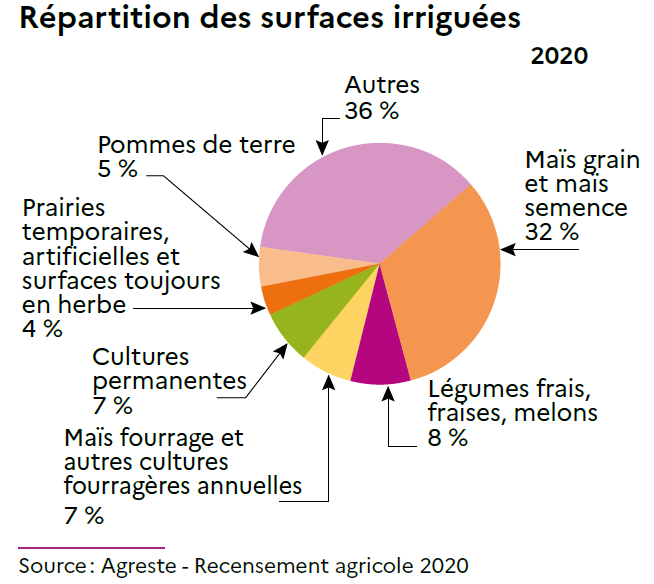
Figure 16. Part et répartition des surfaces irriguées en France. Source : Agreste (2020). En 2010 en France, 15% des exploitations françaises pratiquaient l’irrigation.
La gestion de l’irrigation en France se fait selon deux modèles principaux : celui de la gestion collective de périmètres d’irrigation, et celui de la gestion individuelle par prélèvement direct soumis à autorisation. En 2010, deux exploitations sur trois ont recours exclusivement à un réseau individuel d’accès à l’eau. Ce nombre est en constante augmentation depuis 1970 alors que les accès via un réseau collectif ont fortement reculé depuis 2009 (Loubier et al., 2013). Cette tendance est également observée dans la région méditerranéenne, là où la plupart des irrigations est traditionnellement réalisée à l’aide de systèmes collectifs. Les agriculteurs raccordés à un système d’irrigation collective sont ainsi de plus en plus nombreux à se débrancher pour utiliser des forages ou pompages individuels. La réduction de cette forme d’irrigation collective conduit à la fragilisation des structures collectives puisque les charges fixes des investissements d’irrigation sont rapportées à une superficie plus faible. La durabilité financière de ces structures sera tôt ou tard menacée par des adhérents toujours plus nombreux à se retirer.
Ce recul important des surfaces irriguées en collectif se produit sous l’effet conjugué :
- de changements de pratiques : abandon du gravitaire, passage au goutte à goutte,
- de l’urbanisation par mitage de périmètres irrigués (en gros, l’urbanisation galopante sur des terres agricoles irriguées)
- de conversion aux céréales sèches au détriment du maïs irrigué (dans le sud-ouest) sous l’influence des variations de cours mondiaux, et des modifications de la PAC,
- des restrictions d’autorisation d’irriguer de plus en plus fréquentes au profit des autres usages,
- du différentiel de coût important en faveur des systèmes individuels.
Il est indispensable de disposer d’une évaluation fiable des prélèvements en eau agricole, sur au moins une année récente, pour valider la modélisation des exploitations irriguées. Les analyses statistiques des données du recensement agricole et du registre parcellaire graphique (RPG) permettent de construire une typologie des exploitations irriguées. Une typologie des exploitations non irriguées peut aussi être utile pour appréhender l’impact de l’irrigation, l’importance relative des productions irriguées pour les filières et les alternatives possibles en cas de réductions des volumes prélevables. Il est nécessaire de disposer d’une représentation dynamique du territoire pour prendre en compte l’effet des variations interannuelles du climat (qui ont un effet majeur sur l’irrigation) et évaluer les impacts de différents scénarios de disponibilité en eau et des adaptations des exploitations. Pour cela, il faut modéliser à la fois la demande en eau des cultures et leur rendement sur les exploitations types et leur fonctionnement technico-économique (Serra-Wittling and Ruelle, 2022).
Au niveau mondial, seules 20% des surfaces sont irriguées. Ces terres servent néanmoins à produire 40% de la production alimentaire mondiale en volume. Si, en France, comme nous l’avons vu, la surface agricole irriguée est de l’ordre de 7% – elle est plutôt de l’ordre de 30% aux Pays Bas et en Grèce, et de 15% Portugal ou encore en Espagne. L’irrigation reste un sujet hautement stratégique parce que les productions végétales à forte valeur ajoutée sont génératrices d’emplois et d’activités sur les territoires (et c’est souvent celles qui sont irriguées). C’est notamment le cas en totalité pour les cultures maraichères, l’horticulture et les pépinières, pour l’essentiel des semences et plants (les contrats sont conditionnés à la maîtrise de l’eau), pour les légumes de plein champ à destination des industries, pour la moitié des vergers où l’irrigation est aussi utilisée pour la protection antigel, et pour les grandes cultures lorsque les conditions climatiques ou la capacité de rétention en eau des sols sont défavorables.
On estime classiquement qu’environ 90 % de l’eau consommée par l’agriculture l’est pour l’irrigation. Le reste (10 %), sert à l’abreuvage du bétail et au nettoyage des installations. L’irrigation représente 10% environ des volumes prélevés en eau à l’année mais plus de 50% des volumes consommés en été, avec de grandes disparités géographiques et variabilités interannuelles (voir la section « Eau Prélevée ou Eau Consommée »). Cette demande en eau, concentrée sur quelques mois, coïncide généralement avec les périodes d’étiage des cours d’eau. Certaines cultures, dont le maïs, sont souvent pointées du doigt pour leur consommation en eau mais le sujet est généralement abordé de façon trop simpliste. Le maïs est une plante dite « en C4 », dont la photosynthèse est très efficace et permet de perdre moins d’eau que d’autres plantes (voir la section du dossier sur « l’approche plante »). L’enjeu principal reste que la demande en eau du maïs intervient quand la tension sur cette ressource est la plus forte : pendant l’été. Que ce soit pour le maïs grain (50% de la SAU de maïs), le maïs fourrage (47% de la SAU de maïs), ou encore le maïs semence (3% de la SAU de maïs), l’irrigation du maïs permet d’atteindre des rendements de plusieurs dizaines de pourcents supérieurs à des maïs similaires non irrigués.
Toujours sur le maïs, gardons à l’esprit que les surfaces irriguées de maïs ont diminué de 20 % entre 1988 et 2010. Cette diminution de l’irrigation du maïs est imputée notamment à la diminution des surfaces de maïs cultivé notamment dans des régions où le taux d’irrigation était important (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi Pyrénées…). Plus généralement, la baisse d’irrigation de certaines productions peut s’expliquer par un découplage des aides aux productions et en particulier celle aux cultures irriguées qui constituait une importante incitation à l’accroissement des surfaces, par des mesures administratives des restrictions d’usages et de réduction des autorisations globales de prélèvements, ou encore par la volatilité des prix agricoles et la forte augmentation du prix de certaines productions par rapport à d’autres – l’incertitude de la disponibilité en eau et le rapport au prix le plus favorable jouant sur les choix d’assolement.
Une question importante reste de savoir d’où provient cette eau. Sur le total estimé à 50 milliards de m3 d’eau absorbé par l’agriculture dans l’Union Européenne, 37 % provient de prélèvements directs des rivières et autres cours d’eau, 36 % du pompage des nappes souterraines et 27 % de réservoirs, lesquels recouvrent aussi bien des formations naturelles (lacs, étangs…) qu’artificielles (retenues de barrages, retenues collinaires…) souvent à usages multifonctionnels. L’alimentation des réservoirs artificiels est considérée comme un prélèvement forcé et différé d’eaux souterraines ou d’eaux de surface au cours du cycle de l’eau.
L’agriculteur doit jongler entre de nombreux paramètres pour définir la quantité d’eau à apporter, la date optimale et la durée de l’irrigation : disponibilité des ressources en eau, objectifs de production, besoin en eau des cultures, main d’œuvre disponible, période de restrictions possibles d’usages, contexte pédoclimatique de sa parcelle (type de sol, profondeur, réserve utile…). Et c’est autant de questions très pratico-pratiques auxquelles il devra répondre : Quand démarrer l’irrigation ? À quel rythme irriguer en l’absence de pluie et selon le stade de la culture pour ne pas pénaliser sa production ? Quel volume apporter pour ne pas saturer le sol ? Quand redémarrer l’irrigation après une pluie ? Quand arrêter l’irrigation pour exploiter au mieux le stock d’eau restant dans le sol sans pénaliser la production ?
La date de démarrage de l’irrigation ne doit pas être choisie au hasard et est très dépendante du stade végétatif de la culture produite. Un démarrage trop précoce limite l’enracinement profond de la plante alors qu’un démarrage trop tardif aura pour conséquence un épuisement de la réserve en eau du sol avant le démarrage de la campagne. De la même manière et pour une meilleure valorisation de l’eau apportée, la date d’arrêt de l’irrigation doit être pensée afin que l’eau contenue dans le réservoir en eau du sol facilement utilisable par la plante soit épuisée.
L’eau d’irrigation utilisée ne sera valorisée que si l’irrigation est déclenchée lorsqu’un déficit hydrique du sol est avéré et que la culture est à un stade végétatif sensible à la sècheresse. On distingue notamment deux périodes de sensibilité au manque d’eau, une période où l’incidence est moyenne sur le rendement (période sensible) et une période où l’incidence sur le rendement est forte (période critique).
L’apport d’irrigation ne doit pas non plus limiter les capacités de sauvegarde naturelle de l’eau. La plante ne doit pas simplement être une consommatrice d’eau. Elle doit chercher à utiliser l’eau de la manière la plus efficace possible.
Du fait de son utilisation possible pour maximiser les rendements, l’irrigation est souvent associée en France à l’agriculture intensive, particulièrement dans le cas de la maïsiculture. Mais l’irrigation n’est pas une mauvaise chose en soi, surtout que dans certains territoires, il est tout bonnement quasiment impossible de produire sans eau. Des chercheurs ont également relevé dans certaines régions du sud de la Méditerranée des pratiques agroécologiques en systèmes irrigués. On pourrait rajouter que l’irrigation peut être un levier pour la diversification des cultures qui est l’un des piliers de l’agroécologie.
Je me permets encore une fois de rappeler qu’en France, seules 6.8% des surfaces sont irriguées, c’est-à-dire que la majorité des surfaces n’est pas irriguée. La gestion de la ressource ne concerne donc bien évidemment pas que les irrigants. Qu’ils soient irrigants ou non, l’objectif des agriculteurs est de faire en sorte que l’eau pénètre suffisamment correctement dans le sol pour avoir une réserve utile du sol bien pourvue. Les irrigants doivent faire des efforts pour ne pas tomber dans les travers d’une agriculture complètement dépendante à l’eau et très irriguée. Les non-irrigants eux, de toute façon, n’ont pas ce levier d’action. D’une manière générale, l’irrigation en France n’est pas indispensable à la production agricole comme ce peut être le cas dans les pays arides. L’irrigation est plutôt utilisée pour sécuriser les rendements contre les risques climatiques tels que la sécheresse (c’est le cas aussi pour les cultures sous contrats), limiter les pompages d’eau dans les nappes, augmenter les rendements moyens, et améliorer la qualité des produits (le développement des mycotoxines élaborées par certains champignons et moisissures étant fortement accéléré par le stress hydrique). On voit néanmoins apparaitre des demandes d’irrigation dans des zones auparavant non irriguées (par exemple la viticulture de l’Hérault).
Dans ses scénarios « Transition 2050 », l’ADEME s’est aussi prêtée à l’exercice de projections des demandes d’irrigation pour ses scénarios S1 à S4 (S1 : Génération Frugale. S2 : Coopérations territoriales. S3 : Technologies vertes. S4 : Pari réparateur). Les travaux de l’ADEME pointent une divergence majeure entre les scénarios S1 et S2 d’un côté, et S3 et S4 de l’autre sur la gestion de l’eau (Figure 17). Les scénarios S1 et S2 tendent vers une meilleure maîtrise de la consommation en eau (limitation de la demande) en actionnant l’ensemble des facteurs de résilience climatique. Les scénarios S3 et surtout S4 sont largement plus consommateurs en eau d’irrigation (via un développement de l’offre en eau) dans un contexte de tension sur la ressource en eau. En abordant la question de façon systémique sur l’ensemble des composantes des systèmes culturaux, seul S1 aboutit à une réduction de la consommation d’eau par rapport à la situation actuelle. S2 maintient la consommation à un niveau comparable à l’actuel. Les scénarios S3 et S4 se placent dans une logique de compensation du manque d’eau par de nouvelles ressources non conventionnelles. Le scénario S4 va dans le sens d’une libéralisation du marché de l’eau avec une possibilité de marché à terme de l’eau : les conséquences économiques, environnementales et sociales sont encore difficilement appréhendables dans leur globalité et potentiellement risquées comme le montrent les exemples californiens et australiens.
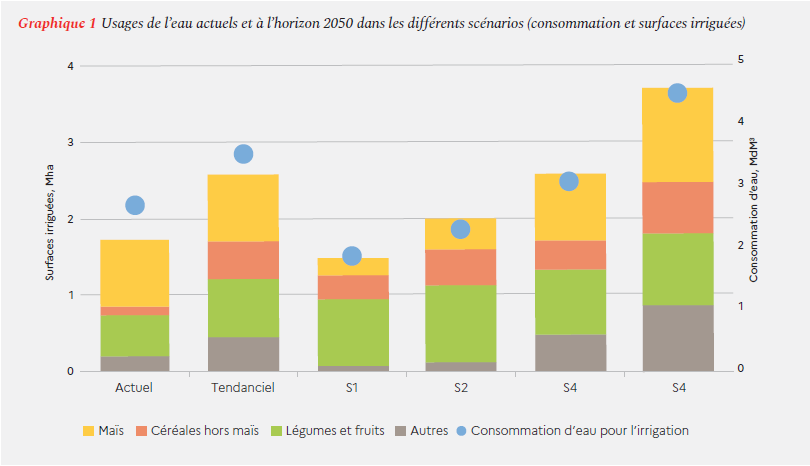
Figure 17. Usages de l’eau actuels et à l’horizon 2050 dans les différents scénarios. S1 : Génération Frugale. S2 : Coopérations territoriales. S3 : Technologies vertes. S4 : Pari réparateur. Source : ADEME Transition 2050
La notion de productivité ou d’efficience de l’eau en agriculture
L’efficacité de l’utilisation de l’eau est un concept qui commence à remonte dans le temps. Des chercheurs avaient effectivement montré une relation entre la productivité des plantes (la quantité de carbone assimilée sous forme de biomasse ou de grains produits) et l’utilisation de l’eau. La productivité de l’eau n’augmenterait par contre pas de façon linéaire avec le rendement en grains. Au fil du temps, l’efficacité de l’utilisation de l’eau, dans son acception commune, aurait augmenté parce que les rendements en grains aurait eux-aussi augmenté à quantité d’eau utilisée relativement constante. L’une des principales questions posées est de savoir comment les plantes réagiront à un climat changeant avec des changements de température, de précipitations et de dioxyde de carbone (CO2) qui affectent leur efficacité d’utilisation de l’eau. Nous en retoucherons quelques mots sur la section du dossier sur l’écophysiologie des plantes, et notamment sur les interactions fortes entre les cycles de l’eau, du carbone et de l’azote (voir la section « Comprendre les flux d’eau dans la plante »).
La productivité de l’eau des cultures, également appelée efficacité de l’utilisation de l’eau, peut être définie comme la relation entre le rendement des cultures et la quantité d’eau utilisée pour produire ces cultures. Elle s’exprime mathématiquement comme la quantité de rendement (kg/hectare) par unité de quantité d’eau (mm) consommée (c’est-à-dire l’évapotranspiration de la culture). Elle ne concerne plus uniquement l’eau d’irrigation, mais également le processus de transformation et de production qui inclut la plante et sa physiologie. La productivité de l’eau est déterminée par le type de culture, sa physiologie et sa génétique, la disponibilité en nutriments pendant le cycle de culture et, dans une moindre mesure, les pratiques culturales et pratiques d’irrigation. L’efficacité d’utilisation de l’eau reste plus facile à mesurer sur des cultures annuelles que sur des cultures pérennes, notamment au regard des effets cumulatifs qui commencent à apparaitre avec des cultures pérennes, au vu de leur enracinement compliqué à évaluer, et au vu de la diversité des modes de conduite sur de telles cultures.
Cette productivité de l’eau peut être considérée en réalité sous bien d’autres aspects. C’est le cas par exemple :
- de l’efficacité technique de l’utilisation de l’eau, qui est définie comme la quantité de production agricole par unité de quantité d’eau utilisée dans la production ;
- de l’efficacité économique de l’utilisation de l’eau, qui est la valeur de la production par quantité d’eau consommée, et
- de l’efficacité hydraulique de l’utilisation de l’eau, qui est définie comme le ratio de l’eau consommée par l’agriculture irriguée par rapport au volume d’eau fourni.
Toutes ces propositions ont comme principal objectif de minimiser l’apport d’eau tout en maximisant le rendement des cultures. Il est par exemple plus rentable de planter du maïs en France quand il y a de l’eau parce qu’avec de l’eau, le rendement du maïs est supérieur. Par contre le sorgho est bien plus productif que le maïs quand il y a une sécheresse.
Améliorer l’efficience de l’eau consisterait à produire autant avec moins d’eau ou plus avec autant d’eau. Gardez en tête qu’il est tout à fait possible d’être efficient mais d’avoir un rendement faible (comme c’est le cas pour les plantes crassulacées) ou d’être efficient dans le sens où l’on peut produire beaucoup de biomasse lorsque la quantité d’eau le permet (comme c’est le cas pour le maïs).
En considérant l’efficience comme un ratio entre la quantité d’eau qui bénéficie réellement à la culture et la quantité d’eau appliquée, la définition classique de la productivité de l’eau fait en réalité l’hypothèse que l’eau qui quitte la parcelle s’apparente à une perte sèche d’eau. D’autres approches prennent en compte l’estimation de la part d’eau d’irrigation potentiellement disponible pour une réutilisation en aval, c’est-à-dire que l’eau qui quitte la parcelle est considérée comme réutilisable à l’échelle du bassin versant.
On ne peut pas simplement comparer des économies d’eau d’une année à une autre sans étudier le contexte climatique des années en cours. S’il a par exemple beaucoup plu une année, on ne verra pas forcément d’économie d’eau sur une année suivante plus sèche. C’est pour cela qu’il faut préférer la notion d’efficience d’utilisation de l’eau plutôt que d’économie réelle d’eau.
Sans grande surprise, la productivité de l’eau à elle seule ne donne pas d’indication sur l’impact environnemental et la durabilité des activités économiques. Une solution pour pallier ce manque pourrait être d’évaluer l’intensité de l’impact environnemental sous la forme d’un bilan couplé au carbone, par exemple en termes de tonnes d’émissions carbones dans l’eau par point de PIB.
Intéressons-nous maintenant à l’efficience de l’eau d’irrigation (et non pas simplement la productivité de l’eau de manière générale) plutôt utile pour évaluer les performances des infrastructures et systèmes d’irrigation. Cette efficience d’irrigation peut se définir comme le rapport entre le volume d’eau utilisé bénéfiquement par la culture, c’est-à-dire réellement transpiré par la culture, et le volume d’eau à l’entrée de la parcelle. En suivant le parcours de l’eau depuis le réseau d’irrigation jusqu’à la plante, on se rend compte que l’efficience de l’eau d’irrigation peut diminuer pour de nombreuses raisons (Figure 18). On pourrait même d’ailleurs décliner cette efficience générale d’irrigation en une efficience d’application (celle qui est très liée au système d’irrigation en place) et une efficience de consommation (elle liée pour le coup au contexte pédo-climatique et aux interactions sol-plante-air). On retrouve notamment (Serra-Witling and Molle, 2017) :
- L’eau en entrée de parcelle (Pi) dont une partie est perdue en raison de fuites dans les équipements d’irrigation. Ces fuites sont influencées par la vétusté du matériel et son mauvais entretien. Pour les enrouleurs et les pivots, il s’agit en général de fuites accidentelles, plus faciles à identifier. En goutte-à-goutte, les fuites par endommagement de gaines sont difficiles à repérer, encore plus lorsqu’elles sont enterrées. L’eau en entrée de parcelle peut être mesurée à l’aide d’un compteur ou d’un débitmètre au niveau de la borne en entrée de parcelle. Elle peut également être approchée par la connaissance du débit en entrée de parcelle et la durée d’ouverture des vannes. Peuvent également être utilisées les données de facturation des organismes délivrant l’eau.
- L’eau appliquée (Ai), c’est-à-dire l’eau sortant réellement du matériel d’irrigation (buse ou goutteur). En aspersion, une partie de cette eau peut être perdue par évaporation due à la température de l’air, transport (dérive) dû au vent, interception par la canopée (puis éventuellement évaporation sur la canopée). Des pertes ou des différences entre l’eau préconisée et appliquée peuvent également subvenir si ce matériel est mal réglé (mauvais types de buses, buses mal réglées, buses bouchées, utilisation du matériel sous mauvaise conditions environnementales quand il fait trop chaud par exemple). L’eau d’irrigation appliquée est celle sortant directement du matériel d’irrigation. Elle est évaluée par la mesure du débit de l’émetteur (buse ou goutteur) multipliée par la durée d’irrigation
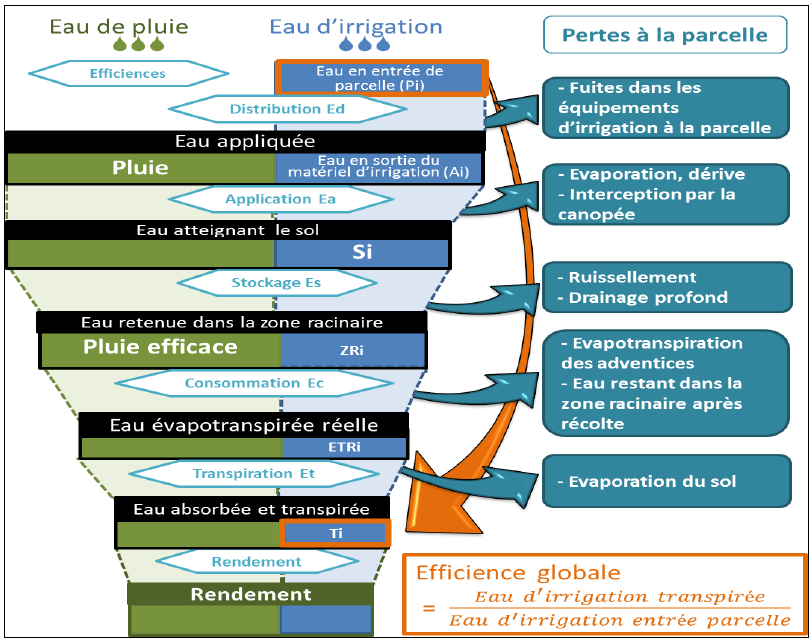
Figure 18. Efficience de l’eau. Source : Serra-Witling and Molle (2017).
- L’eau atteignant le sol (Si), dont une partie est susceptible d’être perdue par ruissellement ou drainage. Pour l’eau de pluie, la mesure est souvent réalisée à l’aide de pluviomètres. Pour l’eau d’irrigation, dans le cas de systèmes asperseurs, l’eau atteignant le sol peut être mesurée à l’aide de collecteurs situés au sol qui permettent également d’apprécier l’uniformité de distribution
- L’eau retenue dans la zone racinaire (ZRi). L’eau d’irrigation résiduelle dans la zone racinaire après la récolte est perdue pour la culture à l’échelle de la saison culturale. Elle pourrait éventuellement être réutilisée si une culture ultérieure était installée immédiatement après. Une partie de cette eau est aussi perdue par l’évapotranspiration des adventices (les adventices peuvent aussi jouer le rôle de tampon en limitant l’évaporation du sol). A ce niveau, l’eau de pluie et l’eau d’irrigation ne se distinguent plus. L’eau dans le sol peut être estimée par échantillonnage avec une mesure de l’humidité pondérale (dessiccation), ou par instrumentation au champ par la mesure de l’humidité volumique (sondes à neutrons, sondes capacitives, FDR, TDR…) ou de la tension (tensiomètres). Les approches nucléaires et isotopiques pourraient néanmoins être utilisées pour tracer l’eau qui circule dans la plante en étudiant les isotopes de l’oxygène et de l’hydrogène dans l’eau. L’eau d’irrigation est souvent enrichie en isotope lourd ce qui permet de discriminer si l’eau qui circule dans la plante est de l’eau d’irrigation ou de l’eau pluviale ou autre. De la même façon, les signatures isotopiques combinées de l’azote et de l’oxygène dans les nitrates permettent de déterminer et de séparer les sources de pollution par les nitrates dans les bassins agricoles.
- L’eau réellement évapotranspirée par la culture (ETRi), dont une part est perdue sous forme d’eau évaporée par le sol. Elle peut être évaluée à partir de cases lysimétriques qui mesurent la quantité d’eau perdue dans l’atmosphère par transpiration et évaporation.
- L’eau absorbée et effectivement transpirée par la culture (Ti). Elle permet l’assimilation de dioxyde de carbone pour la photosynthèse et participe donc à la production de biomasse et à l’élaboration du rendement. Elle peut être mesurée par des capteurs de flux de sève positionnés sur la plante.
Le besoin de considérer l’eau à différentes échelles spatiales
Etudier l’eau est particulièrement compliqué parce que l’on peut travailler à de nombreuses échelles différentes :
Du point de vue de l’exploitant agricole, l’irrigation est une opération agricole. Elle peut se réfléchir sous un prisme tactique au cours de la saison (que faire en fonction de ce qui va se passer la semaine qui vient ?) ou stratégique en planifiant une réflexion sur le long terme (que faire d’un quota d’eau ou d’une réserve d’eau ?)
Du point de vue de l’emprise spatiale considérée, les échelles sont extrêmement variées. Un épisode Cevenolle va peut-être concerner quelques kilomètres carrés d’empreinte alors qu’une sécheresse pourra couvrir un territoire très large. Plante, Parcelle, Exploitation, Système irrigué, Territoire de gestion, ou encore Filières sont autant de niveaux d’abstraction que l’on peut être amené à considérer avec des problématiques à chaque fois différentes. Au niveau de la parcelle ou de la plante, le problème est souvent amené d’un point de vue de la productivité et de l’efficience de l’eau. Les réflexions de sobriété ou d’adaptation se réfléchiront plus à l’échelle du territoire parce que c’est à ces échelles-là que des changements profonds pourront avoir lieu (développement de nouvelles filières à base de culture pluviale, mise en place d’infrastructures agro-écologiques à large échelle, gestion des interactions entre les usages de l‘eau pour l’agriculture et les autres utilisateurs…).
Ce sont également des phénomènes que l’on peut étudier sur des échelles temporelles différentes, que ce soient à des moments ponctuels où la tension sur l’eau est la plus critique (soit à des stades phénologiques clés de la plante, soit à des moments de l’année où l’eau est structurellement en déficit), ou sur des échelles temporelles larges pour étudier les tendances à l’œuvre.
Les économies d’eau en agriculture hors technologies numériques
Avant d’attaquer la section sur les outils numériques dédiés à la gestion de l’eau en agriculture, j’avais envie d’insister sur le panel de solutions en place pour travailler sur la problématique de l’eau. Que les propositions soient agronomiques (changements de modèles et pratiques agricoles), matérielles (révision du matériel d’irrigation et des modes d’irrigation) ou encore technologiques (réutilisation de l’eau traitée, désallement ou encore agri-voltaisme), l’arsenal est gigantesque et bien plus large que les technologies numériques en elles-mêmes. Nous ne rentrerons pas dans le même niveua de détail pour toutes ces approches. Nous parlons, de manière générale, de renforcement de la ressource en eau.
Un nécessaire changement de modèle agricole
Les pratiques agricoles ont une marge de manœuvre assez importante pour limiter l’usage de l’eau en agriculture et/ou en maximiser l’efficience. C’est aussi par le terme de « solutions fondées sur la nature » – au sein des pratiques agricoles ou environnementales – que sont généralement présentées les transformations du modèle agricole.
C’est déjà le calendrier de cultures qui peut être revu en modulant par exemples les dates et la densité de semis. Ce sont en effet des stratégies d’esquive qui visent à décaler les stades phénologiques de la plante les plus sensibles au déficit hydrique (souvent la floraison) vers une période où la ressource en eau est plus disponible en plantant par exemple des variétés précoces ou en privilégiant les cultures pendant les périodes humides. On parle aussi de stratégies d’évitement ou de rationnement qui visent à réduire la consommation d’eau en diminuant par exemple la densité de semis.
Revoir l’espacement des rangs (inter et intra-rang) affectera la répartition de l’évaporation de l’eau du sol, la transpiration de la canopée, et la compétition entre des plantes voisines. Des rangs étroits pourraient en effet réduire la durée pendant laquelle le sol n’est pas couvert et, en théorie, augmenter l’efficience d’utilisation de l’eau si la compétition inter-plantes n’est pas trop forte (on peut imaginer des plantes avec des systèmes racinaires variés).
La diversité et l’allongement des rotations pourraient aussi être des leviers intéressants même si relativement peu d’études ont démontré l’impact précis des rotations sur les économies d’eau. Le projet BAG’AGES, coordonné par INRAE, a commencé à aborder le sujet de l’optimisation de l’irrigation et sur la diversification des cultures mono-spécifiques et des monocultures.
Plus structurant encore, le passage de cultures à forte consommation d’eau vers des cultures qui demandent relativement peu d’eau (et qui sont tolérantes à la sécheresse comme le tournesol ou le sorgho), en choisissant des variétés pertinentes et adaptées, est une option évidente pour réduire les besoins en eau d’irrigation. Ce n’est d’ailleurs pas tant la quantité d’eau en tant que telle que le moment où ces nouvelles cultures en ont besoin qui apparait comme décisif. Dans les régions où le stress hydrique est important et pour s’adapter à la nouvelle répartition des zones agro-climatiques, il faudra peut-être aller plus loin et passer d’une agriculture irriguée à une agriculture pluviale (le fait de n’avoir plus accès à de l’irrigation enlève un peu de marge de manœuvre). Gardez en tête que ces changements profonds d’itinéraires culturaux ne dépendent pas que de l’exploitation agricole mais aussi du marché (filières disponibles, prix d’achat des produits, assurances agricoles associées…). Ce sont néanmoins ces filières économes en eau qui permettront d’assurer une certaine viabilité aux exploitations agricoles.
L’agriculture de conservation des sols (ACS) est également souvent mise en avant comme un ensemble de pratiques agricoles qui participent à une amélioration de la ressource en eau. L’ACS contribue notamment à une amélioration des cycles de l’eau et du carbone (meilleure rétention du carbone organique) à travers l’amélioration des propriétés d’infiltration des sols (microporosité), permettant de lutter efficacement contre le ruissellement et l’érosion de surface. La manière organique présente dans le sol permet de structurer et consolider la microporosité du sol permettant par là-même d’améliorer la rétention d’eau du sol (voir la section « Comprendre les flux d’eau dans le sol ». Les pratiques de conservation du sol améliorent également la biodiversité en limitant ou contraignant fortement le travail du sol, en particulier du nombre de mycorhizes racinaires, favorisant l’exploitation des ressources du sol, notamment en azote et en eau. C’est, de manière générale, le stock global d’eau dans le sol qui s’en trouve amélioré. La FAO indique que cette matière organique peut retenir environ 20 fois son poids en eau et que cela s’avère utile non seulement en période de sécheresse lorsque l’humidité est essentielle pour la croissance des plantes mais aussi en période de fortes pluies en limitant inondations et glissements de terrain, et en ralentissant l’écoulement de l’eau dans les cours d’eau. Néanmoins, à l’échelle du territoire, il est difficile de savoir si les systèmes en agriculture de conservation permettent des économies d’eau car certains choisissent d’irriguer leurs couverts avec l’eau économisée sur les autres cultures de rente.
L’amélioration de l’utilisation de l’eau au niveau du couvert végétal peut être obtenue en adoptant des pratiques qui réduisent la composante d’évaporation de l’eau du sol et détournent davantage d’eau vers la transpiration. Les couverts végétaux sont aussi présentés comme une manière de réduire l’évaporation de l’eau du sol. Ces couverts consomment néanmoins une partie de l’eau du sol ce qui peut pénaliser la culture suivante, la recharge des nappes et les écoulements vers les cours d’eau. Dans le cas particulier de sols superficiels ou si les pluies sont rares, les couverts doivent être détruits assez tôt pour que la réserve en eau du sol se reconstitue avant la levée de la culture suivante. En plus des couverts, les adventices, elles-aussi, peuvent jouer ce rôle de tampon d’eau du sol.
Les rangées de haies et d’arbres présentes dans un système agroforestier ont un effet parasol et un effet brise-vent qui permettent de réduire les amplitudes thermiques au cours de la journée et de réduire l’évapotranspiration des plantes. Les chevelus racinaires des arbres prélèvent certes l’eau dans les horizons profonds et facilitent les remontées capillaires d’eau des nappes, mais la compétition entre les arbres et les cultures associées peut devenir pénalisante en conditions sèches et sur des sols superficiels, créant localement des zones d’assèchement. Les travaux en vert (écimage, rognage, effeuillage…), notamment pour les cultures pérennes, sont aussi un moyen de jongler avec les conditions climatiques à venir et limiter les besoins en eau.
L’agronome Gerard Ducerf nous évoque aussi l’impact des pratiques agricoles de l’eau. Cet agronome, expert en plantes bio-indicatrices aurait observé, sur les mêmes parcelles, des plantes adventices bio-indicatrices d’un excès d’eau et de plantes bio-indicatrices d’une désertification à trente centimètres, qui témoigneraient d’un manque flagrant de régulateur d’eau dans nos parcelles. Gérard Ducerf explore aussi un phénomène qu’il qualifie d’hydromorphismes induits provoqué par les pratiques agricoles. En périodes très sèches et très chaudes, la tendance classique consiste à travailler le sol quand il est mouillé. On attend qu’il pleuve pour labourer, semer et travailler le sol. Pourtant, à chaque fois qu’un sol humide est travaillé, il entre dans un phénomène d’hydromorphisme. Le sol travaillé par temps humide éclate, l’eau colle, chasse l’air et l’eau remonte, laissant du béton.
Du côté de l’élevage, le salut pour l’exploitation des prairies en périodes de sécheresse viendra sûrement par une diminution des chargements (nombre de bêtes par hectare) pendant les périodes de stress hydrique maximum pour ne pas matraquer les prairies et ainsi faciliter le redémarrage de ces prairies au retour des pluies. La sélection d’espèces herbacées plus tolérantes à la sécheresse est une des techniques à mettre en place. D’autres pratiques autour de la gestion du paturage (paturage hivernal, paturage dynamique…) seront intéressants à mettre en place.
De manière plus indirecte, toutes les pratiques qui permettent de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et de diminuer l’érosion sont pertinentes. Les infrastructures écologiques de manière générale (zones humides, haies, bandes enherbées, fossés, ripisylves, mares tampons) jouent ce rôle fondamental pour diminuer le ruissellement et favoriser le stockage d’eau dans les paysages. Ces infrastructures doivent être mobilisées pour ralentir le cycle de l’eau de façon à limiter l’impact des occurrences de surplus et de déficits hydriques, optimiser le remplissage des nappes souterraines, développer le stockage de l’eau dans les zones profondes du sol ou encore limiter l’érosion des sols.
Préserver et restaurer les zones humides, végétaliser les villes et les lits de ravines érodés, désimperméabiliser, aménager des zones d’expansion de crues, reméandre un cours d’eau pour le ralentir sont autant de pratiques à considérer. La mise en œuvre de ces actions n’est néanmoins pas si évidente que ça. Si l’idée est séduisante, dans la pratique, les connaissances scientifiques manquent et leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’adaptations locales négociées avec l’ensemble des acteurs et d’expérimentations non reproductibles puisque chaque territoire a ses caractéristiques propres.
Revoir l’irrigation : irrigation de résilience et irrigation légèrement déficitaire
Au vu des enjeux liés à la ressource en eau, les concepts autour de l’irrigation commencent eux aussi à évoluer et des terminologies comme l’irrigation de résilience ou encore l’irrigation déficitaire commencent à se démocratiser. Ces formes d’irrigation peuvent se voir comme des irrigations de sécurité, à la différence d’une irrigation dite plutôt classique qui vise à maximiser les rendements et qui entraîne une consommation importante en eau. On passerait en quelque sorte d’une maximisation de la production à une optimisation inter-annuelle du revenu agricole sous contrainte hydrique. L’irrigation de résilience est parfois élevée en concept, en slogan, une sorte de philosophie d’irrigation pour une résilience maximale de nos systèmes en place.
L’irrigation déficitaire est un premier niveau de changement qui consiste à appliquer des restrictions hydriques raisonnées en dehors des stades phénologiques critiques, pendant lesquels les composantes du rendement sont moins sensibles au stress hydrique. Cette approche part du principe que les économies d’eau substantielles réalisées l’emportent sur toute réduction du rendement des cultures. Et ces économies d’eau pourraient se traduire en une optimisation des revenus, à la fois dû à la diminution des coûts liés à l’eau, mais aussi ceux liés à l’énergie dont les prix ont explosé suite à la guerre en Ukraine (il faut de l’énergie pour pomper l’eau – nous en reparlerons plus loin).
Passer à une irrigation de résilience relève réellement d’un changement de paradigme. Il faut en effet que nous acceptions, quand c’est nécessaire, de ne pas satisfaire complètement les besoins en eau de la culture, et de maintenir un déficit d’irrigation correctement contrôlé. L’irrigation de résilience ne peut pas se faire toute chose égale par ailleurs. Elle doit s’accompagner d’une évolution des assolements, des variétés et des pratiques culturales pour faire en sorte que les apports d’eau, qui seront diminués, soient particulièrement efficients. Ce concept n’est néanmoins pas nouveau pour toutes les cultures parce qu’il est déjà un peu mis en place en viticulture et en arboriculture. L’irrigation de résilience pourrait être mise en forme de façons différentes avec par exemple :
- Une irrigation sous pilotage technique, qui vise à apporter la quantité précise au bon moment et au bon endroit. Cette optimisation nécessite le déploiement combiné d’outils d’aide à la décision tactiques (modèles de bilans hydriques…) et stratégiques (optimisation de l’assolement). Elle fait aussi appel au conseil et au pilotage de l’irrigation, avec la mise en place de capteurs et sondes, de matériel d’irrigation adapte, de compteurs communicants ou encore de réseaux performants. Une section du dossier est dédiée à ces sujets-là.
- Une irrigation d’appoint (irrigation starter, apports d’eau à la juste dose a certains stades phénologiques critiques de la plante) pour l’intégration, au sein des assolements, de cultures aujourd’hui pluviales, d’hiver, ou de printemps mais peu consommatrices d’eau en substitution de cultures plus fortement irriguées
En irrigation classique, on vise généralement à maintenir le point de flétrissement relativement bas, ce qui autorise une large gamme d’humidité du sol. En irrigation de résilience, on autorisera des valeurs de point de flétrissement plus élevées, mais sans dépasser le point de flétrissement permanent (voir la section « Comprendre les flux d’eau dans le sol »). La gamme d’humidité correspondante sera donc plus restreinte, ce qui nécessite un pilotage de l’irrigation beaucoup plus précis. Si l’on accepte de maintenir un niveau d’humidité ne garantissant pas l’intégralité des besoins en eau de la culture, il faudra pouvoir estimer l’effet de cette satisfaction incomplète des besoins sur le rendement des cultures.
La fréquence de l’irrigation joue aussi sur la façon dont la plante lit l’eau dans le sol. On pourrait comparer ça à une sorte d’effet junky où, lorsque l’on irrigue trop régulièrement, la plante ne fait plus d’effort pour aller chercher de l’eau ou s’adapter à des déficits en eau. Dès que l’on commence à ne plus irriguer, la plante commence alors à souffrir terriblement.
Nonobstant les modalités économiques et techniques ce ces formes d’irrigation, il sera bien évidemment nécessaire de s’assurer de leur capacité de mise en place et de déploiement, de leur acceptation par les irrigants et de les imaginer dans un périmètre plus large que la seule exploitation agricole. On pourrait distinguer deux populations d’agriculteurs. Les premiers, avec un haut niveau technique ou qui sont dans des situations très tendues en matière de ressource (avec des quotas par exemple limités). Pour cette catégorie d’agriculteurs, même si l’eau n’est pas très chère, le fait d’en manquer ou de ne pas la maitriser pourrait être particulièrement préoccupant. La deuxième catégorie d’agriculteurs pourrait regrouper ceux qui font de l’irrigation de complément, souvent avec des canons enrouleurs, et qui ne sont pas forcément très performants en termes d’efficience d’utilisation de l’eau (matériel mal réglé, irrigation en conditions venteuses…). Ces agriculteurs-là peuvent faire des rotations irriguées et non irriguées parce qu’ils ont des systèmes non fixes. Ceux qui ont des systèmes fixes auront tendance à irriguer tout le temps.
Le passage à une irrigation de résilience pour une part plus ou moins importante de l’exploitation – selon les filières ou les territoires – modifie profondément l’utilisation et donc la rentabilité des investissements correspondants (matériel à la parcelle ou à l’exploitation et réseaux collectifs, le cas échéant). Le matériel des exploitations devra être en tout ou partie mobile ou en tout cas plus agile pour s’adapter à des configurations d’irrigation variables selon les parcelles et les années, allant de l’irrigation sous pilotage technique à celle d’appoint. Cela suppose une amélioration des matériels mobiles d’irrigation, aujourd’hui globalement moins performants que les matériels fixes et l’acquisition de nouveaux matériels (mobiles) pour les irrigants ne disposant à ce jour que d’infrastructures fixes. Pour les réseaux collectifs d’aménagement et de distribution de l’eau d’irrigation, le développement de l’irrigation de résilience conduit à réexaminer leur rentabilité économique au regard de quantités d’eau plus faibles apportées à l’hectare et pas systématiquement chaque année.
L’orientation des pratiques vers ces nouveaux modes d’irrigation pourrait être accompagnée d’aides financières. Jusqu’ici les compensations financières (de type Paiements pour Services Environnementaux) ont surtout privilégié les aspects qualitatifs de la gestion de l’eau et finalement assez peu les aspects quantitatifs. L’idée serait alors de récompenser financièrement la productivité d’une stratégie d’irrigation, pour continuer à se tourner toujours plus vers des modes d’irrigation déficitaires ou de résilience. Un rapport récent du CGAAER analysant les techniques innovantes de gestion de l’eau en agriculture évaluait à 30 % les économies d’eau pouvant être réalisées dans les bassins versants en combinant les différentes techniques d’optimisation de l’irrigation et de diversification des cultures (CGAAER, CGEDD, 2020).
Vers un matériel d’irrigation plus performant
L’irrigation en agriculture peut prendre des formes assez variées – plus ou moins fines et plus ou moins technologiques (Figure 19).
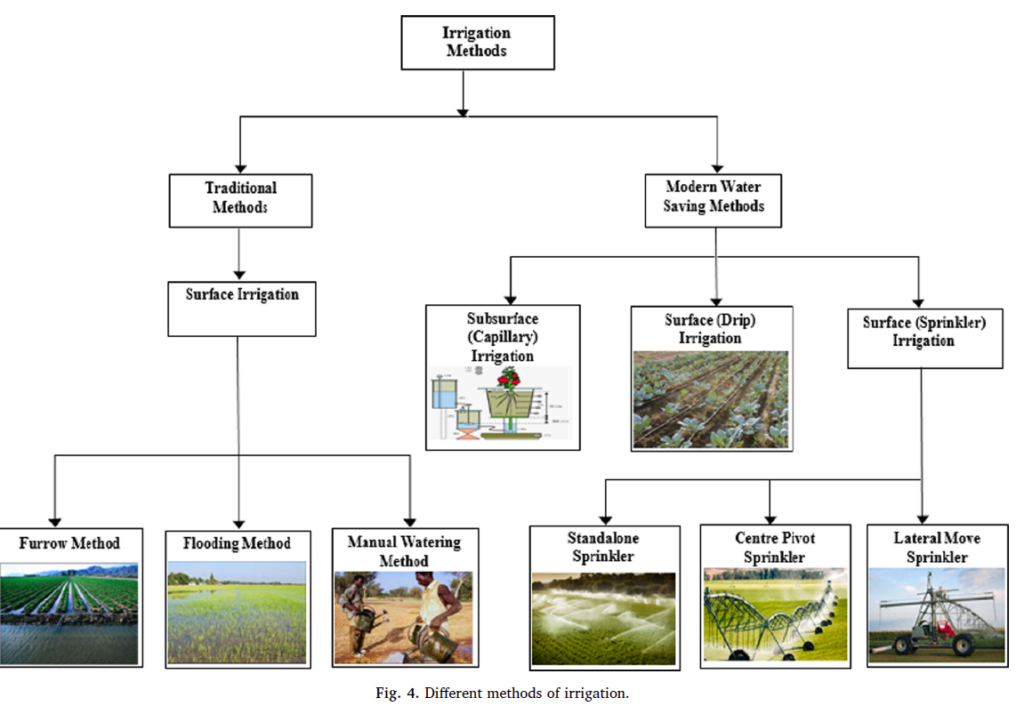
Figure 19. Différentes méthodes d’irrigation. Source : Abiodum Abioye et al. (2020).
L’IRSTEA (maintenant INRAE après fusion avec l’INRA) publiait en 2017 un état de l’art sur l’efficience du matériel d’irrigation pour la gestion de l’eau. Ce travail montrait également toute la diversité des méthodes d’irrigation (Figure 20).
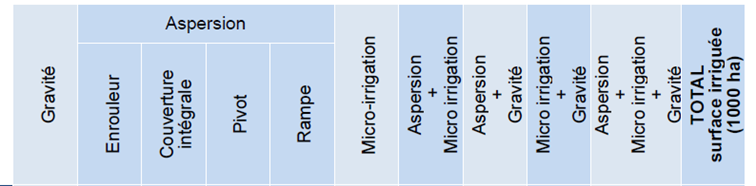
Figure 20. Typologie de matériel d’irrigation. Source: Serra-Wittling and Molle, 2017
En France, la majorité de l’irrigation se fait par système d’aspersion, à près de 90% (Figure 21). Ces chiffres sont bien évidemment à rapprocher des typologies de cultures qui sont irriguées en France. La figure parle d’irrigabilité et non pas de surfaces irriguées parce que la présence des infrastructures d’irrigation ne signifie pas nécessairement que les parcelles sont irriguées.
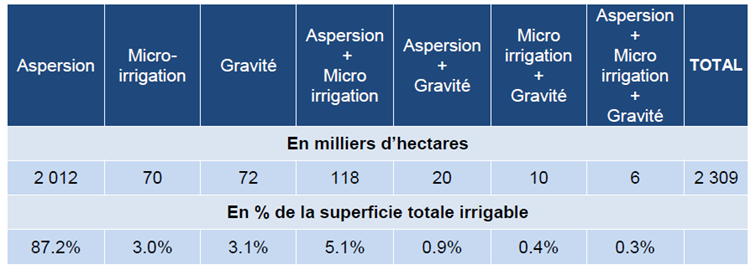
Figure 21. Superficies irrigables par mode d’irrigation (en milliers d’hectares) sur le territoire français métropolitain. Source : Serra-Wittling and Molle (2017) d’après les données du recensement agricole de 2010.
Les paragraphes suivants donnent à voir quelques caractéristiques de ces systèmes d’irrigation.
Les systèmes goutte à goutte sont certainement le matériel avec la capacité de performance la plus élevée (on ne mouille pas toute la surface mais le sol est mouillé tout le temps) mais qui reste très sensible à la qualité d’eau qu’il va recevoir (teneur en matière en suspension et minéraux en solution). Un risque important est ainsi d’assister au colmatage des trous qui, s’ils ne sont pas entretenus (eau oxygénée pour le biologique, ou de l’acide quand problèmes chimiques), vont très clairement faire baisser l’efficience du système en goutte à goutte (et ça peut chuter très vite). La plupart des installations de goutte à goutte aussi utilisées pour la fertigation. On peut distinguer le goutte à goutte de surface du goutte à goutte enterré.
Le goutte à goutte de surface est intéressant en ce sens que l’on voit ce qui se passe (si ça irrigue ou si ça n’irrigue pas) et que ce système est relativement facile à installer en parcelles. Sur des cultures annuelles, les agriculteurs utilisent généralement des systèmes non réutilisables (gaines jetables qui vont être recyclées et nettoyées à la fin de la saison).
Le goutte à goutte enterré est pertinent parce que l’on arrose sous la plante – la plante récupère ensuite ce dont elle a besoin. Ces systèmes ne sont pas toujours enterrés à profondeur régulière, et sont parfois touchés par les outils de travail du sol (type charrue ou autre). Ces systèmes limitent l’évaporation de l’eau du sol, le développement des adventices (puisque la surface n’est pas arrosée) et les systèmes sont relativement à l’abri de rongeurs et autres insectes qui pourraient les abimer. Ce sont par contre des systèmes relativement plus complexes à poser, avec une maintenance d’autant plus sensible (et donc plus chers), et dont il est difficile de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement puisqu’ils ne sont pas visibles.
Les canons enrouleurs ne sont pas nécessairement l’agro-équipement idéal pour une irrigation à 100% et sont peut-être préférables pour les irrigations de complément. Ces systèmes ont une capacité de performance elle aussi assez importante mais sont très sensibles au vent. Les rampes tractées équipées d’arroseur se développent (un peu comme les rampes de pulvérisation) pour baisser les pressions et réduire la sensibilité au vent (l’équipement est par contre plus cher et encombrant, même pliable). Certains ont développé des canons dont le secteur est réglable pour épouser la forme de la parcelle assez fidèlement. D’autres ont développé des canons dont l’angle du jet peut être modifié. Les enrouleurs commencent également à disposer d’une régulation électronique d’enroulement – sorte de grosse bobine avec un moteur hydraulique qui prélève de l’énergie sur le circuit d’eau pour enrouler mécaniquement le tube et avoir une vitesse constante de déplacement sur la parcelle (avant, c’était réalisé par un dispositif mécanique). Petit à petit, des balises GPS commencent à arriver sur les canons pour suivre leur déplacement avec l’objectif de croiser la position du canon avec des chroniques de vent pour évaluer les quantités d’eau apportées en fonction des zones de la parcelle. Certains agriculteurs gardent leurs enrouleurs assez longtemps et transforment leurs vieux enrouleurs en installation fixe, notamment pour chercher à réduire l’irrigation sur les cultures de printemps ou d’hiver. L’enrouleur est particulièrement intéressant dans un cadre de rotations culturales parce que c’est un système mobile.
Les pivots et rampes frontales ont un optimum économique autour de 40-50 hectares à l’heure actuelle. Ces systèmes peuvent aussi venir remplacer les enrouleurs qui finissent parfois par tasser les sols. L’utilisation de pivot devient intéressante même si c’est pour faire de l’irrigation de complément parce que le marché de l’occasion se développe. Ce sont des machines sur lesquelles il y a un potentiel assez intéressant de contrôle et diverses options pour diminuer l’intensité, la sensibilité au vent, et baisser la pression.
On peut également imaginer quadriller la parcelle d’asperseurs, qui sont des tuyaux en aluminium avec des arroseurs courant sur les parcelles. Ces dispositifs permettent de s’adapter à la parcelle et peuvent fonctionner avec des intensités d’arrosage très faible. Ils restent néanmoins sensibles aussi aux conditions de vent. L’enjeu est de parvenir à fabriquer des gouttes ni trop petites, qui vont filer avec le vent ou s’évaporer, ni trop lourdes, qui risquent de matraquer le sol (c’est le phénomène de croute de battance). Ce sont des dispositifs mobiles parce qu’on peut les passer d’une parcelle à l’autre. Les micro-asperseurs ont une portée néanmoins plus réduite que les asperseurs classiques, et peuvent être utilisés pour travailler sous la frondaison des plantes au-dessus des arbres (par exemple pour faire du traitement sur la tavelure du pommier, pour lutter contre le gel, ou encore pour refroidir la végétation lors de vagues de chaleur).
Le réglage du matériel, via la gestion et la distribution optimales du volume d’eau dont on dispose constituent un chantier permanent de l’innovation. On peut par exemple citer le réglage de l’angle du secteur arrosé par un canon (lutte contre les pertes par dérive), le réglage de la vitesse du canon en fonction de la topographie (dans une pente, le canon en s’accélérant met moins d’eau), la régulation de l’enroulement, la gestion des écartements entre passages, ou encore les ajustements débit/pression.
En 2017, l’ancien IRSTEA donnait également à voir quelques chiffres sur des pratiques liées à l’efficience du matériel d’irrigation et du pilotage (Serra-Wittling and Molle, 2017), avec notamment :
- en grandes cultures, des économies de 10 à 25% en passant d’un enrouleur à un pivot, et de 10 à 35% en passant d’une aspersion à un goutte à goutte. Les sondes de sol permettraient de réaliser des économies d’eau de 8 à 40% d’économies d’eau
- en maraîchage de plein champ, des économies d’eau de 30 à 90% pourraient être attendues
Les systèmes d’irrigation agricole n’apportent à la plante qu’une partie de l’eau prélevée (Figure 18). Moderniser les dispositifs d’irrigation constitue donc une voie d’économie potentielle, mais avec certaines limites. D’abord, une partie de l’eau prélevée pour l’irrigation qui n’arrive pas à la plante n’est pas perdue pour autant. Elle peut retourner au milieu en rechargeant les nappes et en participant ainsi au bon fonctionnement hydrologique d’un bassin versant. L’image d’archaisme ou de gaspillage d’eau derrière les systèmes des canaux d’irrigation gravitaire pourrait en réalité être contrebalancé par l’avantage de fonctionner sans énergie extérieure (aucun pompage) et de ralentir le rythme d’écoulement de l’eau vers la mer en favorisant l’infiltration dans les nappes.
Outre le fait que nous manquons de référence sur certains matériels, nous connaissons aussi surtout assez mal les consommations réelles. Les efficiences d’utilisation de l’eau varient aussi en fonction des besoins d’arrosage de la parcelle. Lorsque les besoins en eau sont faibles, les agriculteurs arrosent généralement pour être en situation de confort et ne font donc pas nécessairement attention à leur manière de gérer l’eau. En situations tendues, les efficiences remontent parce que les dispositifs sont réglés pour apporter les besoins demandés et pas au-delà. Pour autant, même si les systèmes par aspersion ou goutte à goutte sont plus efficaces, il n’est pas question de jeter la proposition de l’irrigation gravitaire. L’efficacité ne doit pas se raisonner qu’à l’échelle de la parcelle (nous en avons sufissament parlé). L’irrigation gravitaire a des effets secondaires sur son environnement et ne profite pas qu’à la culture arrosée. En goutte à goutte, puisque l’on n’humecte qu’une petite partie du sol, la résilience des plantes est beaucoup plus faible que dans le cadre d’une irrigation par aspersion, là où les plantes disposeront d’eau dans un volume de sol plus important.
La modernisation des systèmes d’irrigation existants (réparation des fuites, couverture des canaux à surface libre pour réduire l’évaporation, passage à des systèmes d’irrigation plus efficaces, etc.) peut conduire à une utilisation plus rationnelle de l’eau. Il faut cependant souligner que, selon le contexte, l’amélioration de l’efficience n’implique pas nécessairement une économie d’eau. D’une part le matériel plus performant peut nécessiter une technicité plus grande de la part de l’utilisateur qui, si elle n’est pas mise en oeuvre, ne permettra pas l’économie d’eau escomptée. Le goutte-à-goutte est un système très efficient mais si les vannes restent intempestivement ouvertes, la consommation d’eau à la parcelle ne sera pas forcément réduite. Par exemple, pour concevoir et gérer un système d’irrigation goutte à goutte de surface, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de la distribution de l’eau, des schémas de mouillage, de l’espacement entre les goutteurs et les émetteurs afin d’éviter une perte d’eau plus importante due au processus d’évaporation à la surface du sol et à l’efficacité de l’utilisation de l’eau. D’autres part, les économies d’eau réalisées peuvent conduire à des effets rebonds non attendus. C’est par exemple le cas si l’on intensifie les cultures, que l’on étend le périmètre d’irrigation, ou encore que l’on adopte des cultures à plus haute valeur ajoutée qui nécessiteront de l’eau. En outre, par un phénomène connu sous le nom de paradoxe hydrologique, une irrigation plus efficace peut réduire le retour des eaux de surface aux rivières, diminuant ainsi les débits de base bénéfiques pour les usagers en aval et les écosystèmes sensibles.
En France, dans la plupart des réseaux (et dans la mesure où ces réseaux sont à la demande), il existe une bonne adéquation entre l’optimum de distribution que l’on peut obtenir à la parcelle et la capacité des réseaux à fournir cet optimum. Parfois, dans certains cas, des discussions ont lieu entre le fournisseur d’eau et l’agriculteur en fonction de l’agro-équipement utilisé pour éviter par exemple de faire de l’aspersion quand il y a des vents thermiques (contrairement à ce qui est peut-être intuitif, ce n’est pas la chaleur, quand on arrose en plein midi, qui cause le plus de pertes, mais bien le vent). L’évaporation est bien évidemment un enjeu mais le problème est peut-être surtout dans la dégradation de l’uniformité de l’arrosage qui génère des zones surdosées (avec des percolations profondes) et des zones sous dosées où les plantes se battent pour pousser. Une conséquence étant que les agris arrosent encore plus et amplifient le phénomène.
Hors France, dans certains endroits comme au Maroc par exemple, les dispositifs d’accès à l’eau ne sont pas à la demande ou sont soumis à des tours d’eau de durée importantes ce qui fait que la conversion au goutte à goutte n’arrive pas à donner de résultats parce que les agriculteurs marocains ont la capacité de maintenir l’alimentation d’eau à flux tendu. Les catastrophes commencent à arriver lorsqu’il n’y a plus de fourniture régulière d’eau.
Les autres approches de renforcement de la ressource en eau
Florilège des autres approches de renforcement de la ressource en eau :
- Certains produits comme des hydro-rétenteurs, non autorisés en France, pourraient être mis dans la terre pour capter l’eau et éviter qu’elle ne s’infiltre ou ne se perde pas évaporation. Ces produits peuvent être considérés comme des systèmes d’augmentation de la ressource en eau.
- La sélection génétique (qu’elle soit naturelle ou non) via la création de nouvelles variétés, l’utilisation de nouvelles méthodes de sélection, l’importation de matériel végétal provenant de région plus chaude et/ou plus aride, ou encore la mobilisation de variétés anciennes sont autant de moyens de penser la réduction de la demande en eau des plantes
- Le drainage peut être utilisé pour limiter la stagnation de l’eau dans les parcelles agricoles. S’il est contrôlé, le drainage peut être intéressant pour maintenir une nappe élevée à certaines périodes de l’année. Cette eau pourrait aussi, si elle était collectée, rejoindre le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées. En évacuant l’eau vers l’aval de manière très rapide, le drainage peut questionner quant à son impact sur la biodiversité, notamment s’il favorise l’assèchement de certaines zones agricoles ou environnementales.
- La réutilisation de l’eau usée traitée (REUT) : Dans l’Hexagone, le taux de réutilisation des eaux usées est inférieur à 0,6 %, alors qu’il est de 2,4 % en moyenne en Europe du Nord et beaucoup plus élevé dans les pays méditerranéens : 90, 85 et 60 %, respectivement, pour Chypre, Israël et Malte. Les Assises de l’eau de 2019 ont fixé un objectif de triplement de la réutilisation des eaux usées en France à l’horizon 2025, mais il faut garder en tête que l’émergence de tels projets est assez long. Les scénarios de REUT sont extrêmement nombreux (boue activée vs filtres de roseaux, systèmes membranaires…) et bénéficient d’une image socialement acceptable de la réutilisation de l’eau parce que nous partons tous du principe que le remplacement des ressources naturelles conventionnelles par des ressources régénérées réduit la pression sur les masses d’eau. Tous les projets ne font néanmoins pas forcément sens parce qu’ils peuvent aussi perturber un équilibre local ou encore utiliser une nappe d’accompagnement d’une rivière (la REUT va prendre de l’eau à un endroit et la rejeter à un autre endroit). Est-ce que toute l’eau de REUT pourrait être utilisée en agriculture ? Ce n’est pas forcément la meilleure question à poser et le sujet soulève des considérations réglementaires (ça évolue quand même assez vite), sanitaires (en France, on ne peut pas mélanger l’eau d’irrigation et l’eau de REUT), de coûts économiques, et de coûts énergétiques. Les besoins en eau ne sont pas homogènes tout le long de la saison en agriculture. Si nous ne sommes pas en capacité d’augmenter les volumes irrigués, les projets ne peuvent venir qu’en substitution de ce qui existe déjà. La REUT, comme d’autres approches de renforcement de la ressource en eau, peut être amenée à créer de nouveaux usages de l’eau sur certains territoires.
- Les transferts d’eau entre bassins consistent à renforcer la ressource en eau superficielle insuffisante d’un bassin en transportant vers ce bassin des volumes d’eau prélevés dans un autre bassin où l’eau est abondante. Les transferts d’eau peuvent se faire sur des distances relativement courtes mais se pratiquent aussi sur des distances plus importantes, déplaçant de l’eau d’un bassin sur l’autre (canal de la Durance pour Marseille, Aqua Domitia pour Montpellier et Narbonne, canal de la Neste dans le piémont pyrénéen). Les transferts d’eau entre bassins font désormais l’objet de questionnements, comme celui posé de l’impact économique à long terme sur le bassin donneur et du droit des générations futures.
- Les stations d’épuration (STEP) sont faites actuellement pour traiter de l’eau pour ne pas avoir d’impact sanitaire. Ce n’est pas fait pour réutiliser l’eau. Le traitement actuel de l’eau ne peut pas cibler que les pathogènes et agit nécessairement aussi sur les teneurs en azote ou encore en matière organique. Les stations actuelles ne sont réglementées que sur la matière organique. En plus de phénomènes de dilution, l’hypothèse est qu’en baissant le taux de matière organique, le nombre de pathogènes diminue également. L’étude prospective Dordogne 2050 a montré que, sur l’ensemble des stations d’épuration rurale des petites villes, la moitié de ces stations d’épuration aura, en 2050, un rejet qui représenterait 100% du débit actuel des rivières. La conclusion étant que l’on mettrait les rivières à sec…
- L’agrivoltaisme, lorsqu’il est utilisé pour protéger les cultures à haute valeur ajoutée de coups de chaud, permet de limiter l’évapotranspiration et le stress hydrique des plantes (voir dossier de blog)
- On pourrait être tenté de stocker l’eau des crues en considérant cette eau comme une eau en excès. Mais ces volumes sont parfois gigantesques. Dans le cas de la Seine par exemple, les 800 millions de m3 des réservoirs gérés par la structure « Seine Grands Lacs » pour l’écrêtement des crues et le soutien des bas débits ne pourraient absorber qu’environ 20% d’une crue centennale, ce qui est déjà beaucoup. Il est par conséquent difficile d’intercepter toute l’eau en excès lors d’une crue importante, même pour le plus calme des grands fleuves français. On pourrait néanmoins se demander si l’eau qui déborde d’une nappe peut être considérée comme de l’eau en excès.
- La recharge ou réalimentation artificielle (RA) d’un aquifère (recharge indirecte par infiltration, recharge directe par injection, la filtration par berge) consiste à introduire de manière volontaire et maîtrisée de l’eau dans une nappe pour augmenter sa recharge naturelle pour une utilisation ultérieure ou un bénéfice environnemental. Les eaux utilisées pour la recharge artificielle sont généralement des eaux de surface, des eaux usées traitées ou des eaux de dessalement. En France, les eaux utilisées proviennent essentiellement de cours d’eau. Le recours aux eaux usées traitées pour la recharge artificielle n’est pas autorisé en France, sauf arrêté préfectoral spécifique. La recharge artificielle de nappe présente un certain nombre d’avantages par rapport à un stockage en surface comme la limitation des pertes d’eau par évaporation, le maintien de la disponibilité des terrains au-dessus de la zone de stockage pour des usages urbains ou ruraux, ou encore les capacités d’épuration des eaux par le sol et le sous-sol. La recharge artificielle pose aussi des difficultés, avec notamment les risques associés au stockage de l’eau et son devenir dans le sous-sol. Par ailleurs, elle soulève des questions de gouvernance et d’acceptabilité sociale.
- Le dessalement de l’eau ou désalinisation (par osmose inverse ou distillation) est un processus qui permet d’obtenir de l’eau douce (potable ou pour l’irrigation mais c’est plus rare en fonction du coût économique du dessalement) à partir d’une eau saumâtre ou salée (eau de mer notamment). Outre son coût énergétique, la désalinisation produit des rejets d’eaux à forte salinité, les saumures. Par ailleurs, la température des effluents rejetés peut être jusqu’à 3°C supérieure à celle de l’eau de mer dans le cas de certaines usines de désalinisation thermique, et de nombreux éléments indésirables sont présents dans les effluents (chlore, cuivre, produits antitartres…). Au niveau des captages d’eau de mer, un autre problème majeur est celui de l’aspiration des organismes vivants dans les circuits d’eau – en particulier les phytoplanctons et zooplanctons. La désalinisation reste une solution de dernier recours.
- Les barrages servent à stocker et à réguler les débits d’eau – principalement pour l’usage des activités humaines (irrigation, production d’électricité, gestion des crues…). A l’échelle de la France, les 530 gros barrages recensés stockent déjà 12 milliards de m3. C’est près de 6% de l’ensemble des écoulements en France. Certains barrages sont conçus pour écrêter les crues, c’est à dire diminuer le débit maximum de la rivière pendant une crue.
- Dernière proposition avec les retenues de substitution et bassines dont nous reparlerons en fin de dossier. On estime à plus de 600 000 le nombre de retenues. Même si la plupart sont petites, les volumes stockés en période de hautes eaux ne sont pas négligeables, y compris par rapport aux écoulements. Du côté des nappes, les niveaux de nappe choisis pour les prélèvements de substitution sont généralement bien inférieurs au niveau de débordement. Ainsi, sur le marais Poitevin où des retenues de substitution prélèvent dans la nappe, les niveaux choisis sont plus proches du minimum observé en hiver que de la cote de débordement. Dans certains types de retenues, l’eau est néanmoins considérée comme en excès, car sinon, elle irait rejoindre la mer. C’est pourtant négliger de multiples rétroactions, tant chimiques, physiques, que biologiques et écologiques. Ainsi, sur le bassin méditerranéen, qui est une mer quasi-fermée, les apports d’eau douce ont été largement réduits du fait de la construction de barrages ayant créé des réservoirs (et de l’évaporation des plans d’eau) et de l’utilisation de cette eau pour les activités humaines.
Ces solutions, quelles qu’elles soient, doivent faire l’objet de solides analyses bénéfice-risques. Il reste important de garder en tête que les efforts en termes de gestion de l’eau ne se traduisent pas nécessairement en termes d’économie d’eau. L’efficience ou la productivité de l’eau peut être augmentée à régime constant d’eau si tant est que la variable de sortie (par exemple le rendement) augmente elle aussi. Il faut également porter une attention particulière à l’effet rebond ou le fait qu’un gain d’efficacité obtenu par une technologie est rapidement compensé par une adaptation des comportements qui pousse, in fine, à une utilisation accrue des ressources. Tout est une histoire d’équilibre entre les bénéfices et les risques prévisibles sur le long-terme.
Quelques idées reçues et abus de langages
Non, toutes les sécheresses ne se valent pas
Les arrêtés sécheresse se sont multipliés en 2022 et sont apparus de plus en plus tôt dans la saison en concernant toujours plus de départements. Les sécheresses sont le produit de plusieurs phénomènes qui peuvent se combiner (Reghezza and Habets, 2022):
- la sécheresse météorologique, résultant du manque de pluie
- la sécheresse agricole, résultant d’un manque d’eau dans les sols ;
- la sécheresse hydrologique, résultant d’un niveau bas des nappes souterraines, des retenues de surface et des cours d’eau.
Notez bien que lorsqu’il n’y a pas d’eau dans l’air, on parle de canicule – et que lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le sol, on parle de sécheresse.
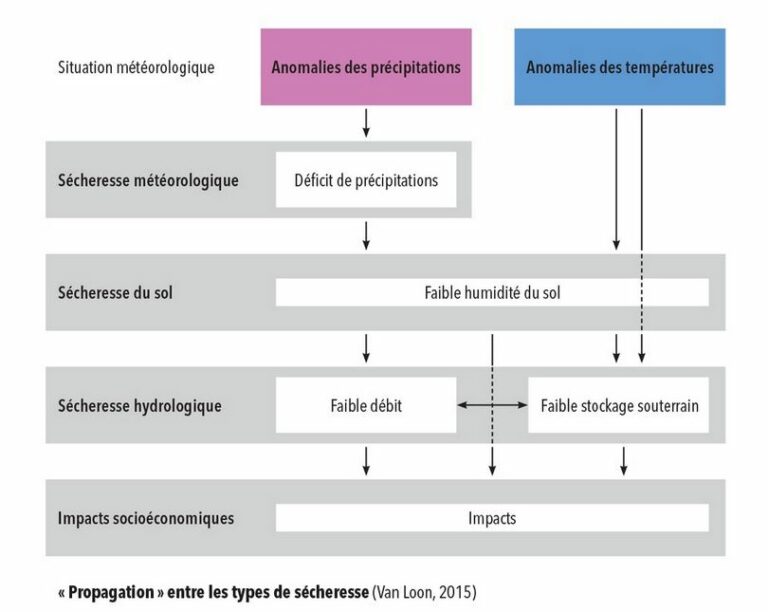
Figure 22. Les différents états de sécheresse. Source : Van Loon, 2015 – tiré du dossier de Reghezza and Habets sur le site de Bon Pote (2022).
Ces différences sont importantes pour comprendre l’impact des pluies. Les sécheresses hivernales que nous vivons, et notamment cette année 2023 avec des cumuls de mois anormalement secs et chauds, entraînent une forte inertie pour la recharge hydrologique. En France, même si les pluies récentes ont permis effectivement de recharger les sols agricoles, les nappes phréatiques restent sèches avec des records toujours très bas (voir les cartes du BRGM sur la figure 11 du dossier). Les pluies réellement efficaces sont moins importantes. Ce n’est pas parce que les cours d’eau coulent en surface et que les sols sont enfin rechargés que la sécheresse des nappes phréatiques s’est atténuée. Les pluies de cette année sont arrivées après la fin de la saison de recharge.
Les pluies telles que nous les avons vécues permettent d’atténuer la sécheresse des sols agricoles et ainsi d’éviter d’avoir recours à l’irrigation et c’est une nouvelle d’autant plus intéressante que les nappes phréatiques ne pourront pas soutenir l’irrigation. Les impacts de ces pluies peuvent être immédiats (reprise ou accélération de la croissance pour les végétaux notamment fourrage, jeunes plants de maraîchage, diminution du risque d’incendie) si tant est que les pluies ne sont pas trop intenses et ne génèrent pas du ruissellement.
La vapeur d’eau est bien un gaz à effet de serre
La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre et contribue par là même au déréglement climatique. Elle n’est pas le moteur du réchauffement climatique (qui reste les émissions de CO2, méthane etc…), mais elle y participe par un effet amplificateur. De manière générale, la vapeur d’eau joue un rôle majeur dans l’effet de serre, 60 à 80% de l’énergie captée et renvoyée vers la surface par effet de serre l’étant par la vapeur d’eau.
Une atmosphère plus chaude peut contenir plus d’eau sous forme de vapeur, et par conséquent un réchauffement initial de l’air va entraîner un réchauffement encore plus fort du fait de l’augmentation de la concentration en vapeur d’eau dans l’atmosphère (l’eau est disponible en quantité essentiellement illimitée dans les océans, d’où l’ajustement rapide).
Néanmoins, la concentration en vapeur d’eau dans l’atmosphère varie uniquement globalement en fonction de la température. C’est principalement dû au temps de résidence très court de la vapeur d’eau dans l’atmosphère (de l’ordre de 10 jours) qui ne laisse pas le temps à l’eau de modifier durablement l’équilibre énergétique de la Terre, ainsi qu’au fait que la vapeur d’eau va avoir tendance à se condenser en eau liquide (nuages, puis précipitation) lorsque sa concentration devient trop importante. Les rejets directs de vapeur d’eau par les humains (centrale électrique, par exemple) ne jouent donc aucun rôle dans le changement climatique à l’échelle mondiale. Les actions humaines peuvent être importantes cela dit au niveau local, notamment via l’irrigation qui peut modifier la distribution des pluies et les flux d’énergie au niveau régional. Nous avons vu plus haut dans le dossier que la déforestation a aussi un fort impact sur le climat régional, en modifiant les flux d’eau (les arbres transpirent) et donc le régime des pluies (nous en avons déjà parlé sur les différents cycles de l’eau).
Comme l’air se réchauffe sous l’effet de l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre (GES), il contient plus de vapeur d’eau (+7% par degré supplémentaire). Ce phénomène contribue à emprisonner encore plus de chaleur et amplifie le réchauffement climatique. C’est ce qu’on appelle une boucle de rétroaction : un phénomène (le réchauffement dû aux émissions de CO2 et de méthane) en produit un autre (augmentation de la concentration en vapeur d’eau dans l’atmosphère), lequel augmente le premier (le réchauffement climatique), et ainsi de suite.
Les modèles climatiques prennent tout à fait en compte la rétroaction de l’eau (c’est finalement un mécanisme relativement simple – la température augmente, l’évaporation aussi au-dessus des océans). Les incertitudes des modèles climatiques résident surtout au niveau des nuages parce que l’on ne comprend pas bien encore le devenir de la couverture nuageuse. Les mers subtropicales froides (Canaries, Californie) sont souvent couvertes par des nuages bas et très denses qui jouent un rôle très important dans l’albédo terrestre. Les modèles climatiques ne prennent pas non plus en compte (ou du moins très imparfaitement encore) l’impact de l’irrigation ou de la déforestation.
Eau prélevée ou eau consommée ?
En France, l’agriculture, au travers de l’irrigation essentiellement, représente environ 9 % des prélèvements d’eau, mais 48 % de la consommation (Figure 23 – les chiffres varient néanmoins un peu selon les sources). C’est le secteur qui consomme le plus d’eau dans le sens où l’eau prélevée par les plantes n’est pas restituée localement. Cette eau est évapotranspirée et réintègre le cycle sous forme de vapeur avant de retomber ailleurs sous forme de précipitations. Si l’on se place du point de vue local, l’eau est donc perdue, mais en réalité, on devrait plutôt dire qu’elle est déplacée dans le cycle.
Les prélèvements pour l’irrigation peuvent être compensés par des lâchers d’eau à partir de barrages en amont. Des retenues collinaires ou autres infrastructures de stockages (bassines entre autres) peuvent être utilisées (nous en reparlerons plus loin).
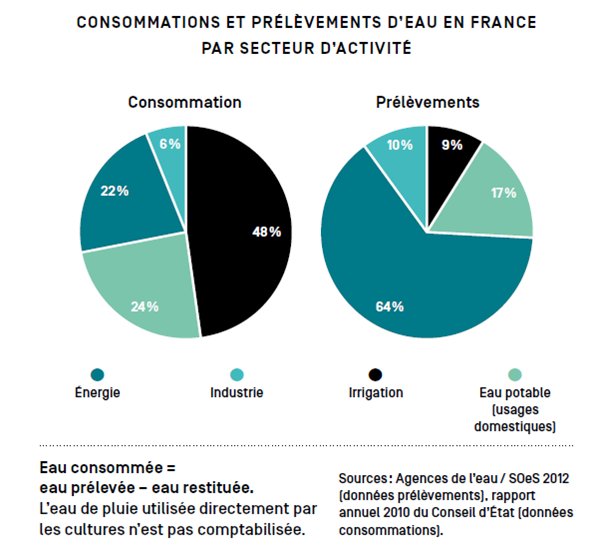
Figure 23. Consommations et prélèvements d’eau en France. Les chiffres varient selon les sources. Le gouvernement met par exemple en avant que le secteur de l’énergie est à l’origine de 50% (au lieu des 64%) des prélèvements d’eau et que 98 % de l’eau prélevée par les centrales est restituée à l’environnement. Notez que les prélèvements d’eau sont en baisse depuis le début des années 2000 excepté dans le secteur agricole (MTES, 2018)
Le secteur de l’énergie est celui qui prélève le plus d’eau (à plus de 60%), essentiellement à cause des besoins en refroidissement des condenseurs des installations nucléaires. Chaque tranche nucléaire consomme en effet entre 50 millions de m3 et 1,5 milliard de m3 par an, selon sa puissance et surtout selon que le refroidissement est effectué en circuit fermé (avec tour aéroréfrigérante) ou en circuit ouvert (le plus gourmand en eau). La part des réacteurs en circuit ouvert et en circuit fermé dans le parc installé en France est quasi-équivalente. Ces besoins importants en eau expliquent pourquoi les centrales nucléaires sont construites soit sur des cours d’eau à débit important, avec construction en amont d’ouvrages hydrauliques destinés à réguler les débits (retenues fournissant de l’eau en cas de débit insuffisant, ou à l’inverse stockant l’eau excédentaire pour éviter les inondations), soit en bord de mer ou dans les estuaires. La demande électrique plus faible l’été rend néanmoins cette contrainte supportable pour le système de production électrique.
L’eau potable représente 17% du volume prélevé en France (dont 30% environ sont perdus sous forme de fuites dans les réseaux de transport et de distribution). Les bains et douches sont le premier poste de consommation d’eau potable en France (40% environ).
Contrairement à l’eau utilisée en agriculture, l’eau utilisée pour refroidir des centrales thermiques classiques ou nucléaires, ou l’eau utilisée pour la consommation domestique, est partiellement ou totalement restituée, le plus souvent à proximité du point de prélèvement. Plus spécifiquement pour le secteur nucléaire, lorsque le réacteur est refroidi en circuit ouvert, l’eau est restituée en quasi-totalité au milieu en aval du système de refroidissement, à une température supérieure à la température de l’eau lors de son prélèvement (l’échauffement de l’eau est de l’ordre de 10 à 15 degrés, ramenée à quelques degrés après mélange avec l’eau prélevée en aval). Lorsque le réacteur est refroidi en circuit fermé, l’eau prélevée n’est que partiellement restituée au milieu, puisque de 20 à 40 % des quantités prélevées s’évaporent dans les tours aéroréfrigérantes. Sous réserve de respecter certains critères, l’eau issue des centrales peut donc être réutilisée, notamment en termes de température et de qualité. Les points de rejet peuvent malgré tout se situer à distance du point de prélèvement, en particulier dans le cas de dérivation (canaux).
Petit aparté sur l’eau potable. Le réseau d’eau potable Français représente à lui seul plus de 900 000 kms. Le taux de renouvellement annuel des canalisations est de 0,67 %, soit, en moyenne, une remise à neuf tous les 160 ans alors que la durée de vie d’une canalisation oscille autour de 80 ans. En rajoutant un taux de fuite moyen estimé à 20% (pouvant atteindre parfois jusqu’à 50% sur certains territoires), ce sont des milliards de m3 d’eau qui sortent chaque année de nos canalisations et qui ne sont pas distribuées directement aux habitants (mais qui sont potentiellement restitués au milieu…).
La distinction entre eau prélevée et eau consommée est toutefois assez artificielle. L’eau considérée comme consommée est parfois en large partie restituée au milieu, qu’il s’agisse de l’eau potable distribuée au consommateur ou de l’eau destinée à l’irrigation, dont une part importante peut ne pas aller à la plante mais s’infiltrer dans les sols. Cette restitution au milieu se fait en général dans une grande proximité géographique avec les lieux de prélèvement, puisque les réseaux d’irrigation comme les réseaux d’eau potable sont des réseaux locaux.
Débits d’étiage, débits biologiques et débits écologiques
Plus généralement, même si certains peuvent trouver de l’intérêt à la distinction entre l’eau prélevée et l’eau consommée, c’est surtout l’impact sur les écosystèmes qui doit être considéré. Se pose alors la question de seuils autour des différents volumes d’eau prélevables et consommables. Toute la difficulté réside dans le fait que la notion de débit évolue au gré des considérations écologiques, techniques ou encore économiques (Figure 24).
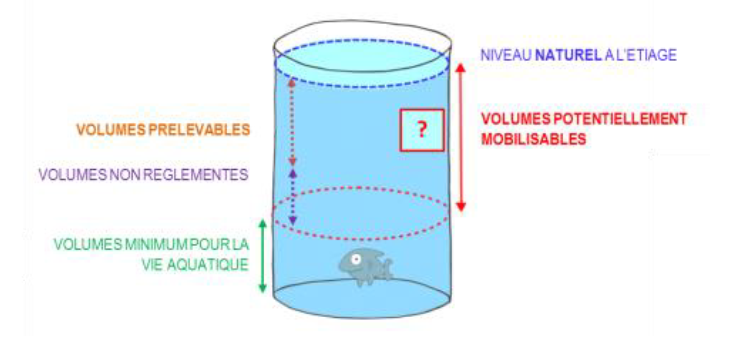
Figure 24. Les différentes notions de volumes d’eau prélevables et non prélevables.
En accord avec la Directive-Cadre européenne sur l’eau et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, des volumes (maximum) prélevables sont définis dans les zones à déficit hydrique structurel, ou les zones de répartition des eaux (ZRE). Ces volumes incluent évidemment l’ensemble des différents usages, dont l’irrigation.
Le cadre réglementaire impose de définir des débits objectifs d’étiage (DOE) permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux. La valeur des débits objectifs d’étiage prend son sens par référence à la valeur du débit moyen mensuel minimum de fréquence quinquennale sèche (QMNA5), dont la période de retour est par définition proche de l’objectif de satisfaction des équilibres besoins ressources, c’est à dire en moyenne les 8 années sur 10 évoquées en début de paragraphe. Ces débits objectifs d’étiage sont généralement obtenus après des études de volumes prélevables (EVP), basées sur une expertise hydrologique ou hydrogéologique pointue, qui se doivent d’être régulièrement remises à jour.
Le respect des débits objectifs d’étiage est une contrainte forte qui contribue notamment à aggraver la distorsion entre les besoins des différents usages et les disponibilités estivales d’autant que pour maintenir un débit d’objectif d’étiage (DOE), il faut déjà s’assurer qu’une quantité d’eau circule dans chaque tronçon du réseau superficiel. Fixé trop haut, ce débit conduit à interdire tout prélèvement agricole à certaines périodes critiques de l’année. Son principe même interroge dans des zones où l’assèchement total d’un cours d’eau l’été pourrait être acceptable plutôt que de voir s’arrêter toute l’activité agricole d’une vallée. Des débats existent déjà sur l’évaluation de la ressource disponible parce que les modèles à l’origine des débits d’objectifs d’étiage (DOE) reposent nécessairement sur des hypothèses de travail et des extrapolations.
Les exigences de ces débits d’étiage se traduisent théoriquement par :
- un DOE permettant de respecter le débit écologique nécessaire à la satisfaction des besoins des milieux aquatiques. Dans le cas où plusieurs débits écologiques auraient été définis, le DOE visera le respect de l’ensemble des débits écologiques de l’unité de gestion considérée,
- un DOE borné, pour sa valeur maximum, par le débit d’étiage mensuel naturel du cours d’eau en dehors de tout prélèvement et de toute artificialisation du régime des eaux sur le bassin versant. Actuellement il est considéré que, sauf cas particulier, il n’y a pas lieu de se fixer un objectif meilleur que l’état naturel observé 8 années sur 10 (ou 4 années sur 5).
Les volumes potentiellement mobilisables sont obtenus en faisant la différence entre le débit plancher du DOE et ce que l’hydrologie mensuelle est en mesure de garantir 4 années sur 5, à savoir les débits mensuels quinquennaux secs de chaque mois (c’est la référence QMNA5 citée plus haut). A chaque plage de DOE est associée une plage mensuelle de Volume Potentiellement Mobilisable (VPM). Lorsque l’on agrège des DOE mensuels en un seul DOE saisonnier et qu’on lisse les volumes potentiellement mobilisables sur plusieurs mois, on prend collectivement le risque de manquer l’objectif de satisfaction des besoins et des usages au coeur des mois d’étiage. De la même manière, les DOE et les débits biologiques définis au pas de temps mensuel ne prémunissent pas des épisodes de sécheresses journalières.
Les enjeux de préservation des écosystèmes ont conduit à définir des notions de débits biologiques et écologiques. Le débit biologique est entendu comme le débit dans le lit d’un cours d’eau permettant le bon fonctionnement général des communautés vivantes aquatiques situées sur le bassin versant amont. Le débit écologique intègre au débit biologique les objectifs supplémentaires de bon état des eaux (physico chimie…). Ces deux notions se distinguent du Débit Minimum Biologique (DMB) défini comme le débit minimum devant être maintenu à l’aval d’un ouvrage en cours d’eau et garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. La notion de DMB est une valeur instantanée, rattachée à un ouvrage et au tronçon de cours d’eau situé directement en aval. Elle conduit à la définition de débits réservés journaliers à respecter en aval de l’ouvrage.
De manière courante, le « débit biologique » et le « débit écologique » sont des débits mensuels visant à garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques, dans le cadre d’une démarche intégrée de gestion structurelle et équilibrée de la ressource en eau, à l’échelle d’un bassin versant. Ces différents débits sont notamment fonction de :
- valeurs de débit à un instant donné, avec une attention particulière pour les valeurs minimales et maximales,
- fréquences auxquelles certaines valeurs de débits sont observées. Pour les crues et les étiages, on parle de période de retour (annuelle, quinquennale, décennale, centennale),
- durées pendant lesquelles le débit est supérieur ou inférieur à une valeur seuil, prévisibilité des événements, régularité avec laquelle certains épisodes hydrologiques reviennent et sur lesquels s’ajustent les stratégies biologiques,
- stabilité, vitesses de changement de débit sur une courte période.
Le débit objectif d’étiage (DOE) résultait initialement d’un objectif de partage équitable de la ressource entre l’amont et l’aval d’une rivière. L’intention était que les intervenants de l’amont ne privent pas d’eau les intervenants en aval (par exemple pour l’irrigation). Le débit réservé répond aujourd’hui davantage à une préoccupation environnementale, de gestion de la réserve en eau pour l’alimentation des nappes superficielles et souterraines, mais aussi de garantie de la bonne circulation des sédiments ou encore de préservation de la biodiversité en assurant une continuité écologique tout le long du cours d’eau afin de conserver la faune et la flore. Si la préservation d’un débit réservé est un principe en apparence vertueux pour une gestion équilibrée des écoulements dans les cours d’eau, il peut conduire à favoriser l’amont sur l’aval, alors même que le dessèchement de l’aval peut poser davantage de problèmes que le celui de l’amont. Par ailleurs, conserver un débit réservé peut ne pas être possible lorsque des cours d’eau s’assèchent totalement en période d’étiage. En outre, là où le pompage et l’irrigation sont importants, il est très difficile de connaître ce qu’est le niveau normal d’écoulement d’un cours d’eau (module naturel). Il peut donc être nécessaire de réaliser des calculs pour estimer le module naturel reconstitué (c’est ce que à quoi s’attelle par exemple le projet Explore 2).
D’un point de vue hydro-écologique et d’écologie fondamentale, la fixation de ces seuils de débits est particulièrement compliquée parce que nous manquons de connaissances sur le sujet. Les conditions de remplissage des retenues de substitution d’irrigation en période hivernale posent par exemple la question de l’impact environnemental d’une réduction des débits ou d’une baisse des piézométries durant cette période (nous en reparlerons dans le cadre de l’actualité récente autour de Saintes Solines).
Le Débit Seuil d’Alerte (DSA) et le Débit de Crise (DCR), sont des seuils utilisés pour la gestion de crise. Ces seuils, exprimés en débits moyens journaliers, sont des seuils opérationnels comparés quotidiennement au débit journalier. Par comparaison, le débit objectif d’étiage (DOE) est une valeur moyenne mensuelle assortie de probabilité et destiné à être analysé rétrospectivement. Sur des cours d’eau à tarissements rapides, la valeur de DSA peut être supérieure au DOE afin de ménager différents niveaux dans le dispositif de restriction et de ne pas atteindre le DCR.
Toutes les valeurs de débits se doivent maintenant d’être questionnées au regard du changement climatique et de ses conséquences sur l’hydrologie. L’impact du changement climatique sur l’hydrologie des cours d’eau va globalement générer une baisse des débits naturels des cours d’eau. L’impact sur les milieux de cette baisse de débits sera particulièrement aggravé en période de basses eaux par l’augmentation de la température de l’eau. A prélèvements constants, les DOE actuels risquent de ne plus être respectés 8 années sur 10. Pour autant, les besoins des milieux aquatiques en termes de débit ne vont pas diminuer et risquent même d’augmenter dans ce contexte d’augmentation de la température de l’eau.
Pour travailler de la manière la plus fine possible, la description de chaque usage doit être la plus exhaustive possible : nature (prélèvement et/ou rejet), finalité, localisation, volumes annuels et mensuels, répartition spatiale et temporelle des prélèvements, débits de prélèvement, débit minimum de fonctionnement, ressource concernée etc. Une attention particulière doit être portée à l’identification des ressources souterraines mobilisées et aux interactions entre celles-ci et les écoulements superficiels. L’ensemble des usages dépendant de l’eau sont concernés qu’ils soient directs, diffus, consommateur d’eau ou non. Les études hydrologiques solides doivent considérer (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2022) :
- une analyse des caractéristiques hydromorphologiques et de leur évolution, naturelle ou influencée,
- une analyse des relations débit-qualité pour les cours d’eau avec une analyse de la physicochimie et de l’hydromorphologie,
- une analyse hydrogéologique dès lors que le milieu souterrain est concerné : évolution piézométrique interannuelle, interactions nappe rivière, impact de la piézométrie sur les milieux superficiels,
- la prise en compte de l’état des masses d’eau sur le bassin considéré,
- la prise en compte des réservoirs biologiques identifiés sur le bassin considéré,
- la prise en compte du registre des zones protégées,
- la prise en compte, pour les bassins littoraux, des besoins en eau douce des espèces marines, sans exclure la définition d’objectif de salinité sur des points nodaux pertinents.
L’empreinte virtuelle de l’eau
Bien qu’encore relativement peu connu, le concept d’«empreinte eau » ou « d’eau virtuelle » n’a pas grand-chose à envier à celui de l’empreinte carbone maintenant largement démocratisé (le projet RSEAU a été récemment proposé pour intégrer la dimension eau dans la comptabilité des entreprises). L’idée sous-jacente est finalement assez proche.
La ressource en eau est assez spécifique parce que c’est une des seules ressources où l’on dispose aujourd’hui d’indicateurs bien spatialisées et de pas de temps mensuels pour calculer des impacts (c’est une grosse avancée et plus-value pour rendre opérationnelle l’évaluation des impacts). Pour les problématiques liées au carbone, les indicateurs spatialisées n’ont finalement que peu de sens parce que le sujet est d’envergure est globale. Pour l’azote, la localisation des émissions est importante mais il n’existe pas encore de méthodes suffisamment consensuelles.
Malgré tout, il faut quand même bien se rendre compte que de manière générale, les exigences en matière d’inventaire des méthodes d’empreinte hydrique diffèrent considérablement. La disponibilité des facteurs de caractérisation nécessaires à une analyse de cycle de vie (ACV) et la qualité des données à disposition sont eux aussi soumis à une grande variabilité. En raison d’un manque de données, certaines bases de données, telles que Ecoinvent ne contiennent que des flux d’entrée d’eau douce, mais pas de flux de sortie d’eaux usées, et permettent donc de déterminer l’utilisation de l’eau, mais pas la consommation d’eau. D’autres bases de données, telles que GaBi, fournissent des chiffres sur l’utilisation et la consommation, mais ne prennent en compte qu’une partie des usages et la production d’électricité.
La notion d’empreinte eau est souvent mal comprise. Plusieurs exemples peuvent en témoigner. C’est déjà par exemple l’exemple du Jean de Levis. L’entreprise Levis avait fait passer une publicité vantant l’idée que si chacun arrêtait de laver son jean (ou diminuait le nombre de fois où le jean était lavé), chacun économiserait de l’eau potable. Le passage à la machine à laver consomme de l’électricité mais, outre l’eau évaporée au moment du séchage du jean, l’eau utilisée dans la machine retourne dans la station d’épuration et dans les rivières (et retourne en quelque sorte directement dans le milieu). Il n’y a donc nullement d’eau potable sauvegardée. Par contre, l’eau utilisée en agriculture pour la production de coton qui servira à fabriquer le jean, elle, sera en grande majorité évapotranspirée par les plantes et retournera dans le grand cycle de l’eau ou le petit cycle continental et sera donc potentiellement perdue localement.
Le chiffre également bien connu de 13.000 litres d’eau utilisé pour produire un kilo de boeuf est basé sur la méthodologie d’analyse de cycle de vie (ACV) qui comptabilise l’eau de pluie comme si c’était de l’eau de nettoyage de ligne dans une usine, c’est à dire sans tenir compte du cycle de l’eau. La méthode ACV qui vient de l’industrie néglige en général l’effet du recyclage de l’eau et c’est bien là que le bât blesse dans le sens où la grande majorité de l’eau consommée en agriculture est recyclée (elle repart dans les cycles de l’eau), dont en particulier l’eau de pluie. Dire que l’on consomme 13.000 litres d’eau pour faire un kilo de boeuf est particulièrement faux. La quantité réellement consommée par notre kilo boeuf au sein du grand cycle naturel de l’eau est inférieure à 1%. En France, des calculs en prenant en compte ces limitations donnent plutôt des niveaux d’utilisation de 20 et 50 litres d’eau par kilo de boeuf, ce qui est déjà important mais qui n’a rien à voir en terme d’ordre de grandeur. La méthodologie ACV brute n’est pas particulièrement adaptée pour travailler sur les consommations d’eau en agriculture. On pourrait rajouter aussi que l’agrégation de l’eau bleue et de l’eau verte en un seul chiffre masque les avantages de l’agriculture pluviale par rapport à l’agriculture irriguée. Il pourrait d’ailleurs être intéressant de compter l’eau non seulement en termes de kilogramme de produits mais aussi en terme de kilo de protéine ou kilocalorie produite.
À l’instar de la catégorie d’impact « changement climatique » et de l’empreinte carbone (qui sont normalisées ISO), les conséquences de l’utilisation de l’eau peuvent être évaluées en tant que catégorie d’impact dans le cadre de l’analyse du cycle de vie ou en tant qu’empreinte hydrique autonome. On s’attachera plutôt ici à parler d’empreinte hydrique individuelle en tant que forme particulière d’ACV. Les méthodes d’analyse de l’utilisation de l’eau dans l’ACV peuvent être classées en approches comptables et en approches d’évaluation d’impact. Les méthodes comptables restent au niveau volumétrique et fournissent la base de toute évaluation d’impact ultérieure.
Contrairement aux approches volumétriques de l’eau virtuelle et de l’empreinte hydrique, l’ACV vise à évaluer les impacts régionaux en plus des volumes d’eau utilisés tout au long du cycle de vie d’un produit (Berger and Finkbeiner, 2012 ; Berger et al., 2016). Cette interprétation différente de l’empreinte hydrique en tant qu’indicateur volumétrique ou axé sur l’impact a suscité de vives controverses au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs soulignent la nécessité d’une interprétation supplémentaire, car 1 m³ d’eau de pluie consommée au Brésil n’est pas comparable à 1 m³ d’eau souterraine consommée en Égypte (les notions de volume utilisé et volume consommé ont ainsi des significations spatiales différente). D’autres auteurs affirment au contraire que l’appropriation de l’eau douce à l’échelle mondiale est plus importante car les impacts sont difficiles à prévoir et l’eau est une ressource mondiale qui fait l’objet d’un commerce virtuel par le biais de tous les produits qui ont nécessité de l’eau à un moment ou un l’autre de leur fabrication. Certains auteurs rajoutent que les empreintes hydriques axées sur l’impact sans interprétation physique sont complètement dénuées de sens, donnant lieux à des choix de pondération discutables, surtout que les conditions environnementales locales qui influencent les impacts seraient assez mal décrites. Néanmoins, le consensus général aurait tendance à s’orienter vers des approches mixtes en combinant à la fois des méthodes à impact et des méthodes volumétriques.
Le fait qu’il existe plusieurs modèles de caractérisation disponibles pour la consommation d’eau ne doit pas être vu comme un problème en soi à l’heure actuelle. Cela reflète au contraire la complexité de la réalité. Tant qu’il n’existe pas de consensus généralisé sur l’évaluation de d’empreinte hydrique axée sur les impacts et traitant de manière cohérente toutes les voies d’impact, il convient d’appliquer plusieurs méthodes de caractérisation afin d’analyser les différentes implications. L’United Nations Environment Programme (UNEP) a commandité un indicateur « Aware LCA » pour définir la méthode la plus appropriée pour calculer des empreintes eau en fonction de ces usages.
Le concept d’empreinte eau présente l’intérêt de faire prendre conscience de notre dépendance à l’eau pour notre consommation courante, mais il ne dit rien des conditions dans lesquelles cette eau a été captée. Des produits à faible empreinte eau mais fabriqués à un endroit ou à une période où existe un fort stress hydrique ou à un endroit où la ressource est très sensible posent davantage de problèmes que des produits à forte empreinte eau issus de secteurs géographiques disposant de ressources abondantes. A titre d’exemple, les volumes d’eau consommés pour l’irrigation sont respectivement quatre et sept fois plus élevés en Italie et en Espagne qu’en France. A partir de ce moment-là, l’eau virtuelle importée pour notre alimentation (dans la filière fruits et légumes, principalement) représente un volume égal à celui que la France dédie à l’irrigation. Sous couvert d’une optimisation d’usage de l’eau et d’une recherche à tout prix d’économies d’eau nettes (on ne subventionne que ce qui permet de réduire le prélèvement), nous avons tendance à tomber dans des approches mono-factorielles et simplistes qui peinent à appréhender la complexité du monde. Une tomate irriguée dans le désert Jordanien sur un forage à 600m avec de l’eau déssalinisée est beaucoup moins vertueuse du point de vue du cycle de l’eau que le maraicher à côté de chez moi qui va travailler par inondation. L’amande a un très mauvais score sur l’usage de l’eau parce que l’amande californienne est très intensive en usage d’eau alors que l’on est tout à fait capable de faire des amandes avec un impact eau bien plus faible, sur des sols avec une bonne résistance à la sécheresse.
Les aspects spatiaux et temporels de la consommation d’eau sont fondamentaux. La distinction spatiale de la consommation d’eau est essentielle en raison de la grande variabilité des impacts associés. On pourrait d’ailleurs y rajouter qu’une perspective de bassin versant est nécessaire puisque les flux d’eau transférés d’un bassin versant à un autre doivent être pris en compte dans l’évaluation. En effet, si les prélèvements et les rejets ont lieu dans des bassins versants différents, il en résulte une consommation positive dans un bassin versant et une consommation négative dans le bassin versant où l’eau est rejetée. Il serait d’ailleurs possible d’aller plus loin en reprenant les concepts de bassins atmosphériques théorisés récemment (voir plus haut dans le dossier) puisque les masses d’eau échangés dans les petits et grands cycles de l’eau sont gigantesques.
Les aspects temporels ne sont généralement pas pris en compte dans les bases de données existantes et sont pourtant fondamentaux tant la disponibilité et la demande d’eau varient d’un moment à un autre. Les effets environnementaux liés à l’utilisation de l’eau dépendent du moment de son utilisation. Et ces sujets de temporalité sont particulièrement importants pour la production agricole, là où il existe une grande variabilité dans l’utilisation de l’eau d’un mois à l’autre en fonction de la saison de croissance des plantes. Une façon d’appréhender ce risque pourrait être d’utiliser un coefficient de stress basé sur le nombre de jours pendant lesquels les plantes n’ont pas accès à l’eau au cours de leur saison de croissance. On ignore souvent qu’un tel niveau de détail temporel nécessite la prise en compte des capacités de stockage intermensuelles qui peuvent tamponner les périodes de pénurie d’eau tout au long de l’année. Un ratio consommation/disponibilité d’un mois sec peut surestimer la pénurie lorsque les réservoirs d’eau créés au cours des mois humides précédents sont ignorés. A côté de ça, la résolution temporelle des évaluations de la rareté de l’eau conditionne également la résolution spatiale requise de l’évaluation. Les grands bassins peuvent avoir des durées d’écoulement de plusieurs mois entre le printemps et l’embouchure, ce qui rend difficile une évaluation mensuelle.
La plupart des méthodes se concentrent sur la consommation d’eau bleue. Les eaux vertes et grises sont principalement prises en compte par des méthodes autonomes afin de traiter l’évapotranspiration des eaux de pluie des produits agricoles et l’utilisation dégradante de l’eau douce, respectivement. La consommation d’eau provenant de l’humidité du sol (eau verte) est une question controversée dans l’empreinte hydrique car il s’agit d’une source d’eau naturelle reçue par l’intermédiaire de l’utilisation des terres. Seule la différence de consommation de cette eau par rapport à la situation naturelle peut être prise en compte. Par conséquent, ces formes indirectes de consommation d’eau doivent être liées aux inventaires d’utilisation des terres.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le sort de l’évaporation d’une manière spatialement explicite. Si l’on tient compte du recyclage de l’humidité atmosphérique, les inventaires actuels de l’eau changeront radicalement car l’eau évapotranspirée n’est plus considérée comme consommée en soi. Il pourrait même y avoir des crédits d’eau résultant de la précipitation de la vapeur d’eau créée synthétiquement lors de la combustion de combustibles fossiles. Ainsi, les voitures peuvent avoir une empreinte carbone positive mais une empreinte eau négative si elles roulent dans des régions où le recyclage de l’évaporation continentale est élevé.
En ce qui concerne la consommation d’eau verte, par exemple des plantes agricoles, il convient de noter que la végétation naturelle provoque également une évapotranspiration qui peut être encore plus élevée que celle des plantes agricoles. C’est pourquoi certains auteurs suggèrent de déterminer l' »empreinte verte nette de l’eau », c’est-à-dire la différence d’évapotranspiration entre les terres agricoles et les terres naturelles. Cependant, la pertinence de la consommation nette ou totale d’eau verte est discutable car l’humidité du sol n’est disponible que pour les plantes locales et ne peut pas être utilisée par les écosystèmes environnants ou prélevée pour les besoins humains.
La véritable question qu’il convient d’aborder est peut-être de savoir dans quelle mesure l’empreinte de l’eau verte affecte la disponibilité de l’eau bleue. Le sujet à traiter est particulièrement complexe dans le sens où cette question est étroitement liée à l’utilisation des terres. Lorsque les effets des changements d’utilisation des sols sur la disponibilité de l’eau bleue sont pris en compte, il convient d’être prudent car la transformation de terres naturelles en terres arables peut entraîner une augmentation de la disponibilité de l’eau bleue en raison de la modification du ruissellement de surface et des schémas de recharge des eaux souterraines. Une conséquence étrange ou surprenante tout de même est que l’on pourrait imaginer compenser son empreinte sur l’eau bleue par des changements dans l’utilisation des terres, tels que la déforestation. Cela ne tient néanmoins pas compte du fait que la végétation naturelle est un fondement important du cycle global de l’eau et que les changements d’utilisation des sols affectent ce cycle.
La plupart des méthodes d’évaluation d’impact existantes ne distinguent pas l’utilisation des eaux de surface de celle des eaux souterraines (les stocks d’eau souterraine ou de surface, qui peuvent amortir les pénuries d’eau dans le temps). Cela peut être important car une activité peut consommer de l’eau de surface mais avoir une consommation négative d’eau souterraine. L’irrigation par inondation dans l’agriculture en est un exemple : en général, l’eau de la rivière est partiellement consommée en tant qu’eau bleue, mais elle alimente en partie les eaux souterraines, ce qui entraîne une consommation négative (c’est-à-dire la production d’eaux souterraines) et peut avoir un effet bénéfique global, même s’il y a une consommation nette d’eau.
On commence à voir pondre également quelques nouveaux concepts d’ACV :
- l’ACV territoriale, sorte d’ACV élargie où l’on s’intéresse à plusieurs fonctions particulières fournies par le territoire. La raison principale avancée étant la limite des approches d’ACV classiques – centrées sur une fonction spécifique – qui peinent à considérer la complexité et la diversité des échanges sur un territoire (pompes pour prélèvements, systèmes d’adduction avec canaux, infrastructures d’irrigation, infrastructures de traitement des eaux). On peut penser par exemple au cas de la réutilisation des eaux usées où l’on se place dans un système d’économie circulaire.
- L’ACV de prospective, qui propose de se projeter dans le temps et d’évaluer comment des impacts peuvent avoir une contribution ou non au déréglement climatique
- L’ACV dynamique, qui apporte de la temporalité dans les facteurs de caractérisation et d’impacts en considérant qu’ils peuvent évoluer dans le temps.
Les technologies numériques pour la gestion de l’eau
La majorité des outils numériques actuels pour la gestion de l’eau s’intègre dans le cadre d’une agriculture irriguée. C’est déjà bien évidemment une très bonne chose au regard de l’exigence que nous devons avoir sur cette ressource rare mais encore une fois, la quantité de surface cultivée irriguée reste minoritaire au regard de la quantité de surface cultivée non irriguée.
Même si vous allez voir que les outils sont assez bien distribués entre l’ensemble des catégories proposées, ce sont certainement les outils numériques en tant qu’instruments de mesure dont on entend le plus parler. Ces outils sont peut-être plus concrets et palpables que les services sensés appuyer le pilotage de l’irrigation mais il ressort l’impression générale que les outils de bilans hydriques basés sur de la modélisation sont finalement assez peu opérationnalisés.
On pourrait me reprocher que les outils de mesure peuvent être utilisés pour évaluer l’état des ressources en eau, que les cultures soient irriguées ou non. C’est vrai. Néanmoins, force est de constater que les messages véhiculés tournent quand même plus régulièrement autour de l’appui à l’irrigation qu’autre chose (ou peut-être sur la prévision de risques maladies et de stades de développement pour les stations météorologiques).
Vous serez peut-être surpris de voir, notamment dans le cas des outils de mesure, que les approches de suivi de la ressource en eau sont extrêmement variées. Il existe des approches plus consensuelles que d’autres, certes, mais de manière générale, chacun y va quand même de ses petits reproches et a tendance à juger que son approche témoigne plus fidèlement que l’autre ce qui se passe dans la réalité. Dans ce dossier de blog, j’ai découpé ici l’organisation des outils numériques d’un point de vue technologique. Contrairement à un précédent dossier sur la fertilisation azotée, le découpage en objectif agronomique était plus délicat – avec parfois un peu trop de redondance entre les outils numériques. Vous retrouverez ainsi les principales fonctions des outils numériques :
- Observer et Mesurer : Les outils et instruments autour de l’acquisition de données : ce sont principalement les capteurs plante, les débitmètres, les sondes de sol ou encore les stations météo qui permettent de mesurer et de décrire l’état du système. Ce sont des outils qui permettent de mieux connaitre la ressource et/ou la connaissance des pratiques agricoles (ou plus largemnet humaines) et de leurs impacts (prélèvements et rejets, qualité de l’eau)
- Conseiller et Accompagner : Les outils et services autour du conseil et du pilotage de l’irrigation. Ce sont principalement les services d’aide à la décision basés sur de la donnée terrain ou sur des modélisations (bilan hydrique) diverses et variées (multi-échelles, modélisation de systèmes complexes). On y retrouve aussi l’optimisation des systèmes d’irrigation à la parcelle et de gestion de réseau. Sur le long terme, les outils de modélisation sont essentiels. Ce sont à la fois des outils de modélisation décisionnelle (c’est-à-dire la prise de décision courante) mais aussi de la modélisation d’anticipation pour faire face aux conditions climatiques à venir (projection dans le temps et prospective).
- Gérer et Organiser : Les outils et portails autour de la gestion et de la mise à disposition de la donnée. C’est non seulement donner accès à des données sur la météo (les agriculteurs passent quand même du temps à aller checker leur météo), et sur les risques et enjeux liés à l’eau. Ces outils permettent de diffuser et partager la connaissance et sont utiles pour participer à la gouvernance de l’eau à différentes échelles spatiales (communication, collaboration et concertation).
- Agir et Intervenir : Les outils numériques pour l’application de recommandation d’irrigation sur le terrain. Ces outils sont assez peu déployés au regard des autres catégories.
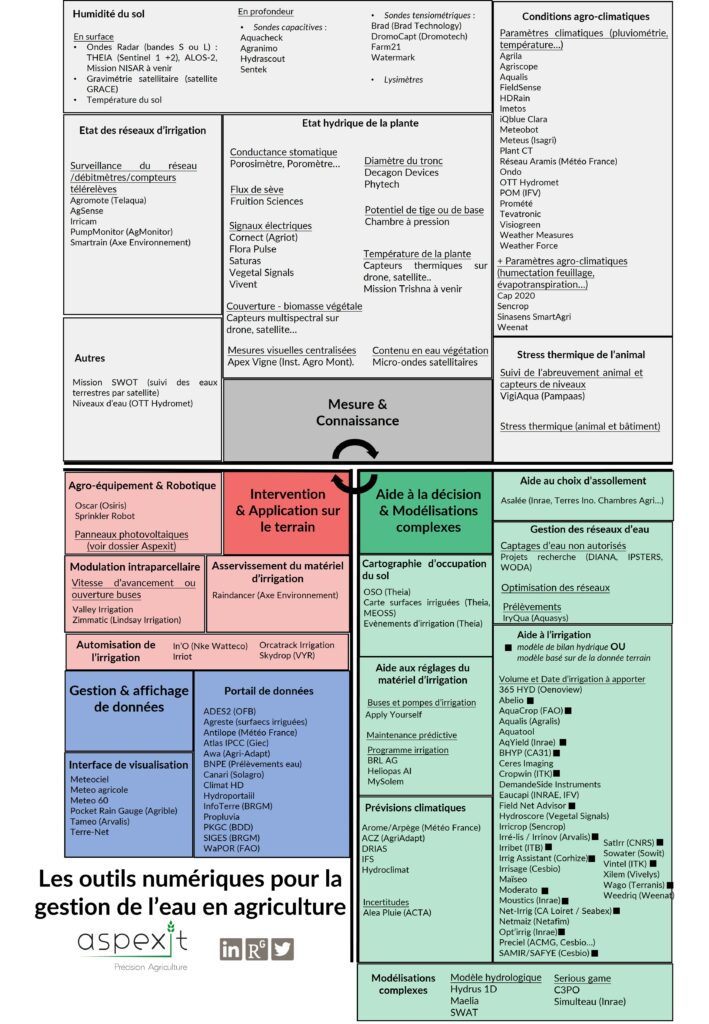
Figure 25. Les technologies numériques pour la gestion de l’eau en agriculture
Observer et Mesurer
D’un point de vue agronomique, on peut distinguer trois grandes approches de collecte de données liées à l’eau par les outils numériques
- Une approche « climat » : acquisition de données météorologiques localement (stations météo connectées) ou sur des mailles régulières (souvent des données Météo France ou européennes retravaillées pour générer des données agro-climatiques)
- Une approche « sol » : acquisition de données sur l’évolution de l’état hydrique du sol, notamment grâce à des sondes dans le sol (capacitives et tensiométriques)
- Une approche « plante » : acquisition de données sur le fonctionnement de la plante au cours de la saison (estimation de l’évapotranspiration, suivi de la température du couvert, dendrométrie, conductance stomatique, flux de sève, potentiel de tige, stress thermique…)
Nous n’oublions pas non plus les débitmètres et les compteurs de télérelève qui ont plutôt un apport logistique et/ou pratique plutôt qu’agronomique.
Les données peuvent être continues (acquises sans arrêt) ou discontinues (acquises à certaines périodes données), locales (la conductance stomatique s’appuie par exemple sur la représentativité d’une feuille pour représenter le végétal dans son entièreté) ou plus globales. Comme nous l’avons discuté plus haut, la mesure de l’eau en agriculture ne fait pas nécessairement consensus.
L’approche CLIMAT
Accès à des données climatiques à large échelle
Bien que de nombreux outils numériques puissent montrer leur intérêt pour la gestion de l’eau en agriculture, la problématique lancinante restera toujours celle de l’estimation de l’eau qui arrive du ciel – à la fois en quantité mais aussi en répartition spatiale. En agro-météorologie, la question repose sur la prise en compte de la variabilité à toutes les échelles spatiales et sur la combinaison des différents moyens à disposition pour l’obtenir (données réelles et virtuelles). Pour obtenir ces données à des échelles spatiales relativement larges, les technologies sont nombreuses
- Les données de radar de pluie (les radars traditionnels et les radars à bipolarisation)
- Les données satellites pour faire de la météo de pluie au sol. Ces données ne sont pas toujours très précises mais ont au moins l’intérêt d’exister quand il n’y a pas d’autres infrastructures.
- La mesure de l’atténuation des signaux électroniques des satellites géostationnaires qui sont affaiblis par les gouttes de pluie.
Les satellites géostationnaires sont préférés aux satellites circulants pour la mesure de la pluie parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des chroniques de données différentes au cours du temps.
En France, les données de pluie les plus connues sont certainement celles de météo France. Les données Antilope, obtenues à partir de la combinaison de données radar et de pluviomètres terrain (pour recalage spatial), proposent des informations climatiques à la maille d’1 kilomètre carré grâce à des modèles de simulation atmosphérique. Gardez bien en tête que ces données sont dématérialisées et virtuelles. Elles sont certes recalées par des points de mesure terrain (les pluviomètres) mais elles restent des données calculées. Ces données sont généralement achetées puis retraitées par des fournisseurs de services agro-météo pour en dériver des paramètres spécifiques à l’agriculture (du type évapotranspiration par exemple).
Même si les prévisions climatiques s’améliorent d’année en année, la variabilité spatiale des précipitations reste toujours une épine dans le pied. On distinguera les modèles de prévision numérique globaux (avec des mailles relativement larges de plusieurs km de résolution) et ceux de prévision numérique locaux (avec des mailles de l’ordre du kilomètre).
Le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT) et Météo France utilisent tous les deux le système de prévision numérique IFS (Integrated Forecasting System) pour réaliser des prévisions à moyenne échéance des grands phénomènes synoptiques, en positionnant ensuite les dépressions et anticyclones. C’est, à ce jour, le modèle météorologique le plus précis du monde pour les prévisions à moyen terme des 3 à 15 jours qui suivent. Le système IFS génère des prévisions sur des mailles régulières de 9km à l’échelle du globe. Météo France, en utilisant une configuration différente du système IFS, appelée Arpège, produit des prévisions à une échelle de 5km en France. Arpège est un modèle à mailles étirées dans le souci d’optimiser au mieux la puissance de calcul, avec des mailles plus fines à l’échelle de la France et plus relâchées autour (la résolution est par exemple de 24 km en Nouvelle Zélande avec le modèle Arpège).
Le modèle Arome de Météo France est un modèle de prévision numérique locale, avec des données produites cinq fois par jour sur des mailles de 1.3 km et avec des échéances de prévisions jusqu’à 48h. Notez que les modèles Arpège et IFS peuvent produire également des données à des échelles plus fines (autour de 2.5 km) en les forçant.
La prévision la plus difficile est la prévision à court voire à très court terme, de l’ordre de 0 à 6h. Ces prévisions ont été améliorées grâce à la puissance de calcul disponible et l’assimilation de données radar. Le modèle Arome peut par exemple être décliné pour des décisions immédiates (de 0 à 6h) avec des fenêtres temporelles d’assimilation de données radar très étroites pour être capable d’affiner les prévisions à court terme. Avant, les données à court terme étaient souvent générées par extrapolation d’informations radar (en regardant comment évoluaient les déplacements de radar de pluie). Les méthodes étaient jusqu’ici limitées parce qu’elle ne s’intéressaient pas réellement à l’évolution de la convection des pluies. Ces méthodes sont en constante évolution.
Les principaux modèles utilisés sont des modèles de prévisions déterministes, c’est-à-dire des modèles numériques de prévision du temps qui simulent le comportement de l’atmosphère. D’autres approches sont proposées pour appréhender l’incertitude de la météo avec des approches probabilistes. L’idée étant de réaliser un ensemble de prévisions à partir d’une distribution d’états initiaux possibles, c’est-à-dire des modèles pour lesquels on a légèrement perturbé la physique pour prendre en compte l’incertitude que l’on a dans la description des processus physiques (ex : Echantillonnage des erreurs initiales avec perturbations, Echantillonnage des erreurs de modélisation avec des perturbations de la physique, Echantillonnage des erreurs de bords…). Le modèle PE-IFS génère des prévisions à une résolution de 18 km (la résolution est plus grossière pour des raisons de calcul et d’approximation) et ce jusqu’à 14 jours en avant. Les prévisions d’Arpège, lorsqu’elles sont réalisées dans un cadre probabiliste, se rapprochent des 5-7 km de résolution spatiale.
Les données de Météo France restent payantes et ne sont pas en Open Data. Même si nous commençons à avoir des données assez fines sur le changement climatique français grâce aux données du DRIAS (à l’échelle 8km), on pourrait se demander si, au vu de l’urgence climatique, les données de Météo France – qui reste un organisme public – ne pourraient pas tomber dans le domaine commun pour que l’ensemble des acteurs travaillant avec des données météorologiques puissent affiner leurs modèles.
La qualité de la donnée dépendra nécessairement de l’échelle à laquelle on souhaite travailler. A l’échelle régionale, on s’intéresse généralement à évaluer l’état actuel et les capacités d’adaptation de territoires par rapport à la gestion de l’eau. A cette échelle assez large, les données virtuelles sont plutôt bien adaptées. A l’échelle du topo-climat (0-10 km de résolution), c’est-à-dire une échelle cohérente avec celle d’une exploitation agricole, les données virtuelles restent intéressantes, surtout si les parcelles de l’exploitation sont assez dispersées dans l’espace. A l’échelle plus fine d’une parcelle, la pluie n’est pas trop variable et les données virtuelles ne sont pas vraiment adaptées (on préfèrera alors les données de stations météo – voir section suivante).
Accès à des données climatiques locales
Cette section reprend quelques synthèses d’un précédent dossier de blog.
Les stations météo connectées en local sur l’exploitation sont utilisables pour caractériser la demande climatique et comprendre l’effet mémoire du site (sorte de profil climatique de la zone dans le temps). Ces stations apportent des informations contextuelles et sont intéressantes pour tout un tas d’application autour du bilan radiatif (l’étalon or reste l’eddy covariance – un bilan radiatif en mesurant les eddy covariance dans plusieurs directions), de la pression de vapeur saturante ou encore de la vitesse du vent (voir les sections suivantes sur l’approche Plante).
Les stations météo peuvent comporter plusieurs capteurs différents :
- Thermomètre : pour la température de l’air et/ou du sol
- Pluviomètre : pour le cumul de précipitation. C’est sans doute le facteur que vous pouvez contrôler le plus facilement (contrairement à l’humidité relative).
- Baromètre : pour la pression atmosphérique
- Hygromètre : pour l’humidité relative
- Anémomètre : pour la vitesse et direction du vent (rafales et autres)
- Pyranomètre : pour le rayonnement solaire
- Capteur de point de rosée ou capteur d’humectation : pour l’humectation du feuillage
- Sondes capacitives et tensiomètres : pour l’humidité du sol
Les fournisseurs de stations météo ne sont pas tous des constructeurs mais pour beaucoup des assembleurs. C’est-à-dire que ce ne sont pas des structures qui construisent leurs propres capteurs mais qui vont plutôt les acheter à des constructeurs de capteurs pour les assembler sur une station météo. Ce n’est pas un problème en soi, bien au contraire, mais il faut avoir à l’esprit que certains fournisseurs pourront donc avoir les mêmes capteurs que leurs concurrents. Ces assembleurs pourront alors se différencier par le type de capteurs spécifiques qu’ils pourront installer sur leur station ou vendre à côté (capteur d’humectation foliaire, dendromètre, sondes et tensiomètres…), le nombre de capteurs qu’ils pourront mettre en place sur leur station ou encore la capacité de leurs boitiers d’acquisition à intégrer tout type de capteurs (notamment des capteurs que vous auriez pu acheter ailleurs). Il peut être également intéressant de savoir si les capteurs vendus sont dissociables (avec leur propre antenne et émetteur) de manière à ne pas forcément placer tous les capteurs d’une station au même endroit.
Faut-il installer une station météo en propre chez soi ou utiliser la donnée d’une station de référence ? Faut-il installer sa station chez soi avec des normes de référence (par exemple les normes Météo France) ou non ? Cela va dépendre d’un grand nombre de facteurs, notamment si la station de référence est proche ou non de l’exploitation, si les conditions pédo-climatiques sont très hétérogènes ou non sur l’exploitation, mais également en fonction des paramètres climatiques que l’agriculteur voudrait suivre (les stations ne sont pas toutes équipées des mêmes capteurs).
On parlera également de stations météo virtuelles en référence à des extrapolations de données de modèles de prévision (voir section précédente) à des échelles spatiales fines. Vaut-il alors mieux faire le choix entre une station réelle ou virtuelle ? On pourrait imaginer que si les données radar et satellitaires s’amélioraient au maximum, nous n’aurions plus besoin d’infrastructures au sol. Au vu des résolutions actuelles des données de prévision et de la variabilité des phénomènes climatiques, même à des échelles spatiales très fines, nous n’en sommes pas encore là. On pourra de toute façon rajouter que les données locales seront toujours nécessaires pour étalonner les modèles de prévision à large échelle.
La station météo réelle mesure vraiment ce qui se passe dans la parcelle contrairement à la donnée issue d’un modèle climatique (et qui demande à être bien étalonnée par rapport à ce qu’il se passe sur le terrain). Il faut donc s’intéresser au niveau d’incertitude qu’il peut y avoir entre une station météo sur le terrain et ce qui est proposé par des fournisseurs de données climatiques spatialisées. Si l’étalonnage est bon, la station météo virtuelle permet de s’affranchir de tout ce qui tourne autour de l’entretien de la station puisque cette station n’existe pas en réalité. Il y aura par contre un abonnement ou un tarif à payer sur la récupération de la donnée.
Dans le cas de la station météo réelle, il faudra bien sûr payer la station et potentiellement un abonnement à côté aussi pour utiliser une application mobile ou un site web associé. Gardez aussi en tête que la station météo virtuelle ne donnera pas accès à tous les paramètres climatiques potentiellement accessibles depuis une station météo réelle (capteur d’humectation de feuillage ou autre…). Le choix d’une station réelle ou virtuelle peut dépendre également de la taille de l’exploitation. Les grandes exploitations pourront avoir de l’intérêt à utiliser des données virtuelles combinées peut-être avec une ou deux stations sur le terrain pour bien étalonner les données.
Que l’on ait installé sa station en propre chez soi ou pas, la question est ensuite de savoir s’il y a de l’intérêt à rejoindre un réseau de station existant ou à faire en sorte d’en créer un. Y a-t-il de l’intérêt à partager ses données climatiques avec ses voisins ? Oui, très certainement si l’échange se fait des deux côtés, c’est-à-dire si l’entrée dans un réseau permet d’avoir accès aux données climatiques des personnes de ce réseau. Cela permet notamment de réduire les coûts d’acquisition de données et de partager ses données dans une communauté. Un intérêt complémentaire pourrait être de bénéficier d’abonnements à des service de réseaux d’alerte basés sur des données climatiques de réseaux de stations.
Une des complexités derrière le réseau de stations météo a trait à l’harmonisation des données climatiques qui transitent sur le réseau. Si ces données climatiques ne proviennent pas de stations de même marque et/ou si les capteurs ne sont pas bien étalonnés, comment alors faire confiance aux données climatiques autour de chez soi ? Cela dépend également de la précision des données attendues sur le terrain. Cette harmonisation a également un effet sur ce qui va être fait des données, notamment si elles sont par exemple intégrées à un outil d’aide à la décision (OAD). Certains détenteurs de réseaux de stations météo vont même un peu plus loin en séparant les stations dont ils sont propriétaires (donc celles dont ils s’occupent), de celles qui sont la propriété d’agriculteurs, potentiellement justement parce que les données de certaines stations n’auront pas été validées. Cela évite notamment pour ces gestionnaires de réseaux de stations de s’occuper de la maintenance et de l’entretien des stations des agriculteurs.
Bien positionner sa (ses) station(s) météo sur son exploitation est essentiel pour s’assurer d’une bonne représentativité et exhaustivité des données collectées. Il faut être conscient que la représentativité des mesures ne sera pas forcément la même en haut ou en bas d’une parcelle, proche ou loin d’une haie, ou encore près d’une bordure de parcelle. Certains experts conseillent aussi de s’intéresser fortement aux profils de sol pour avoir une zone d’installation bien connue et représentative. Ces variabilités de sols peuvent être mise en avant à l’aide d’outils numériques (conductivité/résistitivité des sols, imagerie satellitaire), mais aussi et surtout à partir de la connaissance du terrain par les agriculteurs (zones de cailloux, coins à gel…).
Le positionnement des stations peut aussi être régi par des normes, et ces dernières ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Certains pourront par exemple faire le choix d’installer des stations dans le cadre de normes météo France (avec des capteurs à une certaine hauteur, dans un endroit dégagé…) mais il faut néanmoins être clair sur le fait que les données sont bonnes là où elles auront été mesurées (les données ne sont pas toutes mesurées à la même hauteur du sol par exemple). Entre une station positionnée dans un endroit dégagé et une autre installée au cœur des vergers, les conditions ne seront pas les mêmes. Au cœur d’un verger, on collera beaucoup mieux au climat de la culture en place, et les données climatiques reflèteront mieux la situation. L’inconvénient majeur néanmoins étant que la plupart des modèles agro-climatiques ont été étalonnés sur les normes météo France. Est-ce que les différences sont significatives ? Est-ce qu’il faut revoir les OAD si les stations installées ne sont pas aux normes météo France ? Pas forcément tout le temps, mais il faut quand même garder ces idées-là en tête (attention donc lorsque l’on commence à faire des analyses plus fines par exemple avec des dendromètres ou autres).
Et ces stations devront être entretenues tout au long de la saison (par l’agriculteur lui-même ou par un service dédié du fournisseur ou de l’exploitant des stations) pour faire du préventif et éviter ou tout du moins limiter le curatif. Les problèmes logistiques autour des stations peuvent prendre plein de formes différentes : souci de batterie, panne et casses en tout genre, dérive des capteurs, usure des pièces, bouchage du pluviomètre, stockage de la station météo…
L’approche PLANTE ou ANIMAL
Comprendre les flux d’eau dans la plante
L’une des façons d’étudier l’impact d’un changement climatique sur l’utilisation de l’eau est de commencer au niveau de la feuille. Les effets d’un changement des régimes de CO2, d’eau et de température seront plus évidents au niveau des feuilles car il n’y a pas les effets confondants de l’architecture de la canopée ou du sol sur l’utilisation de l’énergie des plantes. Le changement d’échelles, c’est-à-dire le fait d’être capable de passer de l’échelle de la feuille à celle du couvert végétal complet, est autrement plus complexe – et on ne peut pas simplement extrapoler les résultats d’une échelle à une autre parce qu’une feuille n’est pas forcément représentative de la canopée entière (la position et l’architecture de la feuille dans la canopée joue par exemple sur le régime de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) et à la demande en eau de la feuille). L’ombrage mutuel entre les feuilles et les interférences entre les feuilles deviennent des facteurs pré-dominants sur les capacités de photosynthèse et de transpiration. Gardez en tête que le transfert radiatif est difficile à réaliser sur du multi-strates et multi espèces (quand la canopée est complexe bien évidemment).
L’utilisation de l’énergie foliaire présente un profil distinct en fonction de la voie de carboxylation (Figure 26), c’est-à-dire la photosynthèse en C3, la photosynthèse en C4 et le métabolisme de l’acide crassulacéen (CAM). La photosynthèse du maïs est par exemple en C4, c’est-à-dire que la première molécule formée possède 4 atomes de carbone. Ce processus en C4 se caractérise par un meilleur rendement photosynthétique et une meilleure utilisation de l’eau que les plantes en C3. Le maïs produit par exemple 40 kg de matière sèche à l’hectare en moyenne par millimètre de pluie, alors que le blé en produit 25.
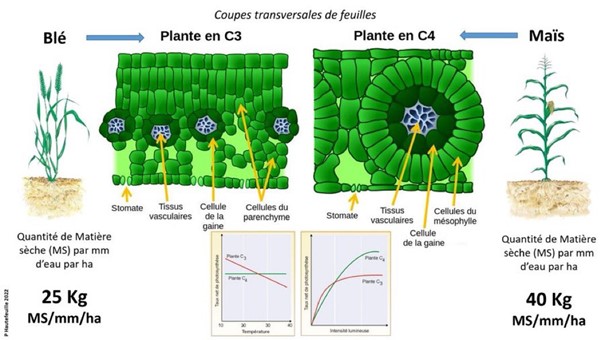
Figure 26. Les plantes en C3 et C4
Les stomates sont les ouvertures naturelles des plantes qui leur permettent d’assurer des échanges de gaz (carbone, eau…) pour réaliser leurs activités de respiration et de photosynthèse. Lorsque les températures augmentent, les plantes ont tendance à fermer leurs stomates pour limiter les pertes en eau. Des stomates fermés ne sont pas le signe d’une plante stressée. Les échanges réduits impliqueront certainement un faible rendement en fin de saison mais une fermeture des stomates n’est pas forcément un stress hydrique d’un point de vue physiologique – il faut plutôt considérer ça comme une adaptation ou une régulation de la plante à son environnement. La relation entre un manque d’eau et une perte de rendement n’est de toute façon pas linéaire.
Les plantes ont de nombreux moyens de réguler leur eau. Les stomates en sont un, certes, mais les plantes peuvent également changer l’orientation de leurs feuilles (par rapport au soleil, pour faire de l’ombre…) ou allouer leurs ressources différemment au sein de leurs organes. La sélection génétique a participé à diminuer les traits de résistance à la sécheresse des plantes (en vue de maximiser plutôt des traits de production). Certaines plantes sélectionnées ont ainsi vu apparaitre des stomates à la fois sur le dessous (comme à leur habitude) mais aussi sur le dessus pour maximiser les échanges de gaz mais au risque d’une augmentation de la transpiration et d’une difficulté à se réguler. Notez également qu’outre les évolutions de température, les évolutions de CO2 dans l’environnement des plantes amènent certaines plantes à faire évoluer également leur densité de stomates.
Lorsque les flux d’eau s’arrêtent dans la plante, la pompe du phloème s’arrête elle-aussi. La sève élaborée devient trop visqueuse et la capacité de la plante à transporter la sève aux racines et appareils reproducteurs devient limitée. Ces arrêts de flux d’eau entrainent aussi des phénomènes de cavitation (bulles d’air) dans les canaux de la plante. Avec ces cavitations en place, si la plante est ré-arrosée, c’est potentiellement la mort assurée parce que les bulles d’air restent dans les canaux de la plante.
Il existerait un compromis entre les efficacités d’utilisation de l’eau et de l’azote chez les plantes, rendant impossible leur maximisation d’efficacité simultanément. Et ces compromis peuvent clairement varier d’une année à l’autre en fonction des conditions observées. Ce dilemme physiologique au niveau des feuilles pourrait s’exprimer de la sorte : étant donné que la concentration intercellulaire en CO2 des feuilles n’est généralement pas saturante pour l’assimilation du carbone, toute augmentation de cette concentration de CO2 augmenterait l’utilisation de l’azote photosynthétique, mais augmenterait également la transpiration (Gong et al., 2010). Il faut ici comprendre que pour que la photosynthèse augmente (et que la plante transforme de l’énergie lumineuse en énergie chimique pour elle), il faut que les stomates soient ouverts pour transporter le CO2 atmosphérique de la plante mais que cela se fait au détriment de la transpiration de la plante.
Les plantes ont cette capacité impressionnante à s’adapter à ces conditions limitantes en eau ou en azote, en faisant évoluer leur morphologie et traits fonctionnels (surface des feuilles) et l’investissement en azote des feuilles (concentration d’azote dans les feuilles et teneur en azote des feuilles par unité de surface).
Une productivité élevée de l’eau nécessite ainsi un apport adéquat d’azote. Il faut bien comprendre que c’est un peu comme si l’on utilisait l’eau et l’azote comme des ressources substituables. Lorsqu’il y a beaucoup d’azote, les stomates n’ont pas besoin d’être beaucoup ouverts parce que la Rubisco – enzyme clé de la photosynthèse – fonctionne à plein régime et peut photosynthétiser avec le peu de carbone qui rentre (parce que les stomates sont peu ouverts). De la même manière, si l’approvisionnement en eau est très important, les stomates peuvent être grand ouverts et donc même avec peu d’azote, la plante peut quand même réaliser son activité de photosynthèse. Gardez quand même en tête que cette substitution ne se fait pas dans les mêmes proportions.
L’optimisation de la productivité de l’eau dans certains systèmes agricoles peut nécessiter des doses d’azote trop coûteuses, trop risquées d’un point de vue économique ou non respectueuses de l’environnement. Cela est particulièrement important lorsque le rapport entre le prix de l’engrais et le prix de vente de la culture est élevé, dans les environnements propices au lessivage de l’azote ou lorsque des facteurs biophysiques, sociaux, économiques ou d’infrastructure limitent l’utilisation d’engrais.
Il est important d’observer les interactions entre le CO2, la température et le régime hydrique pour comprendre l’utilisation de l’eau dans un climat changeant. Si l’augmentation du CO2 peut aider à réduire le stress lié au déficit hydrique, elle ne peut pas compenser l’augmentation du stress thermique et peut même être négative. Le résultat global est que le l’efficacité d’utilisation de l’eau diminue avec l’augmentation des températures mais augmente avec l’augmentation du CO2 à chaque régime de température. Un autre facteur de complication est le changement de la pression de vapeur saturante de l’air avec le changement de température et l’effet de rétroaction sur la température des feuilles. Le changement de la température de l’air autour de la feuille modifie la température de la feuille et affecte directement le gradient de vapeur d’eau entre la feuille et l’atmosphère. L’humidité de l’air en réponse aux changements de température aura un impact significatif sur l’efficacité énergétique des plantes.
Eau et carbone sont également associés en ce sens que la quantité d’eau dont va avoir besoin une culture, et la quantité de carbone qu’elle va pouvoir laisser dans le sol, sont directement liés à la quantité de biomasse produite. Le niveau de capture du carbone augmentera également la capacité de rétention d’eau du sol (voir la section « Comprendre les flux d’eau dans le sol »).
De manière générale, force est de constater que nous manquons actuellement de connaissances sur le fonctionnement fin du cycle de l’eau dans la plante. Et cette complexité est d’autant plus grande que le cycle de l’eau interragit avec les cycles de l’azote et du carbone.
Estimation de l’évapotranspiration et bilans d’énergie
L’imagerie intervient ici pour améliorer la mesure de la couverture de végétation (fraction de couvert, niveau de biomasse…) et ainsi moduler l’évapotranspiration potentielle (ETP – et notamment le Kcb) en fonction du recouvrement de la parcelle (Figure 27 – voir la section sur « la méthode des bilans hydriques »)
L’évapotranspiration réelle étant difficile à estimer, c’est généralement l’évapotranspiration potentielle – reliée à l’évapotranspiration réelle par un coefficient cultural – qui est utilisée (on pourrait néanmoins la mesurer concrètement avec des lysimètres installés dans la parcelle mais ça n’est pas vraiment réalisable en conditions opérationnelles). Comprenez que l’évapotranspiration potentielle correspond à la demande en eau de l’atmosphère à satisfaire. L’évapotranspiration potentielle se calcule de manière plus ou moins empirique ou mécaniste, principalement à partir de la température, et éventuellement du rayonnement, du vent, et de la résistance stomatique en fonction des méthodes. Cela donne lieu à plusieurs formules qui, dès le départ, donnent des différences. Ces formules se comportent différemment en réaction aux projections climatiques, principalement suite à une augmentation de température évidemment, mais aussi en fonction de la concentration de CO2 qui joue fortement sur la résistance stomatique des plantes (elles auront moins besoin d’évaporer d’eau pour capter du CO2 si celui ci est en plus grande concentration dans l’atmosphère).
L’évapotranspiration est certainement l’indicateur qui évolue le plus avec le changement climatique et la diversité des formules disponibles ne rend pas toujours évident la comparaison des sorties de modèles (on pourrait rajouter que le vent n’est pas toujours mesuré sur les stations météo ce qui peut remettre en cause la qualité de l’estimation de l’évapotranspiration réelle). Le comportement de la relation entre évapotranspiration potentielle et évapotranspiration réelle est donc questionnable dans un climat changeant.
L’évapotranspiration potentielle est généralement calculée à partir de l’équation de Penman Montheith. C’est une équation d’autant plus intéressante qu’elle a le mérite de fonctionner à différentes échelles (feuille, couvert, canopée…).
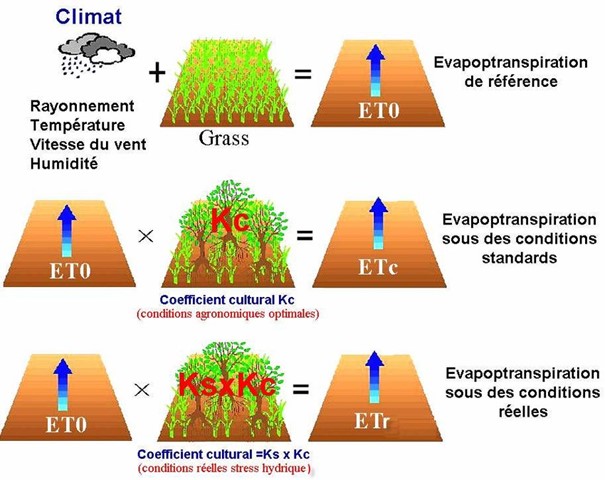
Fig 27. La méthode FAO-56 peut être appliquée avec un coefficient de culture unique (Kc) ou une approche à double coefficient de culture qui représente séparément l’évaporation du sol (Ke) et la transpiration et le stress de la plante (Kcb et Ks).
Le couplage des données satellitaires avec des modèles de bilan hydrique (le satellite seul est insuffisant pour les grandes cultures) apporte une autre vision du déficit hydrique de la plante et est généralement utilisé par la suite pour envoyer des recommandations d’irrigation (date ou volume d’irrigation). On pourrait imaginer à terme que l’utilisation des images soit aussi couplé à des données de quotas ou de restrictions d’eau sur les territoires. Les approches intégrées modèle (hydrologique et/ou bilan hydrique) et télédétection constituent une perspective intéressante pour aller plus loin dans la caractérisation de l’eau en agriculture. Les données satellitaires sont généralement utilisées ici dans un cadre de forçage (en entrée de modèle) plutôt qu’en assimilation de données (en ajustement de modèle en cours de fonctionnement. C’est par exemple le cas de modèle SAMIR, co-développé au CESBIO, qui intègre la quantité de végétation active (généralement le NDVI) dans le modèle de bilan hydrique de la FAO pour améliorer l’estimation de l’évapotranspiration.
La synergie multi-longueur d’onde que l’on devrait voir arriver avec les constellations de satellites à venir permet d’aller toujours plus loin dans la finesse des bilans hydriques et des préconisations hydriques recommandées.
Suivi de la température de surface du couvert
En modélisant la plante comme une résistance, les données d’imagerie – satellitaire ou drone – (notamment dans le domaine de longueur d’onde thermique) vont être utilisées pour calculer un bilan énergétique. On pourra alors imaginer calculer des indices de stress hydrique ou d’état de santé de végétation, en calculant des indices sur des périodes de temps variées (à l’échelle de la journée ou à des échelles plus longues de temps pour détecter des sécheresses). Les approches basées sur du satellite thermique existent depuis longtemps. Elles ont néanmoins pas mal végété dans le temps parce que la résolution spatiale des données thermiques était trop grossière (la résolution Landsat n’était pas suffisante pour les zones agricoles et la répétitivité temporelle non plus).
Les caméras thermiques embarquées sur drone, avion ou satellite, cherchent à mesurer la température du couvert végétal soit directement, soit indirectement en mesurant la température à la surface du sol. Ces caméras utilisent des longueurs d’onde spécifiques du spectre électro-magnétique (dans l’infrarouge thermique donc). Comme la moitié de l’eau qu’une plante évapore se transforme en froid, l’hypothèse qui est faite est que la température de la plante devrait être légèrement inférieure à celle de l’air. Dans le cas contraire, il est considéré que la plante n’a pas assez d’eau.
Il faut néanmoins bien comprendre que les caméras thermiques ne réalisent pas un bilan radiatif au niveau de la plante. Très souvent, les conditions de vent ne sont pas mesurées. Et souvent ce vent a plus d’importance sur le stress hydrique de la plante que la température en tant que telle. Un stress thermique n’est pas nécessairement le signe d’un stress hydrique – la plante est tout aussi capable de réguler les flux d’eau en son sein. La température de la canopée reflète la capacité de la plante à réguler sa température et finalement pas grand-chose d’autre. Elle n’informe pas réellement sur les besoins en eau de la plante. Et cette capacité est liée à la plante, à l’humidité du sol, ou encore aux pratiques passées. A côté de ça, les pics d’absorption d’eau que l’on observe sur la signature spectrale d’une plante autour de 1400 et 1900 nanomètres ne sont pas des informations directes de la teneur en eau des plantes parce que l’on considère l’eau comme étant à saturation dans la plante.
De manière générale, les approches basées sur des bilans d’énergie sont assez fragiles et les résultats sont toujours très bruités. Les modèles basés sur des indices de végétation classique (type NDVI) ont certes des défauts mais ressortent avec des comportements qui peuvent être plutôt cohérents avec les données terrain. Avec les approches thermiques, le signal est bruité parce que le bilan d’énergie doit être fait au niveau de chaque image avec les hypothèses et erreurs associées (en fonction des types de forçage radiatifs utilisés par exemple). Depuis quelques années, les opérateurs satellite se sont mis en tête de pousser le suivi de l’agriculture avec de l’imagerie thermique. La future mission franco-indienne Trichna ou le satellite LSTM (répétitivité dans le thermique) en sont des exemples.
Stress hydrique et contenu en eau de la végétation
Le monopole de la mesure revient généralement à la méthode de la chambre à pression de Scholander qui s’intéresse à l’étude des potentiels hydrique foliaires ou de tige. Ces mesures, destructives pour la plante parce que des feuilles sont détachées et enrobées dans de l’aluminium, peuvent être réalisées juste avant le lever du soleil (pour le potentiel de tige, qui représente l’équilibre entre l’état hydrique de la plante et celui du sol) ou en plein soleil (pour le potentiel foliaire, qui représente la capacité de la plante à retenir l’eau quand le feuillage transpire). La chambre à pression évalue le niveau de pression à atteindre pour qu’une goutte de sève sorte du pétiole. Plus cette goutte de sève met du temps à arriver, plus la plante est considérée en état de stress hydrique.
Cette mesure reste assez chronopage puisqu’elle doit se réaliser feuille à feuille et qu’elle nécessite un suivi constant de l’arrivée de la première goutte de sève. Reste qu’en fonction de la méthode utilisée (potentiels de tige ou de base), les données peuvent ne pas nécessairement être représentatives de la plante entière.
Les déficits en eau de la plante ont deux origines : un déficit de vapeur d’eau de l’air et un déficit de teneur en eau du sol. La pression de vapeur saturante (VPD) est une façon de quantifier la violence et la fréquence des vagues de chaleur. C’est une sorte de pression de succion dont l’origine provient d’un déficit de vapeur d’eau de l’air. On peut la définir comme la différence entre la quantité d’eau présente dans l’atmosphère (ou « pression de vapeur réelle ») et la quantité d’eau que l’atmosphère pourrait contenir à saturation (100 % d’humidité, ou « pression de vapeur saturante »). Et cette VPD est l’une des principales forces qui gouverne la transpiration des plantes. Plus l’air devient chaud, plus il peut stocker de la vapeur d’eau, ce qui fait que naturellement, la pression de vapeur saturante augmente.
La mesure de la chambre à pression représente en quelque sorte le dernier maillon de la chaine de l’eau depuis l’interface sol-racine au début où l’eau a été absorbée. Elle est donc particulièrement sensible à la pression que l’atmosphère exerce sur l’eau.
Les capteurs plante, quant à eux, ont l’ambition de mesurer l’état hydrique au plus près de la plante. Si l’on ignore la façon dont la plante fonctionne, on peut effectivement décemment penser qu’il sera difficile de faire les choses proprement. Les flux d’eau sont par exemple importants pour la photosynthèse mais aussi pour réguler la température de la plante. Pour convertir des données de capteur plante en indice physiologique, il est nécessaire de savoir comment la plante interprète le déficit en eau de l’atmosphère et le déficit en eau du sol. Notez que les capteurs plante sont quand même généralement couplés à des données atmosphériques (données climatiques).
Ces capteurs plantes peuvent prendre plusieurs formes :
- Certains capteurs plantes mesurent par exemple un débit de sève dans une section pérenne (de vigne par exemple) en mesurant les différences de température de chaque côté du bras de vigne suite à un chauffage local. C’est une donnée à interpréter en début de saison et en pic de transpiration pour pouvoir évaluer un pourcentage de confort hydrique.
- D’autres capteurs s’intéressent à l’évolution des signaux électriques dans le phloème, le tissu qui conduit la sève élaborée dans la plante. Ces signaux électriques sont dus aux dépolarisations transitoires de la membrane des cellules dans la plante qui sont dues à tout ce qui se passe dans la plante (ravageurs, stress abiotiques…). Des paires d’électrodes sont là pour mesurer plusieurs types des différences de potentiels électriques (potentiels d’action, potentiels de variation, potentiel système) corrélés à un statut hydrique particulier.
- Pour les cultures pérennes, notamment en arboriculture, des dendromètres connectés voient le jour et permettent de suivre en temps réel l’évolution du diamètre des tiges et des branches sur lesquelles les dendromètres sont installés. C’est une mesure indirecte de l’état hydrique de la plante qui, en fonction des amplitudes climatiques de la journée (humidité, température…), fera fluctuer les flux d’eau qui transitent au travers elle.
Quelques approches de crowdsourcing ont également été proposées à partir d’applications mobiles. C’est par exemple le cas d’Apex Vigne pour caractériser des tendances d’état hydrique de vigne à des échelles de petites et grosses régions méditerranéennes à partir d’un suivi de l’arrêt de croissance de la vigne (méthode des Apex). Bien que l’arrêt de croissance ne soit pas nécessairement le témoin d’un manque d’eau, les auteurs de l’application considèrent que l’eau est le facteur limitant de croissance en conditions méditerranéennes. L’utilisation de données crowdsourcées pose néanmoins question quant à la quantité de données susceptibles d’être récupérées et de leur répartition géographique et temporelle. Ces données de crowdsourcing seront utilisées pour inverser des modèles de bilan hydrique.
On pourrait imaginer aussi que la teneur en eau de végétation soit accessible avec de l’imagerie dans le domaine des micro-ondes parce que la rétrodiffusion du signal dans différentes polarisations des membranes de cellule pourrait être un proxy de la teneur en eau de la plante. On retrouverait ici des similarités avec des capteurs plante.
Certaines approches plus pragmatiques tentent de trouver un lien entre des indices de végétation et des mesures terrain (comme des potentiels hydriques de tige ou de base) et utiliser les images satellites pour cartographier des états de stress sur des couvertures spatiales plus larges (et quand on ne peut pas instrumenter chaque parcelle individuellement). Les images sont particulièrement intéressantes dans le cas de zones où les cultures ne sont pas synchrones et permettent de donner à voir une grosse hétérogénéité du développement des cultures.
Stress thermique chez les animaux
Plusieurs outils numériques peuvent permettre de suivre le stress thermique des animaux. Même si nous sommes d’accord qu’un stress thermique n’est pas un stress hydrique (nous en avons parlé pour les plantes), suivre un stress thermique est quand même, pour les animaux, une façon de s’intéresser à leur état de santé. On pourra notamment suivre des taux de respiration, des scores d’halètement ou des conditions micro-climatiques au plus près des animaux à l’aide de capteurs climatiques, accéléromètres divers et variés (podomètres, colliers…) et ou de sondes vaginales.
En bâtiment, les zones de confort ou de stress thermique – qui peuvent d’ailleurs être très hétérogènes dans le bâtiment (à cause du réglage de ventilateurs par exemple) sont des potentiels amplificateurs de stress chez les animaux. Des caméras thermiques peuvent être en mesure de mesurer des indices de température ou de chaleur et de cartographier ces indicateurs au sein de bâtiments
On pourra également retrouver quelques abreuvoirs connectés pour pouvoir suivre la consommation d’eau des cheptels.
L’approche SOL
Comprendre les flux l’eau dans le sol
Le sol est certainement le compartiment le plus mal compris et le plus délaissé dans l’enseignement agricole alors qu’il est un acteur fondamental de la production agricole. On pourrait discuter du sol sous un tas de prismes différents mais nous allons nous concentrer ici plutôt sur son rôle dans le cycle de l’eau. En matière d’eau, le sol régule le régime des eaux superficielles et l’alimentation des eaux souterraines. Il détermine le partage entre ruissellement et infiltration des précipitations, joue un rôle tampon vis-à-vis des écoulements hydrologiques et permet ainsi par exemple d’amortir les phénomènes de crues ou de soutenir les débits des cours d’eau en période d’étiage. Sur le plan agricole, le sol joue le rôle de réservoir d’eau avec des capacités assez fascinantes d’infiltration et de rétention d’eau dont nous allons reparler plus finement. Ces caractéristiques participent à la régulation du cycle de l’eau à l’échelle de la parcelle et de tout le bassin versant en amortissant les à-coups pluviométriques et en limitant l’érosion de la couche superficielle des sols.
Les plantes sont en mesure de boire l’eau du sol si tant est qu’elle soit accessible. On parle de réservoir utilisable ou réserve utile (RU) comme la quantité d’eau dont les plantes ont besoin pour se développer. A y regarder de plus près, ce réservoir peut également être divisé en deux sous réservoirs : le Réservoir facilement Utilisable (RFU) – appelé aussi zone de confort hydrique – et le Réservoir Difficilement Utilisable (RDU) – appelé zone de stress hydrique. Lorsque le réservoir facilement utilisable est vide (parce que les plantes ont tout absorbé, que l’eau s’est évaporée ou que l’eau a fui dans le milieu), la plante commence à rentrer dans un état de stress hydrique en ce sens que la plante ne peut plus facilement prélever de l’eau dans le sol et n’a ainsi potentiellement plus assez d’eau pour couvrir ses besoins et se développer correctement. On appelle ce premier seuil le point de flétrissement temporaire parce que la plante peut revenir à un état de confort hydrique si la réserve utile du sol se remplit de nouveau. Si le réservoir difficilement utilisable en vient à se vider lui aussi, la plante atteint son point de flétrissement permanent et là, clairement, c’est la mort assurée. Vous voyez également sur le schéma que lorsque le sol est saturé en eau, les plantes meurent aussi par asphyxie racinaire – c’est le seuil de capacité au champ qui est alors dépassé.
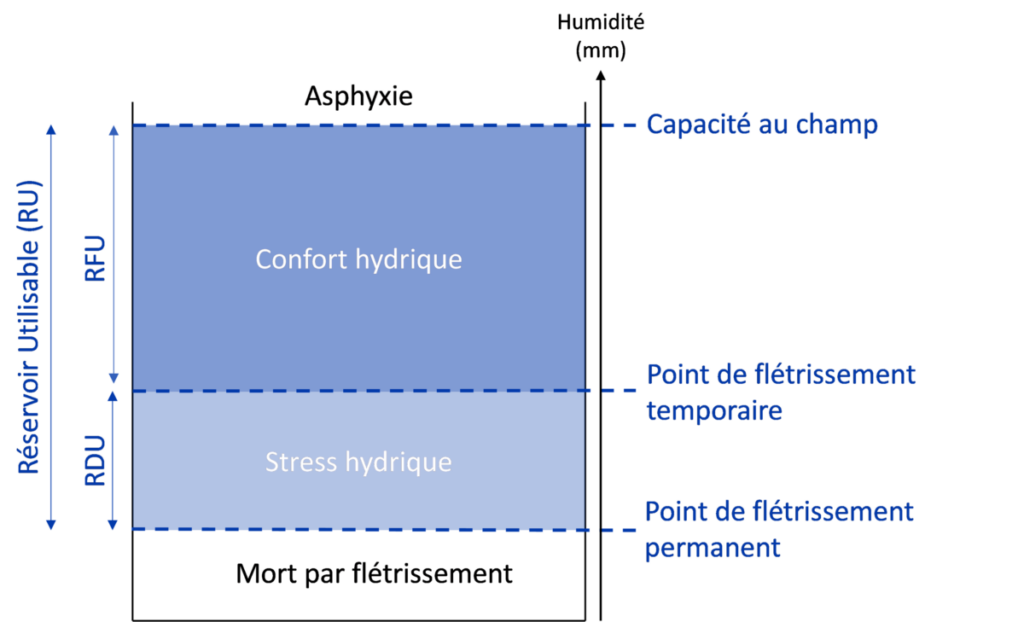
Figure 28. Les états de réservoir d’eau du sol pour les plantes.
La taille du réservoir en eau du sol utilisable par la plante est dépendante de la plante et de sa capacité à explorer le sol avec ses racines. Au fur et à mesure de la croissance des plantes, le réservoir accessible grandit puisque les racines se développent. Il est donc important de garder en tête que ce point de flétrissement n’est pas une constante – ce seuil peut varier dans le temps. Gardez en tête que les plantes stockent très peu d’eau dans leurs organes.
La taille du réservoir en eau du sol utilisable par la plante est un des principaux éléments de paramétrage des modèles de culture pour simuler l’état hydrique du sol et son effet sur le rendement de la culture. Ce paramètre fondamental est souvent assez mal connu et difficile à estimer parce qu’on ne connait pas toujours bien l’état des racines ou la profondeur d’enracinement des plantes. Cette réserve utile est généralement fixée par défaut en fonction de quelques caractéristiques générales du sol utilisé (nomenclature du sol, texture…). Plus qu’une réserve, c’est en réalité la capacité des plantes à absorber l’eau du sol qui nous intéresse réellement (nous en reparlerons dans la section sur les outils numériques de mesure de l’état de l’eau dans le sol).
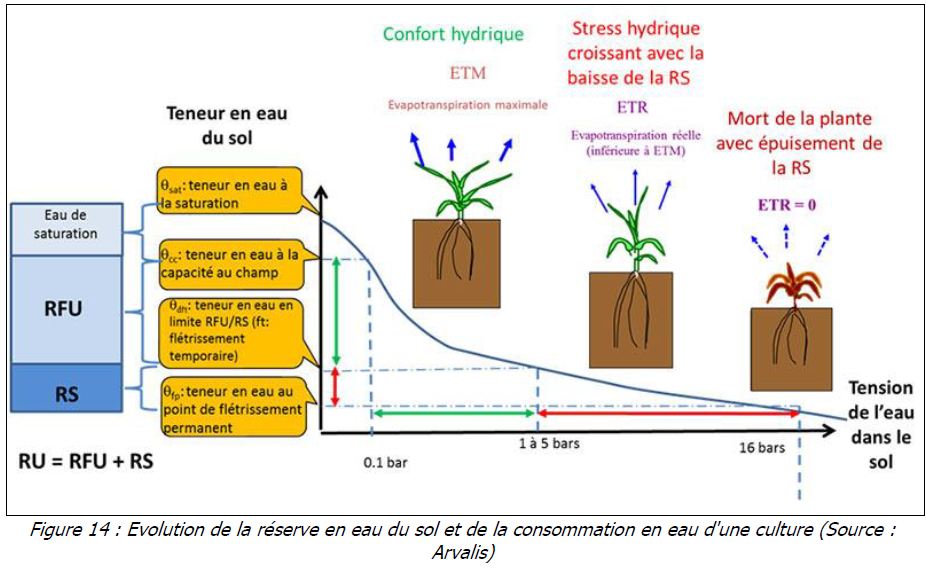
Figure 29. Evolution de la réserve en eau du sol et de la consommation en eau d’une culture. Source : Arvalis.
La capacité du sol à stocker de l’eau est différente d’un sol à un autre. Cette variabilité inter parcellaire et intra parcellaire de la taille du réservoir en eau utilisable par les plantes dépend de plusieurs paramètres et notamment de la géologie et du relief qui influencent la profondeur, de la texture, ou encore de la structure et de la fraction d’éléments grossiers du sol. La sensibilité des plantes à l’irrigation est également fortement liée à la profondeur du sol. Dans le cas d’un sol profond à moyennement profond, l’eau d’irrigation n’est valorisée que pendant la période de forte sensibilité à condition que la réserve en eau du sol soit pleine au départ. Pour les sol superficiels, l’irrigation est efficiente sur le rendement pendant toute la période de sensibilité de la plante même si son impact est moins marqué en début et en fin de période.
Continuons à creuser le sujet du réservoir d’eau dans le sol. Nous avons vu que toute l’eau du sol n’était pas utilisable par les plantes, c’est notamment le cas de l’eau de constitution et de l’eau liée (Figure 30). L’eau de constitution (ou eau absorbée) est celle qui entre dans la composition chimique des grains du sol et qui est de facto non utilisable par la plante. L’eau liée (ou eau adsorbée) correspond à la fine pellicule d’eau qui entoure les particules de sol. Cette eau est liée au sol par des forces d’attraction moléculaire qui la rende inutilisable pour la plante. Le reste de l’eau du sol constitue l’eau libre (ou eau interstitielle) qui, comme son nom l’indique, est quand même plus à même d’être récupérée ou de se balader dans le sol. L’eau utilisable par la plante (la réserve facilement utilisable) est celle qui reste fixée au sol. C’est une eau capillaire, soumise aux forces de tension se développant au contact de l’eau, de l’air et à l’action de la gravité. Le reste de l’eau libre est une eau dite en saturation, qui s’écoule par gravité vers la nappe lorsque le sol n’est plus en capacité de retenir plus d’eau que ce qu’il n’en retient déjà. Si l’eau n’arrive plus à s’infiltrer dans le sol vers la nappe, c’est que l’état de structure du sol ne le permet pas (et c’est pour cela que l’on se retrouve avec des phénomènes d’asphyxie racinaire et/ou des ruissellements importants).
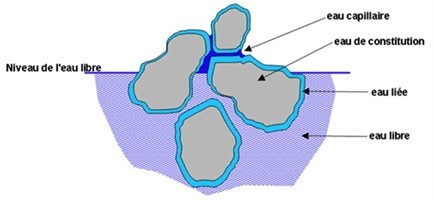
Figure 30. Les différentes formes d’eau dans le compartiment du sol.
Comment l’eau est-elle en mesure de circuler dans le sol ? Et comment le sol est capable de jouer concrètement son rôle de réservoir d’eau ? L’essentiel de l’eau du sol est stocké dans les plus petits canaux ou pores du sol – les mésopores et les micropores. Ces petits canaux, qui collent et stockent l’eau contre les parois des pores sous forme de films, ne sont quasiment créés que par la biologie du sol, à savoir les bactéries, les amibes, les mycorhizes et les racines les plus fines des plantes. Certains sols sont minéralement capables de faire des trous (les argiles par exemple gonflent quand il pleut et se dégonflent après) mais c’est anecdotique. Ces trous dans le sol, mal jointifs, servent à la fois à ralentir l’écoulement de l’eau mais aussi à la retenir. Comprenez bien que ce sont bien les pores de petite taille qui retiennent l’eau et qui donnent son rôle d’éponge au sol. Et cette microporosité ne peut pas être créée mécaniquement avec des outils de travail du sol… Les trous plus larges, créés par la macrofaune du sol (vers de terres et autres cousins) sont bien évidemment importants aussi pour l’aération du sol mais ils sont surtout des canaux de drainage par lesquels l’eau s’écoule pour qu’il n’y ait pas d’excès ni d’hydromorphie.
Les pores du sol, pour être fonctionnels dans le temps, se doivent d’être stables. Et cette stabilité est permise notamment par la matière organique du sol. Grâce aux micro-organismes, l’architecture du sol est ainsi maintenue par de la colle organique, ou dit autrement par les matériaux carbonés que les plantes relâchent dans le sol . Et de noter que cette matière organique est en plus hydrophile, et donc attire l’eau. C’est donc bien en favorisant la photosynthèse, qui servira in fine à nourrir beaucoup de microorganismes qui eux-mêmes vont créer de l’espace pour stocker l’eau, que le sol pourrait jouer son rôle fondamental d’éponge riche en eau.
Rappelons également le rôle fondamental des racines des plantes dans la microporosité du sol. L’essentiel des racines est constitué de toutes petites racines très fines et ce sont elles qui fouillent le sol. Au cours de leur vie, les racines lâchent des sécrétions dans le sol – c’est ce qu’on appelle la rhizodéposition – qui, en plus de modifier les bactéries présentes dans le sol, libèrent des matières organiques dans le sol et donc participent à son architecture. En fin de vie, les racines meurent et sont mangées par les micro-organismes du sol. L’espace initialement pris par ces racines devient alors un espace nouveau de porosité dans le sol. De manière générale, les racines sont assez fascinantes pour explorer le sol, et ce parfois jusqu’à grande profondeur. L’intérêt des arbres par exemple et de pouvoir augmenter le volume d’eau disponible parce que la zone de sol explorée est plus grande. L’enracinement profond permet la mise en place d’un mécanisme d’ascenseur hydrique, c’est-à-dire un processus qui fait en sorte que l’eau puisse remonter dans des étages du système racinaire qui sont en présence d’un sol plus sec. En plus de ça, une partie de cette eau va servir à nourrir les champignons mycorhiziens de surface, potentiellement connectés à d’autres plantes enracinées superficiellement, et qui vont donc par-là permettre d’approvisionner en eau des plantes voisines.
L’humain, en labourant le sol, crée des trous. Mais ces trous ont en réalité un intérêt très limité. Les trous sont déjà de taille importante (ce n’est donc pas de la microporosité) et ils ne sont pas stables (puisqu’ils ne sont pas stabilisés par de la matière organique) et donc ils s’effondrent. Le labour augmente également la respiration des micro-organismes du sol, ce qui contribue à diminuer la quantité de matière organique du sol parce que l’on fait travailler les micro-organismes. Cette matière organique servant à la fois à coller le sol (pour solidifier la micro-porosité) et à attirer l’eau du sol, on en vient à comprendre assez rapidement les limites de labour sur le stockage de l’eau dans le sol. Rajoutons également que le labour participe à détruire tout le réseau mycorhizien du sol et nous avons vu à quel point les champignons avaient leur rôle dans l’abreuvement de plantes voisines.
Vous l’aurez compris mais s’il y a bien un acteur qui doit devenir le socle de la stratégie d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, c’est bien le sol. Pour aller plus loin, je ne peux que vous conseiller d’aller lire ou écouter les travaux de vulgarisation de Marc André Sélosse – c’est juste fascinant.
Etat de l’eau dans le sol
La mesure de l’eau dans le sol se fait globalement de trois façons différentes :
- Via les sondes tensiométriques qui mesurent la force de succion de l’eau par les racines, c’est-à-dire la force de tension que doit exercer le système racinaire pour extraire l’eau du sol
- Via les sondes capacitives qui mesurent la quantité d’eau présente dans le sol. Ces sondes, à capteur unique ou à multi-capteurs le long d’un profil vertical de sol, mesurent l’humidité contenue dans un volume de sol et non pas l’humidité sur une surface de contact avec un capteur. Ces sondes peuvent être révélatrices de la structure du sol, en mettant par exemple en évidence des zones de compaction là où l’eau ne circule pas. Les sondes capacitives peuvent être fixes pour une mesure de l’eau dans le sol en continu, ou mobiles – les sondes seront alors déplacées entre des tubes déjà implantés dans le sol.
- Via les lysimètres, plus rares, qui mesurent exactement ce que la plante utilise
- On pourrait parler aussi de sondes qui mesurent la porosité du sol pour éviter les phénomènes d’asphyxie racinaire (dans le cas d’un excès d’eau pour le coup).
Les sondes du sol servent principalement à voir si le sol a des contenus en eau suffisants en début de saison. Certains considèrent que ces sondes ne sont pas utilisables pour l’irrigation mais seulement pour évaluer le niveau de remplissage du sol parce que savoir qu’un front humide est présent à plusieurs dizaines de centimètres sous terre n’indique pas pour autant ce dont la plante a besoin
Le positionnement des sondes doit être réfléchi sérieusement pour des raisons de variabilité importantes de conditions de sol. Ce placement doit être pensé notamment par rapport à sa localisation spatiale dans la parcelle et par rapport au système d’irrigation, sa proximité avec les cultures (proche des racines ou non), sa position dans le tour d’eau (plutôt au début).
Les sondes sont limitées par leur profondeur d’installation. Dans le cas où les racines creusent plus profondément que la position du capteur, on peut se retrouver avec une information légèrement biaisée. On pourrait également reprocher à ces sondes le fait qu’elles ne voient pas le bulbe d’humectation du sol dans son entièreté. La texture du sol (présence de sables ou de cailloux) doit également être considérée avec attention.
La mesure de l’eau dans les systèmes d’irrigation
Les compteurs de télérelève permettraient d’avoir accès à une donnée fine et en temps réel de la volumétrie des prélèvements des agriculteurs, qui reste encore actuellement une inconnue majeure. Sans cette donnée mesurée, les estimations restent possibles (par exemple en travaillant avec les surfaces irriguées et en se disant que telle culture nécessite tant d’eau) mais surtout très incertaines. Certains agriculteurs ont également leur propre forage et il reste difficile de savoir ce qui est alors réellement prélevé (voir les sections « Agricultures irriguées et pluviales en France » et « Peut-on vraiment tout mesurer et compter »).
Gérer et Organiser
Les sources de données – téléchargeables gratuitement ou visualisables sur des plateformes en ligne sont quand même assez variées. On y retrouve des choses autour :
- Des données climatiques plus ou moins agrégées (ex : Météo France, Climat HD)
- Des systèmes d’informations qui présentent des statistiques sur l’eau à des échelles relativement larges (FAOSTAT, Water STAT)
- De projections et des adaptations aux environnements climatiques à venir (ex : l’outil Canari de Solagro ou l’outil Awa d’Agri-Adapt, l’outil Wapor de la FAO)
- Des bases de données d’inventaires et de facteurs d’émission autour du sujet de l’eau l’eau (ex : inventaire EcoInvent)
- Des données autour des risques liés à l’eau (ex : l’outil Aqueduc du World Resources Institute – voir la figure sous la liste de source de données) :
- Des données sur l’état des sécheresses (observatoire européen des sécheresses, cartes de ProPluvia)
- Des données sur les prélèvements d’eau (Banque Nationale des Prélèvements en Eau, InfoTerre du BRGM, bases de données des directions départementales des territoires ou des chambres d’agriculture…)
- Des données sur l’état des nappes et des rivières (suivi des nappes à travers le portail ADES2 de l’Office Français de la Biodiversité et le portail SIGES du BRGM, suivi de la hauteur et du débit des cours d’eau sur l’Hydroportail)
- Des données de pratiques agricole pour évaluer le lien entre l’état des ressources en eau et ce qui se passe autour (données du recensement agricole, le registre parcellaire graphique, les pratiques agricoles en grandes cultures [PKGC], les données Terre-Lab…)
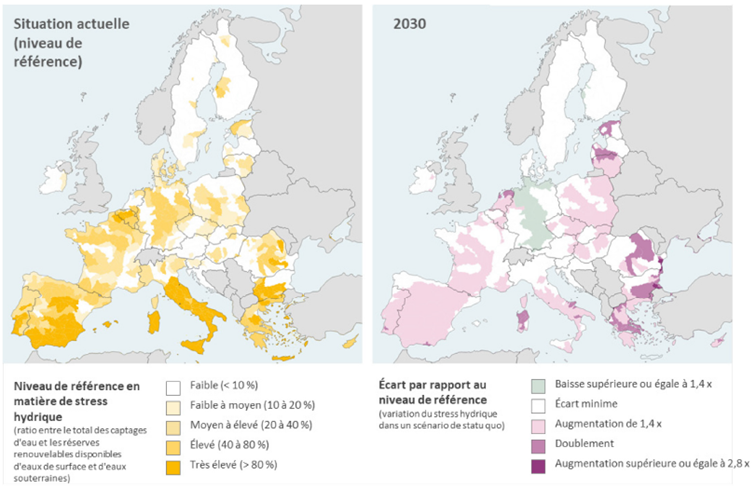
Figure. Niveaux de stress hydriques et actuels projetés. Source : Outil Aqueduct, World Ressources Institute
Tout le monde n’a néanmoins pas toujours la même définition de l’ouverture des données (open data). Pour certains, les données sont par exemple seulement visualisables et téléchargeables. Même si les raisons invoquées peuvent tourner autour de l’anonymisation des données (les données peuvent être agrégées à des échelles spatiales larges), les arguments sont parfois un peu fébriles. Les données sont parfois mises à disposition plusieurs mois voire années après leur collecte ce qui peut en limiter leur pertinence pour développer des services industrialisés (les données du PKGC sont par exemple compliquées d’accès et le registre parcellaire graphique – RPG – est disponible souvent avec 1 ou 2 ans de délai par rapport à l’année en cours).
Les données de Météo France sont également payantes et on pourrait se demander si, au vu de l’urgence climatique, les données ne devraient pas être considérées d’intérêt général et être largement partagées. Cette ouverture de données pourrait permettre à des prestataires de services d’utiliser ces données dans des outils de prospective agricole et/ou de modélisations complexes de situations agronomiques.
De manière plus générale, bien que des données hydrologiques soient collectées dans presque tous les grands bassins fluviaux du monde, leur qualité, leur distribution, leur disponibilité et leur accessibilité sont très variables, de même que les variables surveillées.
La mise en place d’infrastructures numériques autour de la connaissance sur l’eau (on peut parler aussi de digitalisation de la gestion de l’eau) a du sens pour que les acteurs partagent leurs bases de données sur des référentiels communs pour être capable de prendre du recul et prendre des décisions complexes en croisant et mélangeant des bases de données multi-acteurs, spatiales, temporelles et multi-factorielles. Chaque acteur a encore sa propre source de données et ses propres enjeux. Les plateformes de modélisation sont multiples (hydrauliques, hydrologiques, Eau-sol-Plante, Eau Souterraines) et ne sont pas encore intéropérables.
En France, la diffusion, intéropérabilité, et normalisation des données de l’eau sont gérées par des organismes tels que l’IOEau avec des standards comme INSPIRE ou SANDRE. Je n’ai malheureusement pas réussi à les joindre pour la rédaction de ce dossier… (si jamais vous me lisez).
Conseiller et Former
La méthode des bilans hydriques
Le bilan hydrique est établi, à l’échelle de la saison culturale, selon le principe que les apports d’eau globaux (pluie, irrigation, stock initial du sol) se répartissent entre la transpiration de la culture et les différentes pertes : l’évaporation directe et la dérive en aspersion, le drainage, ou encore l’eau restant dans la zone racinaire après récolte et l’évaporation du sol (Fig. 31).
L’équation du bilan hydrique nous permet de vérifier que le bilan hydrique global établi sur la saison d’irrigation est bien équilibré :
Pluie + Irrigation + Stock du sol initial = Transpiration + (évaporation/dérive + drainage + eau restant dans zone racinaire après récolte + évaporation du sol)
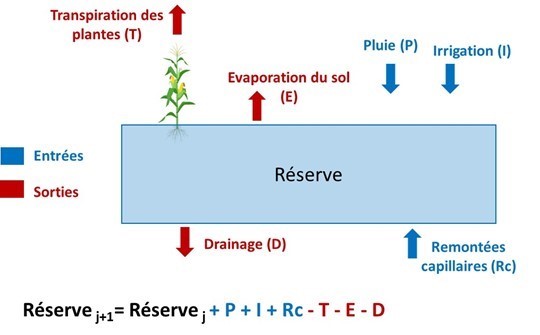
Figure 31. Entrées et sorties d’un bilan hydrique classique à la parcelle
Si la méthode du bilan est maintenant plutôt bien théorisée et acceptée scientifiquement, toute la difficulté de l’utilisation de la méthode réside dans l’estimation précise des termes de l’équation. Pour les irrigants, vous aurez peut-être deviné que la problématique est bien d’évaluer le plus fidèlement possible l’entrée (Irrigation) du bilan hydrique que l’on peut retrouver une fois que l’ensemble des autres paramètres du bilan ont été estimés. La décision d’irriguer ou non sera ainsi ajustée en fonction du paramétrage initial (type de sol, taille de la réserve utile, culture, …), de l’acquisition en temps réel des données météorologiques (pluie, évapotranspiration potentielle, température) et de la saisie des précédents apports d’eau d’irrigation.
La méthode des bilans hydrique fait partie d’une des deux grandes méthodes de pilotage de l’irrigation. Contrairement aux méthodes basées sur la mesure des paramètres du sol (voir la section « Etat de l’eau du sol »), la méthode des bilans hydrique et une forme de modélisation du système sol-plante-atmosphère
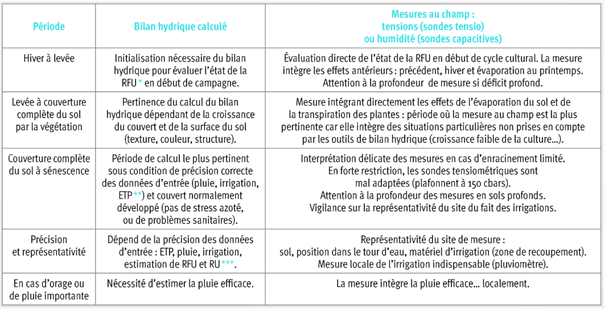
Figure 32. Avantages et inconvénients des deux grandes familles d’outils d’aide à la décision pour le pilotage de l’irrigation. Source : Gendre, S. (2020). Irré-LIS®, exemple d’outil d’aide à la décision en irrigation. Cairn.Info
Les modèles classiques de bilan hydrique sont présentés sur la figure 25. La FAO a également développé son modèle AquaCrop libre de droits et en accès libre, parfois réutilisé par des fournisseurs de services de préconisation hydrique. D’autres modèles (plutôt utilisés en recherche) intègrent des modèles de bilan hydrique et sont utilisés pour estimer des rendements potentiels et d’autres rendements limités par l’eau (comme nous l’avons vu dans la section sur les potentiels de rendement en début de dossier) : CERES, APSIM, ou encore CropSyst
Le modèle de bilan hydrique est en fait une simulation de flux de sève dans la plante mais force est de constater que ce flux n’est jamais réellement mesuré. Pour les cultures annuelles, l’état hydrique est rarement mesuré directement parce que les outils numériques pour le faire n’existent que très peu. C’est souvent la teneur en eau du sol qui est utilisée comme indicateur indirect du besoin des plantes. Au lieu de regarder la demande, les approches principales s’intéressent ainsi plutôt à l’offre en eau du sol. Pour les cultures pérennes, des outils de mesures ont déjà été proposés (capteurs de flux de sève, dendromètres…). Je vous invite à relire la section « Observer et Mesurer »).
Les limites principales de ces estimations de paramètres du bilan concernent la réserve utile et l’évapotranspiration des plantes, notamment parce qu’il n’existe pas de relation linéaire simple entre la teneur en eau du sol et les besoins en eau de la plante.
L’évapotranspiration peut, selon les situations, être la principale composante du bilan hydrique, et donc affecter fortement la modélisation (voir la section « Estimation de l’évapotranspiration »). C’est aussi la composante la plus directement et fortement affectée par le changement climatique d’une part, et les activités anthropiques d’autre part (occupation du sol, systèmes de culture, irrigation…). On distingue notamment l’évapotranspiration réelle (ETR) et l’évapotranspiration maximale (ETM). L’ETM correspond à la quantité maximale évaporée par l’ensemble de la culture : elle correspond au besoin de la culture. L’ETR correspond à la quantité d’eau qu’évapore le sol et transpire la plante par jour en conditions culturales normales. Je vous rappelle que, comme nous l’avons vu dans la section « Estimation de l’évapotranspiration », l’évapotranspiration réelle est difficile à estimer, et c’est généralement l’évapotranspiration potentielle – reliée à l’évapotranspiration réelle par un coefficient cultural – qui est utilisée.
Une façon d’évaluer le confort hydrique de la plante est d’estimer le rapport ETR/ETM pendant la période de production (notamment la période de floraison-maturation pour les cultures annuelles). Le déficit hydrique, ou besoin en irrigation potentielle, peut être estimé à partir de la différence ETM – ETR, calculée sur la même période. Ces deux valeurs, confort hydrique et déficit hydrique, peuvent ensuite être comparées à l’offre (la pluie et/ou l’irrigation) et la demande climatique (évapotranspiration potentielle) à l’échelle annuelle.
A l’échelle annuelle, l’état de développement de la culture – sa phénologie – joue un rôle important dans la demande en eau de la plante. Le réchauffement climatique jouera donc aussi sur l’ETM via les déplacements et raccourcissements des cycles phénologiques. Plusieurs éléments vont jouer sur l’évolution d’ETM pendant la période floraison-maturation (période de calcul du confort hydrique pour la majorité des espèces), dont notamment :
- ET0 – l’évapotranspiration de référence
- le coefficient cultural (kc) qui représente l’influence du feuillage,
- la durée de la période floraison-maturation et
- le positionnement calendaire par rapport à la demande climatique.
La valeur d’ET0, à une date calendaire donnée, a tendance à s’accentuer à cause de l’augmentation des températures et du rayonnement. Cette augmentation est toutefois freinée par l’effet antagoniste du CO2, en particulier chez les plantes en C3 (blé, tournesol, fétuque, vigne, conifères et feuillus), en raison de la propriété qu’ont celles-ci de réduire leur transpiration en réponse à l’accroissement de la teneur en CO2. Chez les plantes en C4 (maïs, sorgho), ce frein est très peu actif.
La valeur du coefficient cultural (Kc) peut diminuer dans des conditions d’extrême sécheresse en phase végétative, affectant l’indice foliaire, ce qui peut se produire pour les cultures de printemps conduites en pluvial sur des sols superficiels. Les coefficients culturaux (Kc) classiquement utilisés sont assez génériques. Ils sont issus d’une littérature agrégée, pas toujours localisée dans l’espace, ce qui peut donner lieu à des erreurs d’estimation de l’évapotranspiration réelle. Au dire de certains interviewés, les coefficients culturaux seraient souvent surestimés dans la littérature, induisant alors des demandes en irrigation trop importantes par rapport à la réalité. Estimer un coefficient cultural est compliqué parce qu’il existe des relations importantes entre l’architecture de la plante (largeur, hauteur, porosité, orientation…) et son bilan hydrique. Chaque plante a également des capacités différentes d’extraction de l’eau du sol avec son système racinaire (différents porte greffe ont aussi différents niveaux d’extraction de l’eau). Ces coefficients culturaux se doivent de représenter le plus finement possible l’état des plantes et doivent être estimés au moment où le bilan hydrique est réalisé (le coefficient cultural varie au cours de la saison). C’est d’ailleurs pourquoi certains travaux mettent en avant l’usage d’imagerie (souvent satellitaire) pour affiner la détermination des coefficients culturaux.
Les coefficients culturaux sont actuellement définis dans des gammes de validation particulières. On peut déjà se demander comment ces derniers vont évoluer avec le réchauffement climatique et avec l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère (on peut s’attendre par exemple à un échaudage accéléré des cultures). Les coefficients culturaux sont valables sur des systèmes de cultures relativement simples (peuplements mono-spécifiques). Qu’en est-il lorsque l’on commence à rajouter des systèmes mixtes ou des systèmes avec des inter-rangs différents ? Est-ce que ces systèmes permettraient d’être réellement moins gourmands en eau ?
Les bilans hydriques peuvent s’établir à des échelles spatiales plus larges. On parlera dans ce cas-là de bilans hydrologiques – plutôt établis à des échelles de bassin versant. A des échelles de travail plus larges d’allocation d’eau (par exemple au niveau d’un bassin versant), l’incertitude peut être très forte sur la quantité de surfaces irriguées, le type de culture ou encore le type de sol en place. On trouvera ici plutôt des modèles du type Simult’eau (Inrae), Maelia, ou encore Wasabi (Chaire ELSA PACT). Ce sont généralement des modèles intégrés de bassin versant qui modélisent les flux hydriques à l’intérieur d’un bassin versant avec l’objectif d’aider les décideurs, de tester des scénarios d’aménagement hydraulique ou d’option agricole, ou encore de tester des scénarios de changement climatique. A ces échelles-là, l’incertitude liée au coefficient cultural reste assez minime – le gros de l’incertitude résidant dans la modélisation climatique (passage d’un modèle global à un modèle régional puis local) et dans la typologie du sol (sol superficiel, profond…). Des chiffres nécessaires à la construction de grands bilans hydriques existent par bassin versants (taux d’évaporation, consommation par usage…) mais de grosses approximations subsistent, notamment par exemple parce que l’on considère que les volumes prélevés sont connus, alors que beaucoup d’eau est prélevée et restituée au milieu.
La majorité des outils numériques d’irrigation travaillent en demandant une évapotranspiration maximale (ETM) de façon à limiter le risque de ne pas respecter les besoins en eau des plantes. Il est donc supposé aussi implicitement que la plante doive atteindre son rendement final sans stress hydrique. Une première limite à cette façon de penser est que nous allons de toute façon devoir revoir considérablement notre usage de l’eau et très vraisemblablement le diminuer.
La question du besoin en irrigation peut s’examiner de différentes façons. On peut privilégier une analyse « au potentiel » qui évite toute limitation de l’alimentation hydrique des plantes (ETR= ETM), ou bien intégrer une réalité hydrologique et agricole qui se caractérise par une indisponibilité plus ou moins marquée de la ressource en eau (ETR < ETM). On peut également distinguer le cas des cultures pour lesquelles l’irrigation est centrale, typiquement le maïs, de celui des cultures pour lesquelles l’irrigation n’intervient qu’en fin de cycle, typiquement le blé ou les cultures pour lesquelles il s’agit d’une irrigation d’appoint, comme le sorgho ou le tournesol. C’est donc une réflexion agronomique plus fine et une reconception de la notion d’efficience de l’eau qui est proposée. On peut également se demander si le rendement est vraiment le paramètre le plus adéquat pour penser la productivité de l’eau. Peut-être ce rendement devrait-il être remplacé par un indicateur technico-économique ou un indicateur environnemental. Il faudra même peut-être jongler entre plusieurs critères à la fois – et les pondérer – avant de prendre une décision d’irrigation.
Etalonner les modèles de bilan hydrique reste relativement compliqué. Et d’un point de vue physiologique, il n’est pas évident de savoir si l’irrigation soulage le stress de la plante ou pas.
Une ressource limitée n’est pas forcément limitante tous les ans. Lorsque les débits des équipements d’irrigation sont réfléchis, on sait finalement qu’on ne s’équipera pas pour gérer toutes les années climatiques et que certaines années seront plus compliquées que d’autres. Certains outils commencent ainsi à développer le concept d’irrigation en volume limité dans le sens où le volume à disposition ne couvrira pas chaque année les besoins en eau de la plante (ex : Irré-LIS d’Arvalis). Le modèle de bilan hydrique d’Arvalis est d’abord utilisé sur une parcelle avec un long historique sans contrainte de quota pour estimer le volume pour être en évapotranspiration maximale (ETM) sur la parcelle. Les quotas d’eau sont ensuite demandés à l’utilisateur pour passer en volume limité et l’outil recrée une courbe de déstockage de l’eau en volume limité. Une courbe de volume disponible est construite en début de saison et on s’intéresse alors à la dynamique que cette courbe devrait suivre pour aller au bout de la saison tout en répartissant au mieux le volume sur la saison.
De manière générale, les outils numériques peuvent préconiser un volume d’irrigation et/ou une date d’irrigation. Certains ne s’aventurent pas dans l’estimation d’un volume dans la mesure où ils considèrent que les paramètres qui sous-tendent le bilan hydrique ne sont pas nécessairement bien connus. La date d’irrigation ou le calendrier prévisionnel d’irrigation est en effet au cœur de la stratégie d’irrigation. Des fournisseurs de services ne proposent en réalité pas une date à laquelle irriguer mais une date à laquelle la culture sera sous stress hydrique, ce qui demande alors à l’agriculteur de recalculer lui-même la date à laquelle irriguer sur le terrain. La date d’irrigation peut également se retrouver en testant des courbes de réponse à l’eau sur certaines parcelles, en utilisant en quelque sorte un historique de connaissances pour définir la stratégie qui s’est avérée la plus payante sur les années passés. La question du fréquentiel climatique étant prépondérante – la préconisation deviendra de plus en plus incertaines au gré du déréglement climatique en cours, surtout que les climats futurs seront souvent largement différents des climats que nous avons déjà connus par le passé. Ces enjeux posent de manière générale la question de la limite des outils actuels dans le cadre du changement climatique. Les bilans hydriques actuels sont limités lorsqu’il fait très (trop) chaud parce qu’ils ne prennent pas encore suffisamment en compte les limites physiologiques des plantes.
Les outils doivent être pensés en accord avec la stratégie et le matériel d’irrigation de l’exploitation agricole. Un exploitant qui dispose d’une pompe gravimétrique ne sera pas en mesure de piloter extrêmement finement son irrigation et n’aura donc peut-être pas besoin d’outils de mesure ou de pilotage particulièrement affinés.
Aide à la décision d’assolement en conditions pluviales et irriguées
La gestion de l’eau peut également se travailler par l’assolement parcellaire. L’outil Asalée a par exemple comme objectif de comparer des stratégies d’assolement, pluvial et irrigué, selon le volume d’eau disponible et les variabilités climatique et économique.
Appui à la concertation
On pourra également citer les « serious game » au format numérique – à partir de modèles et simulations – utilisables dans des cadres de concertation et de discussions entre acteurs du territoire et ce dans différentes dimensions spatiales et temporelles. Ces outils peuvent par exemple servir à objectiver le parcours de l’eau et mettre en débat le partage de l’eau avec différents acteurs du territoire. Ces approches numériques sont aussi le lieu pour étudier des scénarios comme par exemple l’impact d’une modernisation de canaux, l’évolution des pratiques agricoles si les modes de cultures et d’irrigation changent, ou encore la réflexion autour de la gestion intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines dans un contexte de changement climatique.
Appui à la définition de zones agro-climatiques
Les historiques climatiques peuvent être utilisés pour redéfinir des zones de production mais aussi pour identifier plus rapidement les années à enjeux climatiques en vue d’échanges avec des agriculteurs (fréquence d’année présentant des conditions climatiques défavorables, impacts culturaux engendrés par ces évènements climatiques défavorables…).
Appui au réglage du matériel d’irrigation
Les outils numériques passent également par l’appui aux réglages du matériel d’irrigation. Buses, Goutteurs, Pompes ou encore Electrovannes sont autant d’équipements qui, mal réglés, augmentent les différences entre l’eau préconisée et l’eau qui sort de l’équipement d’irrigation (voir la section sur le matériel d’irrigation ». Et les problématiques sont nombreuses : mauvaise pression, conditions météorologiques d’application non optimales, buses bouchées…
Ces aides aux réglages sont déjà une manière d’éviter les gaspillages inutiles mais peut-être aussi et surtout de s’assurer de l’adéquation entre la préconisation et l’application.
Cartographie de l’humidité et des surfaces irriguées
Les images satellitaires – en fonction de leurs résolutions spatiale, temporelle, et spectrale – apportent une composante relativement large et dynamique pour la gestion de l’eau.
Première cible, la cartographie d’humidité des sols (humidité volumique du sol, surtout en surface). Ces cartes sont plutôt générées en combinant des images du domaine actif (l’imagerie radar – notamment pour de l’information sol) et du domaine passif (de l’imagerie multispectrale – pour de l’information sur de la végétation). Et les approches algorithmiques pour construire ces cartes sont assez variées : Modèles physiques (par exemple Water Cloud Model), intelligence artificielle par apprentissage, approche couplée modélisation hydrologique et télédétection (avec des équations de type bilan hydrique pour détecter des évènements d’irrigation, c’est-à-dire si un agriculteur a irrigué ou pas).
Les informations multispectrales et radar, qui ne sont pas forcément acquises simultanément d’ailleurs, servent à séparer l’influence de la végétation sur le signal final qui atteint le sol (ou dit autrement, le fait que la végétation atténue le signal complet). Les images radar sont susceptibles de fournir de l’information sur la teneur en eau dans le sol à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Les ondes radar en bande C (6 cm de longueur d’onde) ont une pénétration de l’ordre de 5-10 cm dans le sol (c’est le cas de la constellation Sentinel-1) tandis que les ondes en bande L (25 cm de longueur d’onde) pénètrent un peu plus (environ 10-15 cm) mais cette pénétration reste faible en milieux agricoles avec un sol argileux ou limoneux.
Mais ça n’est néanmoins pas si simple que ça. Le contenu en eau en lui-même empêche déjà les ondes de pénétrer trop en profondeur. C’est aussi le cas pour la profondeur de sol et pour le type de culture en train de pousser. En bande C, les cultures denses empêchent de détecter correctement l’humidité du sol. Selon les interviewés, il semblerait difficile d’avoir de l’information sur l’humidité du sol à plus de 15 cm de profondeur avec les capteurs de d’observation de la Terre satellitaires actuels.
L’imagerie radar est assez complexe à utiliser parce que les données radar sont impactées à la fois par la rugosité du sol mais aussi par l’humidité de surface du sol. Sur une parcelle très rugueuse après labour, on aura souvent tendance à surestimer l’humidité.
La résolution de cette équation à deux inconnues (rugosité et humidité de surface) est rendue compliquée par le fait que les satellites actuels ne disposent que d’un capteur radar en bande C, X ou L. On ne peut donc pas résoudre cette équation complexe sans faire des hypothèses fortes. On peut espérer que si la répétitivité temporelle des images s’améliore, on pourra coupler des images en supposant que l’humidité ou la rugosité n’a pas trop changé entre les deux dates d’acquisition de données. Cette hypothèse n’est néanmoins pas toujours réaliste. Après labour, la rugosité va changer et ne va pas rester trop longtemps la même parce que le sol pourra avoir été retravaillé (on arrive donc à un sol plus lisse). Les modèles semi-empiriques actuels ont été développés à partir de grandes bases de données qui ont permis de modéliser le signal radar (en fonction des paramètres instrumentaux et des paramètres du milieu). Les modèles physiques actuels ont été principalement bâtis avec des données de petites longueurs d’onde (6 cm) mais aussi pas mal avec des ondes en bande L (grandes longueur d’ondes). Le nombre plus faible de points de calage avec des données de grande longueur d’onde peut poser questions quant à la transposition du modèle avec de nouvelles données. Notez que les données radar vont dépendre aussi de l’angle d’incidence et de la longueur d’onde utilisée mais ces données instrumentales sont connues au moment de la mesure.
La nouvelle mission satellitaire NISAR (3-10 m de résolution spatiale et 12 jours de revisite) promet de disposer de bandes radar à la fois S et L, ouvrant la perspective de répondre en même temps à la problématique de traversée du couvert et de correction des effets d’atténuation de la végétation
Les outils actuels cartographient l’humidité de surface. Et cette humidité de surface est différente de la notion de réserve utile qui est utilisé dans les modèles de croissance de plante. Des cartes de réserve utile existent à des échelles de 90m de résolution (mais pas à 90 m de précision). Descendre à des échelles spatiales inférieur est autrement plus compliqué, notamment parce que cette réserve utile dépend de la texture du sol, de la profondeur d’enracinement mais aussi de la teneur en MO du sol, toutes ces informations d’hydro dynamique du sol dont nous ne disposons généralement pas à des échelles fines.
Il semblerait y avoir néanmoins une corrélation entre humidité de surface et précipitations (mais ça n’est pas la même chose d’aller jusqu’à relier l’humidité de surface à des phénomènes de changement climatiques – des travaux à des échelles spatiales plus larges pourraient permettre d’y arriver). Les cartes d’humidité peuvent être intéressantes pour avoir une information indirecte sur les pluies.
Mais c’est peut-être la cartographie de l’irrigation qui a le plus d’intérêt. Cartographier les zones irriguées n’est pas facile mais reste faisable. La détection de zones irriguées est un sujet est assez clef, notamment au vu de l’actualité du moment. C’est principalement sous l’angle de la cartographie d’occupation des sols avec des zones irriguées ou non que le sujet est traité. Les travaux marchent bien pour le maïs où l’hypothèse faite est qu’un maïs irrigué se développe plus vite et fort qu’un maïs non irrigué (les travaux semblent encourageants pour le blé et le tournesol qui commencent à être irrigués mais les mêmes cartographies en cultures pérennes sont plus difficiles).
Ce qui est par contre autrement plus compliqué, c’est de cartographier les épisodes d’irrigation. Les précisions sont plutôt bonnes sur des milieux semi-arides. Par contre, dans les milieux humides, surtout quand il pleut, il reste relativement difficile de différencier pluie et irrigation. Il faut alors souvent prendre un peu de recul et travailler à l’échelle d’un bassin entier pour pouvoir séparer ces épisodes de pluie. Si les signaux radar augmentent sur ces grandes échelles spatiales, on pourra par exemple considérer que de la pluie est tombée. Pour cartographier l’irrigation, une possibilité est d’étudier la différence entre les signaux radar de deux dates différentes (on oublie alors la pluviométrie). Sur certaines périodes de l’année, on ne se trompe quasiment pas. Mais pendant l’été, quand il fait très chaud, quand les parcelles sont irriguées, en deux jours, l’humidité du sol peut beaucoup changer. Le sol, en quelques jours à peine, peut perdre son humidité et revenir à un niveau pré-irrigation. On comprend par-là que plus la répétitivité temporelle des images est fine, plus la détection des épisodes d’irrigation s’affine. D’autres utiliseront des images multi-temporelles et cartographieront des anomalies d’humidité par rapport à une année (sans forcément utiliser d’inversion de modèles).
Petite digression, la discrimination du système d’irrigation en place sur les parcelles (aspersion, goutte à goutte..) par imagerie radar parait assez compliquée.
Aller plus loin sur la mesure des quantités d’eau apportées est une autre paire de manches. En utilisant l’imagerie visible, on aurait finalement accès à assez peu d’information sur les apports d’eau d’irrigation. Avec des données thermiques (voir section « cartographie de la température du couvert »), on commence à avoir une idée un peu plus précise de l’évapotranspiration réelle de la plante et on pourrait ainsi confronter des résultats d’imagerie avec des modèles de bilan hydrique pour estimer si un apport d’eau a été réalisé ou non. Une certaine humidité du sol pourra témoigner ou non d’un précédent apport d’eau mais force est de constater que les méthodes sont encore assez laborieuses. On est donc encore assez loin du pilotage fin de l’irrigation par satellite.
Certains travaux sont en cours pour réaliser des cartes d’occupation du sol et détecter précocement les cultures d’été. A l’échelle nationale, la carte d’occupation des sols OSO existe mais ne correspond pas toujours aux attentes des gestionnaires qui veulent connaitre la dynamique de cultures au moment de la saison et potentiellement en temps réel. La volonté étant de pouvoir aller jusqu’à l’estimation des consommations en eau sur les territoires et l’impact sur les débits. En couplant des modèles hydrologiques avec des images de télédétection, l’idée est de pouvoir suivre la végétation sur l’année et d’affiner les périodes de début d’étiage (en validant par la suite les modélisations avec des données de télérelève sur le terrain). Encore une fois, ici, les images satellites sont intéressantes pour spatialiser des phénomènes qui seraient considérés constants avec des modèles hydrologiques (par exemple l’état de croissance d’un maïs sur un territoire large).
Agir et intervenir sur le terrain
Certains équipements d’irrigation sont dits asservis en ce sens que leur fonctionnement est contrôlé par des phénomènes extérieurs. Je ne parle pas ici de contrôle à distance classique qui existe déjà comme on pourrait l’imaginer pour du contrôle domotique chez soi (activation d’une pompe à distance, lancement d’une tour d’eau à une heure programmée) et qui a peut-être plus trait à de l’électronique que du numérique. Je parle ici d’une activation du matériel d’irrigation suite par exemple à des données d’une station météorologique connectée proche – station qui enclencherait une irrigation pour cause de défaut de pluie, ou du dépassement d’un seuil fixé par avance. Sans rentrer dans trop de détail, on pourrait imaginer que des questions assurantielles rentrent en jeu parce qu’un agriculteur qui perdrait sa récolte pourrait vouloir se plaindre d’un système automatisé qui n’aurait pas déployé une irrigation à temps.
Difficile de trouver des opérations culturales qui ne sont pas modulables en intra-parcellaire – l’irrigation n’y fait pas exception. La modulation intra-parcellaire vient des Etats-Unis mais équipe encore très peu d’agriculteurs en France. La modulation peut se faire de deux manières principales : soit en modulant la vitesse d’avancement (par exemple quand il y a plusieurs cultures différentes – le système fonctionne pour pivot et enrouleur), soit en modulant l’ouverture des buses. Même si, techniquement, les infrastructures semblent fonctionner, on peut se poser la question de la légitimité de telles installations sachant que la variabilité des paramètres qui devraient sous-tendre une irrigation modulée (réserve utile notamment) ne sont généralement pas connus à l’échelle spatiale de la modulation. Des cartes de résistivité, couplées à des sondages tarrière, peuvent certes être une option, mais ne sont pas encore largement déployées.
La perspective de développement de la modulation est intéressante sur les pivots mais beaucoup plus compliqué sur le reste. Sur les enrouleurs, avec canon motorisé, l’intervention pourrait être imaginée à l’échelle du demi-hectare – une échelle très largement supérieure à celle envisageable avec un pivot. Si on voulait faire la même chose avec du goutte à goutte, il faudrait discrétiser le système et installer des électrovannes partout pour conduire le dispositif de façon indépendante d’un pixel à un autre de la carte de modulation d’irrigation. Des solutions sont à l’étude quant à la proposition de réseaux de goutteurs en commandant les lignes indépendamment les unes des autres. Un interviewé aura préféré utiliser le terme d’irrigation précise plutôt que celui d’irrigation de précision qui pour lui, était moins adapté. En écho à un précédent dossier sur la fertilisation azotée, on retrouve ici encore des approches basées sur de la répartition d’une quantité d’irrigation moyenne à la parcelle et d’autres basées sur une spatialisation d’une quantité d’irrigation (sous-entendu une spatialisation d’un bilan hydrique à la parcelle obtenu par modélisation).
De manière générale, l’intérêt technico-économique de la modulation de l’irrigation n’a pas encore été prouvé. L’évaluation est de toute façon compliquée parce qu’en creusant à l’échelle intra-parcellaire, on ne peut pas s’intéresser à un seul facteur. Même si le matériel d’équipement d’irrigation est déjà techniquement capable d’ouvrir et de fermer des vannes par zones d’irrigation (pour de la modulation), l’intéropérabilité des données d’irrigation pour intégrer une carte de préconisation dans un matériel d’irrigation demandera encore pas mal de travail…
Encore très peu présents dans l’écosystème, les robots d’irrigation commencent à pointer le bout de leur nez. Le robot français Oscar, qui fonctionne en hydro-électricité, est capable d’assurer une irrigation modulée pour les cultures de moins d’1m de hauteur.
Dans les outils numériques orientés « Action et Intervention » sur le terrain, on peut également citer les panneaux solaires modulables, notamment ceux dont l’orientation est pilotée par des modèles agronomiques pour limiter l’évapotranspiration des cultures.
Tentons de prendre un peu de recul
A-t-on vraiment besoin de numérique pour gérer l’eau ?
Peut-on vraiment tout mesurer et compter ? L’exemple des compteurs de télérelève
Dès 1992, la loi sur l’eau instaure l’obligation de moyens de mesures ou d’évaluation appropriés des prélèvements en eau agricole. Le compteur (à l’époque non connecté) fournit une donnée des volumes prélevés par les agriculteurs-irrigants sur une saison ou une année. Ces données permettent à l’usager de se positionner par rapport à l’utilisation de son quota disponible et d’établir des bilans hydrologiques, et permettent au gestionnaire de mieux piloter des lâchers d’eau et d’estimer ce qu’il y a dans les réserves. A partir du moment où il est connecté, le compteur permet d’accéder à des données journalières de consommation et non plus à des relevés annuels (souvent réalisés manuellement) pour avoir une idée plus fine des consommations sur le terrain. Pour un gestionnaire, c’est aussi un moyen de mieux concevoir les stratégies de gestion et d’allocation et d’ajuster les règles de fonctionnement en fonction des typologies de clients.
Les compteurs connectés permettent de pallier aux compteurs conventionnels, pas toujours précis, et aux données déclaratives des irrigants qui, outre le fait qu’elles ne soient pas toujours de qualité, peuvent arriver avec pas mal de délai. Plus généralement, le compteur de télérelève a plusieurs apports potentiels :
- C’est d’abord un vecteur de connaissances, producteur de données auxquelles certaines promesses d’amélioration vont être rattachées. Le compteur pourra par exemple servir à un comptage différé de l’eau pour éviter que le décompte des quotas d’irrigations ne démarre si le barrage du gestionnaire ne soutient pas encore le débit de la rivière.
- Le compteur connecté peut servir à détecter les fuites, notamment pour les réseaux de distribution d’eau ou pour les systèmes d’irrigation et utiliser cette information pour faire de la maintenance prédictive. Cet enjeu est peut-être moins fort en agriculture puisque le prix de l’eau au m3 est moins important que celui du réseau domestique classique.
- L’estimation précise des consommations peut être utilisée pour instaurer une sorte de bourse d’échanges de l’eau entre irrigants – avec une notion de marchés de l’eau qui peut recouvrir plusieurs formes (transferts de quotas entre agriculteurs sous-utilisateurs et sur consommateurs). D’un côté, cette proposition reflète l’ambition de redonner de la souplesse au dispositif de partage de l’eau dans le sens où l’ensemble des volumes d’eau disponibles est alloué, mais pas nécessairement utilisé. De l’autre, la nouvelle mesure permet aux gestionnaires de reconnaître une eau qui a été appropriée et privatisée par les agriculteurs de manière informelle (en dehors d’une reconnaissance légale) tout en s’assurant un rôle dans l’organisation du marché de l’eau par le contrôle des ventes (rendu possible par la donnée).
- La connaissance apportée par le compteur pourrait permettre rouvrir l’allocation des quotas en abandonnant la référence à un volume par hectare et aux surfaces souscrites par le passé pour privilégier un volume global défini à l’échelle de l’exploitation (et prendre en considérations les contextes pédo-climatiques de chacun).
- Des données fines pourraient aussi permettre d’ajuster la tarification de l’eau à la diversité des consommations avec pour objectif de réduire les dépassements des agriculteurs, surtout lors des années sèches.
- D’un point de vue territorial, l’aggrégation de données personnelles d’utilisation de l’eau peut être vue comme un pré-requis à une coordination de la gestion de l’eau, avec un potentiel fort d’anticipation et de préparation aux crises à venir (ex : une sécheresse). Au vu des enjeux croissants sur l’eau, on pourrait imaginer aussi de l’importance stratégique que pourraient porter de tels relevés, avec des volontés de certaines structures de vendre ces informations à prix d’or.
- Certains travaux soulignent la pertinence d’utiliser ces données pour mettre en place des « nudge » ou des sortes d’incitation à mieux faire (un des gros intérêts de ces mesures est qu’elles ne coûtent quasiment rien à mettre en place). Des messages sont par exemple envoyés aux irrigants pour leur faire part de leur consommation et la comparer anonymement à celle de leurs voisins irrigants pour leur donner envie, si leur consommation est démesurément haute, de la réduire pour rejoindre le niveau moyen de leurs voisins. Ces travaux comportementaux mettent parfois en avant des effets rebonds non attendus, notamment le fait que des agriculteurs jugés comme exemplaires remontent leur niveau d’irrigation pour rejoindre la moyenne (au lieu de conserver leur niveau plus bas). Cet effet rebond est le témoin que l’eau est le facteur limitant sur les exploitations et qu’un agriculteur, lorsqu’il est soumis à un quota, ne va pas tout simplement refuser une pratie de son volume s’il utilise moins d’eau que ce qui lui est permis. La tendance est plutôt contraire, et l’agriculteur préfèrera produire plus avec le même volume
- Le dimensionnement du réseau est pourtant une question fondamentale pour le gestionnaire (et l’extension du réseau coûte très cher et n’est pas nécessairement accessible partout). Ce dimensionnement est réfléchi en fonction d’un assolement estimé sur un territoire qui permettra de définir la taille du réseau et des tuyaux de l’infrastructure. Avec le changement climatique en cours et la nécessaire adaptation du monde agricole, les assolements sont susceptibles d’évoluer vite et de remettre en question le dimensionnement des ouvrages. Le numérique (avec les compteurs) est en ce sens un moyen peut-être de ne pas surdimensionner les réseaux, justement parce qu’il permet d’avoir une meilleure connaissance des besoins des agriculteurs, et de gérer des seuils d’alerte et de délestage du réseau.
- Enfin, le compteur est aussi un moyen d’éviter la fraude surtout s’il est connecté et qu’il partage des données en temps réel. C’est une façon de s’assurer par exemple que les restrictions quantitatives à certains moments de l’année sont bien respectées (les règles peuvent être différentes par type de client et par période de pointe), que les interdictions d’irriguer sont suivies, ou de mesurer les réductions d’irrigation de quelques dizaines de pourcents
Une question plus profonde est néanmoins de se demander si le compteur est réellement envisagé comme un outil de gestion dans le sens où les technologies numériques ne sont pas neutres (Collard et al., 2019). Quelles sont les données réellement collectées ? Quels sont les paradigmes de gestion de l’eau réellement sous-tendus par l’utilisation de tel ou tel outil connecté ? Quel type de données et d’indicateurs sont mis en avant ? Comment ces indicateurs sont construits ? Qui a réellement besoin de cette information ? Est-ce que savoir en détail la quantité d’eau utilisée sur une parcelle va favoriser une économie d’eau ? Est-ce que la mise en place d’une irrigation à distance sur un périmètre donné amène nécessairement des économies d’eau ?
Mesurer et savoir-compter ne relève pas d’un acte anodin, mais procède au contraire de notre rapport au monde. L’acte de mesurer les prélèvements individuels quotidiennement consolide la volonté des ingénieurs de l’eau de peser dans des décisions avec lesquelles ils sont en prise, impliquant une reconfiguration de leurs rapports avec les agriculteurs. Il nous faut en réalité étudier et évaluer ce que l’introduction de nouvelles techniques et/ou technologies modifie dans l’utilisation de l’eau et dans le paysage plus global de la gestion de l’eau. Et nous devons collectivement casser cette idée d’objectivité du numérique parce que les outils sont toujours construits dans un schéma de pensée particulier. Nous devons produire un discours alternatif aux sujets et paradigmes techniques, de façon à pouvoir resocialiser et repolitiser l’eau. Le numérique apporte certes de l’information mais nous devons nous demander ce que et qui cette donnée numérique sert réellement.
Les acteurs qui poussent l’utilisation de capteurs connectés ont souvent des raisons – parfois cachées – de les mettre en avant. Si des compteurs de télérelève connectés ont effectivement le potentiel de faciliter l’usage et le partage des données ou de mieux gérer les questions de pénurie, on peut par exemple comprendre que les distributeurs d’eau aient tout intérêt à pousser ces capteurs pour acquérir de la donnée manquante pour mieux étalonner leurs modèles hydrauliques (et calibrer leurs lâchés d’eau) et renégocier des seuils de débits ou autre avec des acteurs territoriaux (assurer une meilleure gestion de leur stock d’eau, éviter des potentielles tensions, s’assurer de bien respecter les débits de crise qu’ils ont l’obligation de gérer).
L’objectif est de connaître les usages de l’eau au cours de la campagne d’irrigation. La tâche du gestionnaire n’est pas non plus facile parce que les agriculteurs peuvent aussi dépasser leurs quotas, ce qui rend compliqué le respect du débit objectif étiage (DOE), sous peine de sanction financière pour le gestionnaire. L’utilisation de relevés numériques laisse forcément planer le doute d’un contrôle des relevés par une sorte de police de l’eau. Pour les fournisseurs d’eau, il est effectivement imaginable que des structures institutionnelles leur demandent de prouver que leurs clients n’utilisent pas leur eau n’importe comment, sous forme d’une obligation de moyens ou de résultats. Sans aller jusqu’au flicage, les distributeurs d’eau ne savent finalement pas tant de choses que ça sur la manière dont l’eau est utilisée après la borne d’approvisionnement. Les cultures en place ou les surfaces agricoles irriguées (et totales) ne sont pas connues ce qui ne permet de toute façon pas aux distributeurs d’évaluer la technicité de leurs usagers (les agriculteurs). Et c’est d’autant plus compliqué quand la borne est utilisée par plusieurs agriculteurs en même temps.
Ces enjeux montrent en quoi la production et l’acquisition de données de consommation d’eau dépassent une ambition qui se voudrait purement hydraulicienne. Cette consolidation de l’expertise hydrologique via le compteur d’eau procède d’une réaffirmation du gestionnaire quant à sa légitimité d’être missionné par l’État de la gestion de l’eau sur ce territoire. Il s’agit de rester compétitif dans un domaine où les anciennes concessions faites par l’État ne sont plus une évidence.
Le numérique peut ainsi causer le risque d’une sorte de délocalisation ou dépolitisation de l’eau. Un peu à la manière du télétravail, on peut penser qu’on gère le problème un peu de loin et qu’on peut perdre cette envie de partage et de lien et de comprendre ce qu’implique de devoir utiliser collectivement de l’eau.
Le compteur transforme les relations sociales car sa mise en place est envisagée comme une opportunité de dialogue entre les ingénieurs de l’eau et les autorités en place. La nouvelle mesure et son usage envisagé participent à reconfigurer des rapports dans lesquels les agriculteurs-irrigants endosseraient le rôle d’usagers, voire de clients, consommateurs passifs d’une ressource, car écartés de ses modalités de gestion. Le compteur matérialise l’autorité du gestionnaire sur la vallée et sa conception d’une bonne gestion. Quand la situation l’exige et l’oblige, de nouveaux arrangements sont proposés aux agriculteurs-irrigants par le gestionnaire pour donner de la souplesse au dispositif de partage, avec à la clé pour ce dernier l’acquisition d’une nouvelle donnée. Pour cela, le compteur est mis en scène, scénarisé et devient sous l’action de l’ingénieur tour à tour vecteur de connaissances (sur les prélèvements au pas de temps journalier), objet de consensus (pour différer le comptage), de surveillance et de partenariat (pour contrôler des ventes éventuelles), ou encore une conditionnalité (redéfinition du quota).
Le numérique permet certes de mieux connaitre l’eau mais la question que nous devrions collectivement nous poser est : qui la connait mieux ? Si la conduite de l’irrigation ne repose par exemple par sur un suivi quotidien de l’évolution des quantités d’eau prélevés, le compteur connecté sert-il finalement tant que ça l’agriculteur ? Une meilleure connaissance quantitative est-elle plus intéressante qu’une connaissance de l’historique de cette eau et de la gestion actuelle, de savoir d’où elle vient et comment elle évolue ? Enfin, l’automatisation des relevés peut aussi être interprétée comme le signe d’une disparition progressive des techniciens chargés du contrôle des compteurs, considérés comme le dernier lien des agriculteurs sur le terrain avec le gestionnaire.
Fiabilité et Incertitude dans les données
La qualité des données climatiques, et notamment des prévisions, a bien progressé dans le temps, notamment celle des données générées dans le cadre du réseau Radar de Météo France (avec une calibration toujours plus fine grâce aux pluviomètres du sol). Les modèles météorologiques utilisent toujours plus de données d’entrées pour améliorer les prévisions et le traffic aérien a sensiblement participé à l’amélioration des modèles là où il n’y avait pas de stations ni de radar (en embarquant directement les capteurs sur l’avion).
Avec un nombre d’outils numériques en augmentation sur les sujets de l’eau, l’exigence des clients augmente elle aussi, et l’ont peut avoir l’impression que les choses n’avancent pas assez vite. La plus grande limite reste certainement le coût d’amélioration de la précision (coût du matériel de calibration sur le terrain, maintenance du matériel et traitement de la donnée). La masse de données traitées grandit et favorise une amélioration de la qualité des prévisions mais nous sommes actuellement dans un contexte particulier. La crise du Covid-19 a eu un impact non négligeable sur la qualité de la prévision climatique avec l’arrêt du traffic aérien. Les acteurs de la donnée météo n’avaient jamais anticipé que l’on pourrait perdre cette source d’information. En quelques mois, les structures impliquées dans les prévisions météo ont régressé de plusieurs années sur leurs capacités à faire des prédictions. Nous avons alors continué à nous rendre compte de notre fragilité sur la météo, avec une mauvaise maitrise de nombreux phénomènes climatiques (El Nino, La Nina).
De manière globale, les avancées scientifiques portant sur la projection de l’évolution du climat, des précipitations et les conséquences sur l’hydrologie sont notables et continues. Il reste toutefois à améliorer la précision des scénarios à l’échelle régionale (descente d’échelle) pour permettre aux acteurs de l’eau et de l’agriculture de conduire des réflexions prospectives au niveau de leurs territoires
Les modèles sont capables de réaliser plusieurs niveaux de prévisions.
- Les prévisions à 3 jours
- Au-delà de 3 jours, on pourrait plutôt parler de tendance que de prévision réelle. Ce qui nous intéresse sont les tendances lorsque l’on se trouve en phénomène d’instabilité (pluie et eau) et ça n’est pas simple
- Les prévisions saisonnières pour évaluer les tendances de température et précipitations à à 3 mois.
Au-delà d’une certaine échéance, la prévisibilité n’est plus assez bonne et il faut passer par des approches probabilistes – les méthodes déterministes n’étant plus assez fiables. Meteo France propose par exemple plusieurs modèles météorologiques possibles en ce sens : AromeEPS, Arpege EPS, IFS EPS.
Les incertitudes des données climatiques peuvent être présentées de plein de façons différentes : cartes de quantile, cartes de probabilité brute (qui informent sur le dépassement d’un seuil et permettent de cibler l’emprise spatiale d’un phénomène mais sans apporter d’information sur la dispersion, le timing et l’intensité maximale du phénomène), rose des vents probabilistes, carte des normales et records. Il reste encore un gap réel dans notre compréhension des incertitudes et des probabilités qui sont pourtant au cœur de la donnée agro-climatique. Même des probabilités faibles sont informatives. Indirectement, on pourrait dire que les agriculteurs raisonnent les incertitudes parce qu’ils ne vont rarement regarder qu’une seule source météorologique, même si on peut retrouver en réalité un peu les mêmes modèles sous-jascents sur les sites web et applications mobiles suivis.
Les outils numériques utilisés en agriculture (notamment les outils d’aide à la décision) sont sensibles à la qualité des données d’entrée des modèles (bilan hydrique sur le sujet de l’eau et tout autre modèle de prévision maladies par exemple). Il y a parfois autant d’incertitude dans la donnée que dans la modélisation (et il n’est pas possible d’instrumenter la totalité d’un bassin versant par exemple). Toutes les estimations sont valables dans un certain type de calibration, et valables ou non dans un espace – ce qui fait que les données ne sont pas toujours extrapolables telles quelles. Le positionnement de stations météo peut ainsi poser question lorsque les données de ces capteurs sont utilisés dans des modèles climatiques, souvent étalonnés sur les normes météo France. Les données de stations météorologiques peuvent être par exemple contrôlées à plusieurs niveaux : station individuelle (vérification des règles de fonctionnement des capteurs, gradients temporels, hypothèses météorologiques simples et contrôle de fourchettes de valeurs, interpolation des données manquantes), réseau d’observations (règles de contrôle et étude de cohérence entre plusieurs stations du réseau, utilisation de données externe au réseau en utilisant par exemple les données et outils de Météo France).
L’utilisation de capteurs ponctuels, fixes ou mobiles, pose toujours la question de la représentativité et de l’exhaustivité des données collectées. Sur des capteurs plante ou sol par exemple, les quelques sites de mesure conseillés sont en général assez limitants. Une campagne d’échantillonnage en amont permettra certes d’optimiser la localisation de ces échantillons mais la couverture n’aura rien à voir avec celle d’une donnée d’un radar de pluie.
Et cette incertitude est nécessairement propagée jusque dans les modèles de prévision utilisées et dans l’interprétation qui doit être faite des résultats de modélisation. L’utilisation des modèles (et donc des OAD) doit parfois être revue à la lumière des étalonnages qui peuvent parfois être sensiblement différents. Des systèmes d’assimilation de données d’observation en temps réel peuvent aussi être utilisés pour améliorer les sorties locales des modèles de prévision. Contrairement aux modèles maladies, les modèles de bilan hydrique sont souvent travaillés avec des cumuls de pluie ce qui les rend plus résilients (dans le cas d’une maladie, la situation climatique d’une journée peut totalement influencer le développement de la maladie). Avec des cumuls de pluie, si l’on se trompe potentiellement sur une estimation à un jour donné, le résultat pourra ne pas être trop affecté si la campagne d’acquisition de données est suffisamment longue.
Le sujet de la connectivité des capteurs reste aussi à regarder de près. Dans le cas des compteurs connectés, il est par exemple problématique d’avoir des données qui n’arrivent pas à transiter sur le réseau. Certains capteurs basse consommation ne s’assurent par exemple pas que les données ont bien été envoyées et il est alors possible de perdre de longues chroniques de données – sans être capable derrière de pouvoir interpoler les données manquantes. Vous imaginez bien que c’est particulièrement gênant si ces coupures arrivent au moment de gros prélèvements d’eau. La pluie peut être aussi à l’origine d’une atténuation de signal et des rideaux d’eau peuvent clairement couper les communications (je vous renvoie vers un précédent dossier sur les standards de communication des objets connectés).
Restons d’accord que le numérique n’est pas non plus la réponse à tous les maux de la gestion de l’eau. Ca n’est pas parce que la technologie est connectée (dans le cas d’un compteur de télérelève connecté) qu’un réseau collectif va être mieux géré, que les prises de décision d’irrigants vont être bonnes et qu’un usage de l’eau sera pensé de manière intelligente à l’échelle d’un bassin versant. Il ne faut pas oublier que l’eau est lourde à transporter, et qu’elle entraine de grosses contraintes de pression. Le fonctionnement de la vie physique dans un réseau d’eau est un réel enjeu. Le numérique et l’automatisation ont certes du potentiel mais il faut avant tout que le système s’ouvre, se ferme, ou encore que l’on détecte les fuites etc… Les automates ou systèmes télécommandés doivent être capables de fonctionner quand même manuellement au besoin.
L’étude du statut hydrique est particulièrement compliqué. Le fait que de nombreux outils aient une approche mono-indicateur ne doit pas être le signe que le problème a été résolu. Le pilotage des cultures pérennes comme la vigne avec des sondes de sol tensiométriques est par exemple un peu questionnable. Piloter la vigne pendant la période de végétation en véraison à l’aide d’une sonde n’a peut-être que peu d’intérêt alors que le suivi de la minéralisation du sol en hiver par ces mêmes sondes est peut-être beaucoup plus pertinent. L’intérêt du numérique reste d’avoir le choix avec des capteurs et des données très différentes.
Il reste nécessaire de se questionner sur le niveau de précision attendu avant de vouloir toujours plus creuser les hypothèses des modèles utilisés. Au vu de la propagation d’incertitude tout au long de la chaine – entre l’acquisition de données, le nettoyage des données, l’intégration dans un modèle qui a lui aussi des incertitudes … – on peut effectivement se demander à quel point la précision de la donnée d’entrée impacte la précision de la donnée de sortie et si la décision qui sera prise à la fin serait susceptible d’évoluer ? Par exemple, quel est le niveau de précision nécessaire à l’évaluation de la pression hydrologique compte tenu des incertitudes de la modélisation hydrologique utilisé ?
Se préparer au manque d’eau à venir
Le coût de l’eau en agriculture
La notion de sobriété est particulièrement complexe à cerner et conduit à des débats difficiles à trancher : jusqu’où est-il acceptable de faire pression sur la ressource ? Quand la côte d’alerte est-elle dépassée ? Cette difficulté est d’autant plus grande que les référentiels sont mouvants, le changement climatique déplaçant le curseur en permanence. Par ailleurs, la sobriété n’a pas la même valeur à tout moment ou en tout point du territoire. Lorsque l’eau est surabondante l’hiver, que les nappes se remplissent voire évacuent leur trop-plein vers les exutoires naturels que sont les sources et les cours d’eau, quel sens y-a-t-il à parler de sobriété ? Économiser l’eau constitue donc un impératif d’autant plus consensuel que ses contours sont flous.
Le secteur agricole, consommateur important d’eau en période estivale, paye une redevance pour le prélèvement de la ressource en eau (hors irrigation gravitaire) fixée par mètre cube à un niveau inférieur à celle imposée aux services d’alimentation en eau potable. L’agriculteur paye moins d’1 centimes le m3 d’eau (c’est un peu plus cher en système collectif). Le tarif tel qu’il est n’est pas encore un driver principal pour faire des économies d’eau. Il n’y a pas réellement de signal prix sur l’eau. Le seul signal qui intervient potentiellement est celui de l’énergie (parce que la gestion de l’eau demande de l’énergie pour par exemple pomper l’eau).
Malgré tout, la facture globale par exploitant n’est pas négligeable puisque l’irrigation peut coûter plusieurs centaines d’euros à l’hectare (énergie, main d’oeuvre et matériel compris), soit davantage que le montant moyen des aides à l’hectare du premier pilier de la PAC (Figure 35). Les agriculteurs considèrent sans grande surprise que l’eau est chère pour eux. La hausse du prix de l’eau pourrait rendre certaines productions déficitaires et conduire à les abandonner.
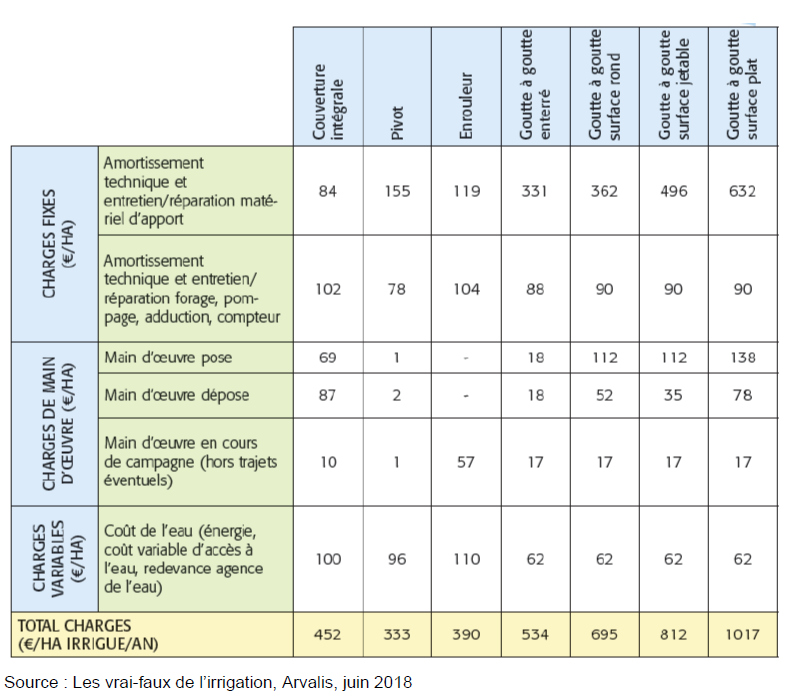
Figure 35. Les vrai-faut de l’irrigation. Source : Arvalis, 2018
Ce n’est au final pas tant le prix mais bien la rareté ou le risque de manquer qui fait que la gestion de l’eau peut être transformée. Un signal basé sur l’allocation d’eau (par exemple avec un score de performance d’irrigation pour distinguer les bons et moins bons irrigants et donner un meilleur accès aux ressources aux premiers) est pertinent mais il faut faire attention aux contextes pédo-climatiques en place. Entre un agriculteur qui a des terres sableuses ou limoneuses, le besoin en eau ne sera pas le même. On pourrait très bien imaginer alors un stress test sous la forme d’une intégration de l’eau dans le bilan économique d’une entreprise agricole. L’intention serait de répondre objectivement à la question suivante : sans eau, quel serait le chiffre d’affaire global de l’exploitation agricole ?
Sans irrigation, certains marchés et contrats n’existeraient plus. Par exemple, pour les haricots, sans irrigation, il y a un risque de faire des fils et de dégrader la qualité du produit. Pour les tomates, on peut s’attendre à ce que les calibres ne soient plus homogènes sans irrigation. Certaines cultures sont complètement tributaires du volume d’irrigation disponible en période estivale. L’eau peut aussi être un facteur d’augmentation du rendement par rapport à la même culture en pluvial. Ainsi, la valeur de l’eau pour l’irriguant peut-être approchée par le différentiel de valeur entre une culture irriguée et une autre non irriguée rapporté au volume d’eau d’irrigation nécessaire (éventuellement pondéré par un facteur de risque de sécheresse). Il n’existerait pas en France d’étude générale et détaillée sur la valeur de l’eau pour les différentes cultures et les différents systèmes de production. Ces informations pourraient pourtant s’avérer utile pour définir des arbitrages et règles d’allocation d’eau.
Il apparaît que les valeurs d’économies d’eau réalisées présentent une grande variabilité. Pour une même culture, cette variabilité s’observe entre les différents essais, en raison des caractéristiques du sol et du climat (Serra Wittling and Molle, 2017). Au sein d’un même essai, les résultats ne sont pas systématiquement reproductibles d’une année sur l’autre. Les économies d’eau les plus fortes sont souvent observées en année humide, alors qu’elles sont moins conséquentes en année sèche. De même, elles tendent à être plus importantes dans les sols à faible réserve utile.
Le levier volontaire le plus répandu est celui de la MAEC (Mesure agroenvironnementale et climatique), une subvention de la Politique Agricole Commune (PAC) dont la portée est cependant limitée car elle est basée sur une obligation de moyens et non de résultats. On trouve également le système des paiements pour services environnementaux (PSE), avec des partenaires privés ou publics qui rémunèrent les actions des agriculteurs en vue d’améliorer la qualité de l’eau.
Les irrigants peuvent prétendre à des aides financières européennes, sur fonds FEADER, pour leurs investissements d’hydraulique agricole, à condition que le nouveau système d’irrigation soit susceptible de permettre une économie d’eau de 5 à 25%, sans diminution du rendement des cultures. Ces aides sont conditionnées à la technique d’irrigation, comprenez donc ici que c’est une aide à l’acquisition de matériel (efficience en termes d’économie d’eau).
Malgré la recherche d’une valorisation maximale des cultures irriguées, les systèmes de renforcement de la ressource en eau ne peuvent souvent pas simplement être financés par les seuls irrigants. Les coûts chiffrent assez rapidement (CGEDD, CGAAER ; 2020) :
- Le coût d’investissement d’une retenue de substitution (en « bassine », avec géomembrane), avec réseau de remplissage et de desserte, est plus important : environ 6 à 8 €/m3 stocké. Dès lors qu’un stockage d’eau est envisagé (tous types de retenues et barrages), il faut alors rajouter le coût d’acquisition du foncier d’assiette du stockage d’eau. Malgré l’économie d’échelle observée avec de grands projets, on assiste de plus en plus à la réalisation de petits ouvrages qui posent des difficultés de montage financier, d’identification de maîtres d’ouvrage motivés et d’acceptation sociale (ex de Saintes Solines) dont les conséquences environnementales sont assez mal cernées.
- Les coûts d’exploitation varient en fonction du type de renforcement (par exemple, frais d’énergie plus élevés pour un transfert de bassin que pour une retenue), du contexte topographique (hauteur d’élévation pour la pompe). Ils regroupent d’une part les coûts de fonctionnement (énergie, entretien de la végétation, frais de gestion…) et d’autre part les coûts de petite maintenance curative ou préventive (remplacements de pompes, petites réparations, etc.).
- Coûts de maintenance lourde : Ces coûts varient eux aussi en fonction du type de renforcement de la ressource. Ils correspondent au renouvellement des ouvrages en fin de vie et découlent donc des différentes durées de vie qui diffèrent fortement pour les divers éléments de l’ouvrage (et aussi en fonction des porteurs de projets).
Et rajoutons que certains porteurs de projets s’assurent maintenant contre les manifestations d’associations écologiques.
Les coûts, à la fois financiers (coûts d’exploitation et d’entretien, coût de capital, coûts administratifs) et environnementaux (dommages environnementaux causés par le captage, le stockage et l’endiguement, les coûts d’opportunité liés à d’autres utilisations de l’eau puisque les utilisateurs actuels et futurs pâtiront d’un épuisement des ressources en eau), devraient être provisionnés et inclus dans toute analyse économique sur le sujet
Les Agences de l’eau ne peuvent d’ailleurs pas subventionner de projets de stockages d’eau supplémentaires qui ne viseraient pas, d’abord, à effectuer des économies durant la période d’étiage. Seule la partie de l’ouvrage correspondant au volume de substitution est éligible au soutien des Agences de l’eau jusqu’à 70 % du coût du projet (les méga-bassines, appelées aussi réserves de substitution, peuvent ainsi être subventionnées à hauteur de 70% par les Agences de l’eau). Les taux maxima d’aide fluctuent selon l’époque et les sources de 40 à 80 %. Cette aide publique à l’investissement, et en particulier son taux, est importante car :
- le coût global pour le maître d’ouvrage et donc les irrigants est constitué d’autres postes comme l’amortissement et le fonctionnement qui ne bénéficient, eux, d’aucune aide
- la rentabilité d’équipements à but non économique est par nature négative.
- la prise en compte des coûts des équipements collectifs dans la tarification de l’eau, et donc les stratégies de financement choisies, ont un impact potentiel très important via le coût de l’eau sur la marge nette des cultures irriguées. La tarification peut donc être un facteur très important de rééquilibrage pour assurer l’équité entre les irrigants
La pérennité de l’équilibre économique de grands systèmes collectifs existants peut être mise en question par un recul de l’irrigation dans certains secteurs. Le développement de l’irrigation de résilience par exemple (une forme de sécurisation de l’eau que nous avons vue plus haut) pour une part des cultures, nécessiterait un programme public spécifique d’accompagnement financier. L’équilibre économique d’un tel mode d’irrigation à partir d’une retenue de substitution nécessiterait ainsi que les coûts fixes collectifs soient assis sur la base d’une mobilisation de l’ensemble du volume stocké (si l’irrigation de résilience apporte 4 fois moins d’eau que l’irrigation de production, une tarification ne peut être acceptée que s’il y a 4 fois plus d’irrigants), et que les coûts individuels (amortissements du coût de la canalisation entre la borne collective et la parcelle et amortissement du matériel d’irrigation de type asperseur ou goutte-à-goutte) soient largement subventionnés.
L’étude économique mandatée par l’Union des Industries de l’Eau (UIE) chiffre à 4,6 milliards d’euros les besoins annuels supplémentaires pour moderniser et décarboner les infrastructures de l’eau, d’assainissement et du pluvial. Les financements, en baisse constante depuis 40 ans, montrent un déficit d’investissement chronique qui impose de remettre l’eau au plus haut niveau de priorité et d’assurer la résilience de nos services et de nos infrastructures d’eau.
De manière générale, la mise en place d’aides ou de prêts publics sera indispensable pour, d’une part, généraliser l’irrigation sous pilotage technique et le déploiement d’outils d’efficience de l’irrigation et, d’autre part, couvrir sur plusieurs années la prise de risque liée à l’introduction de cultures et de pratiques plus économes en eau
En ce qui concerne l’eau utilisée pour l’irrigation, il est essentiel que les structures tarifaires incitent davantage à l’utilisation rationnelle des ressources et permettent une plus grande transparence par rapport aux utilisations concurrentes, afin d’éviter les subventions croisées de la part d’autres secteurs de la société. La suppression des subventions négatives devrait également être une priorité de la future politique agricole.
Une adaptation nécessaire
Nous allons devoir gérer des situations de crise. Et le problème, ça n’est pas quand tout va bien, mais quand justement, ça ne va pas… En niveau de crise (le plus critique), tous les usages font potentiellement l’objet de restrictions.
Comprendre la notion d’adaptation est fondamental parce que nous allons au-devant de catastrophes et nous devons nous y préparer. La sensibilité des territoires au déréglement climatique est extrêmement variée au regard des questions de quantité et de qualité des ressources hydriques, et des risques liés aux évènements extrêmes de plus en plus marqués. C’est donc au plus près du terrain, au cœur de cette diversité de territoires et de filières que les stratégies d’adaptation devront être pensées. La contraposée de l’adaptation, la mal-adaptation, se cache dans les détails. Si une action d’adaptation aggrave le problème qu’elle est censée résoudre, c’est en réalité une action de mal-adaptation.
La notion d’adaptation est ici au cœur du débat et les formes d’adaptation sont multiples, de la plus simple à la plus évoluée :
- L’adaptation « incrémentielle » consiste en des mesures d’adaptation à la marge face à un changement d’ampleur limitée. L’organisation de l’activité n’est pas fondamentalement modifiée. Le recours à l’irrigation fait bien évidemment partie des solutions d’adaptation parce que dans certains cas, l’irrigation sera une solution incontournable, mais elle restera durablement minoritaire en surface au regard de l’agriculture pluviale dominante. Son évolution vers une irrigation « de résilience » jouant un rôle de sécurisation est indispensable pour en optimiser l’usage et permettre de mieux partager la ressource disponible
- L’adaptation « systémique », devant un changement plus profond, acte l’impossibilité d’y faire face par des mesures d’adaptation à la marge. L’organisation de l’activité est transformée en profondeur.
- L’adaptation « transformante » implique le changement des éléments fondamentaux du système en réponse au climat et à ses effets, avec notamment de nouvelles productions et relocalisations. On trouve ici des transformations profondes de filières et des modèles de société
L’adaptation est un processus caractérisé par l’incertitude. Il est difficile de prédire quand l’adaptation sera nécessaire et quel niveau d’adaptation sera nécessaire. Les comités sécheresse ont par exemple un caractère exceptionnel dans le sens où ils n’interagissent que lorsqu’il y a une crise. Il est pourtant nécessaire de s’adapter à des situations qui pourraient arriver. Attention donc à toutes dérives d’analyse de court terme du bénéfice lié au retour d’expérience de la mise en oeuvre d’une pratique d’adaptation. L’adaptation demeure un processus itératif qui nécessite d’être régulièrement interrogé au fil du temps. Nous devons engager les agriculteurs dans une démarche de long terme qui accompagnera la vie économique des exploitations agricoles.
Le plan eau dévoilé par le gouvernement vise une réduction des prélèvements de 10% d’ici à 2030. Il faut bien comprendre néanmoins que s’adapter à 10% de prélèvements en moins en moyenne ne garantit pas du tout que, dans le cadre de cette moyenne, nous serons adaptés à une baisse de 25% de ces prélèvements à laquelle nous pourrions être obligés sur une année critique.
Le GIEC a proposé de nombreuses options d’adaptation liés aux risques liés à l’eau et à la sécurité alimentaire (dont l’eau est une entrée cruciale). Attention néanmoins au fait que l’efficacité des options d’adaptation est principalement mentionnée de manière qualitative mais n’est pas évaluée, et l’efficacité des combinaisons de mesures est rarement évaluée (Figure 35).
Quelques exemples :
- Les adaptations de précocité des variétés réduisent les pertes de rendement en déplaçant le cycle vers une période plus fraîche de l’année et limitent également l’augmentation des besoins en eau d’irrigation, mais réduisent la période de photosynthèse et de remplissage des grains. Le choix d’espèce et les déplacements de calendrier seront de toute façon insuffisants à eux seuls pour atténuer totalement les pertes prévues suite à une réchauffement de plus de 3 degrés par rapport à l’époque pré-industrielle.
- Les technologies numériques sont aussi une voie d’adaptation possible tant que la croyance au techno-solutionnisme ne réduit pas l’espace de solutions et le calendrier des options d’adaptation. Il sera nécessaire de se demander comment les outils numériques peuvent permettre de passer les situations de crise et d’évaluer leur potentiel en terme d’adaptation
- L’évaluation des besoins en irrigation et de l’impact du CO2 et de l’O3 (ozone) tend à se concentrer sur des espèces mono-spécifiques, ce qui complique l’extrapolation de certains résultats à des facteurs de stress multiples et à des productions mixtes et diversifiées.
- Côté élevage, on pourrait imaginer un mode d’élevage transhumant ou d’élevage de service caractérisé par une organisation du travail revisitée où l’éleveur aurait une base foncière réduite grâce aux ressources fourragères des exploitations voisines.
- Le passage, pour une part plus ou moins importante – selon les filières ou les territoires – de l’exploitation, a une irrigation de sécurisation modifie profondément l’utilisation et donc la rentabilité des investissements correspondants. Pour être le plus flexible possible, le matériel des exploitations devra être en tout ou partie mobile ou en tout cas plus agile pour s’adapter a des configurations d’irrigation variables selon les parcelles et les années, allant de l’irrigation sous pilotage technique a celle d’appoint. Cela suppose une amélioration des matériels mobiles d’irrigation, aujourd’hui globalement moins performants que les matériels fixes, et l’acquisition de nouveaux matériels mobiles pour les irrigants ne disposant à ce jour que d’infrastructures fixes. Pour les réseaux collectifs de distribution de l’eau d’irrigation, le développement de l’irrigation de résilience conduit à ré-examiner leur rentabilité économique au regard de quantités d’eau plus faibles apportées à l’hectare et pas systématiquement chaque année.
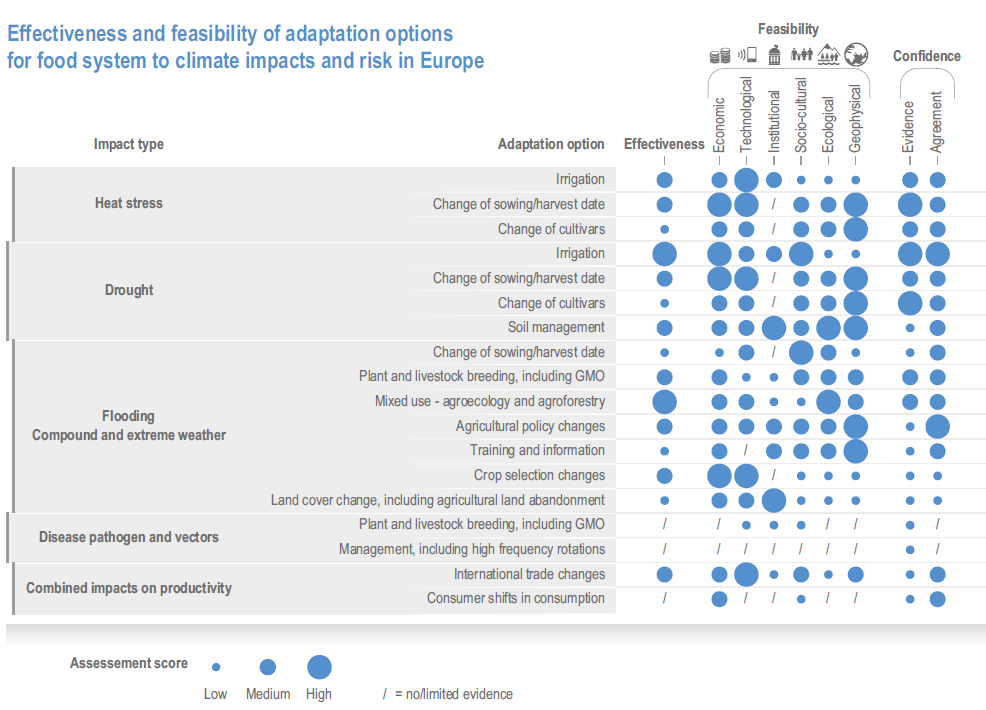
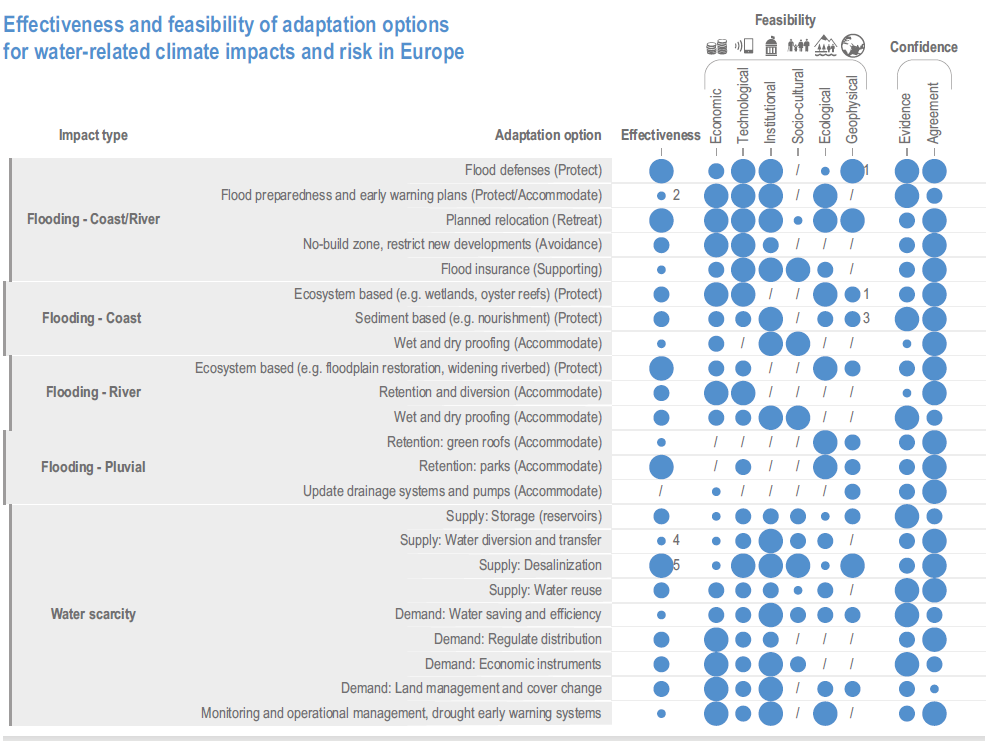
Figure 35. Faisabilité et Efficacité des options d’adaptation pour les risques et impacts liés à l’eau et au système alimentaire. Source : GIEC, 2022.
La planification de l’adaptation peut à la doit être basée sur l’offre, mais aussi sur la demande (Figure 36) :
- Offre : recherche d’augmentation de la disponibilité et de l’approvisionnement en eau douce par le stockage de l’eau, la diversification des sources et le détournement et le transfert de l’eau.
- Demande : la surveillance (par exemple, compteurs d’eau, systèmes d’alerte précoce en cas de sécheresse) et la régulation de la demande (par exemple, les restrictions d’eau, la tarification de l’eau, les économies d’eau et les mesures d’efficacité…).
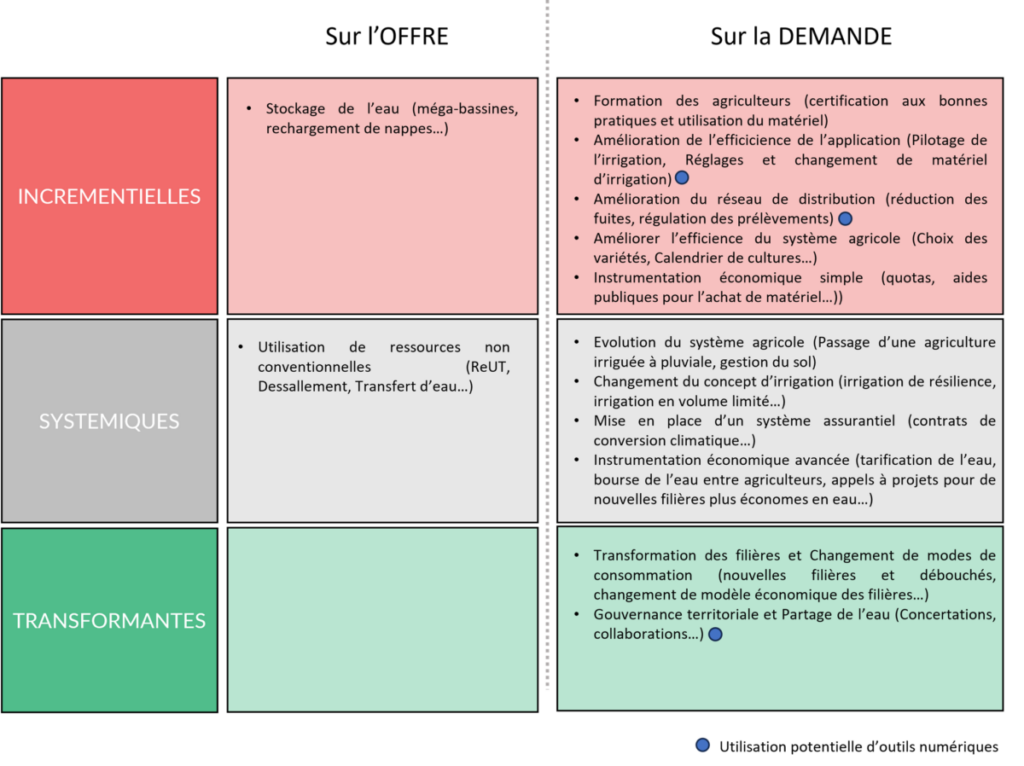
Figure 36. Synthèse d’options d’adaptation basées sur l’offre et la demande (avec une présence des technologies numériques en particularité sur certaines options). Source : l’auteur
L’adaptation progresse mais elle demeure insuffisante face à la rapidité des changements. Le GIEC rappelle qu’un ensemble de mesures cohérentes, comprenant des mesures de sobriété, peut réduire les risques et confirme que le développement de réserves et de transferts interbassins créent des inégalités d’accès et perpétuent des pratiques de mal-adaptation (Figure 37). Avec un réchauffement autour de 2°C, des mesures transformationnelles deviennent nécessaires. Autour de 3°C, même un très grand nombre de mesures d’adaptation cohérentes ne peuvent garantir d’éviter des pénuries d’eau.
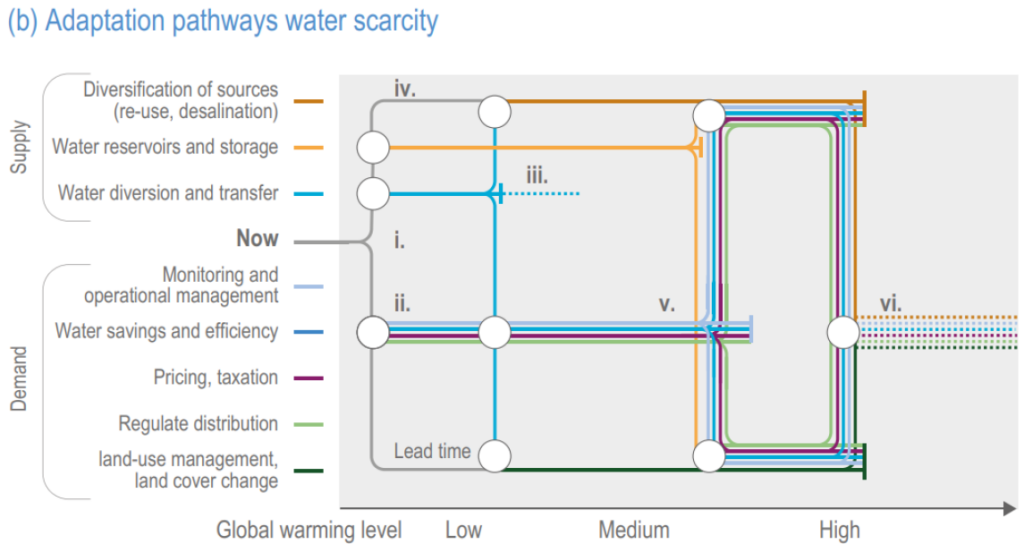
Figure 37 : Accessibilité des mesures d’adaptation sur la gestion de l’eau face à un climat en hausse. Source : GIEC, 2022. Note : (i) Actuellement, il existe déjà un écart croissant entre la demande en eau et la disponibilité de l’eau dans certaines parties de l’Europe, (ii) Un ensemble de mesures axées sur la demande peut réduire le risque à un niveau de réchauffement global moyen, (iii) les réservoirs d’eau et les transferts peuvent avoir des impacts distributifs et, lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation, ils intensifient la dépendance à l’égard de l’eau, (iv) Le dessalement est efficace et peut être développé, mais il a des effets négatifs sur l’environnement et la demande en énergie. La réutilisation de l’eau est efficace, mais dépend de la disponibilité de l’eau et le délai de mise en place des infrastructures est long, (v) avec un réchauffement global moyen, des mesures axées sur la demande doivet être combinées avec des mesures transformantes comme les changements dans l’utilisation des terres, (vi) en cas de réchauffement climatique élevé, une large combinaison de mesures est nécessaire pour réduire suffisamment le risque de pénurie d’eau et il ne sera peut-être pas possible d’éviter une pénurie d’eau.
L’adaptation doit également se raisonner d’un point de vue stratégique par rapport à ce que nous voulons voir advenir dans le futur. Un premier enjeu a trait à la viabilité et au maintien des filières, dont certaines doivent être considérées comme stratégiques pour notre pays (plan protéines par exemple) ou essentielles en termes d’autonomie alimentaire. Certaines productions dont l’irrigation est impérative pour la qualité et la régularité d’approvisionnement des usines agro-alimentaires qui leur sont liées, risquent par exemple de se délocaliser.
Gardons en tête que le problème reste global. Si nous diminuons la quantité d’eau utilisée chez nous mais que nous l’importons virtuellement (ce que nous faisons actuellement au vu de la dégradation de notre balance commerciale), surtout lorsque cette eau provient de plus pauvres en ressources en eau que la France et plus vulnérables au changement climatique, nous prenons le risque de les faire tomber en premier (ce qui est déjà un problème en soi) et de nous faire tomber ensuite puisque leurs cultures d’exportation ne seront plus garantis à long terme. La société nationale de distribution d’eau tunisienne, la Sonede, a par exemple commencé à couper l’approvisionnement en eau tous les soirs entre 21 heures et 4 heures du matin, pendant les périodes de sécheresse violentes qu’a connues la Tunisie.
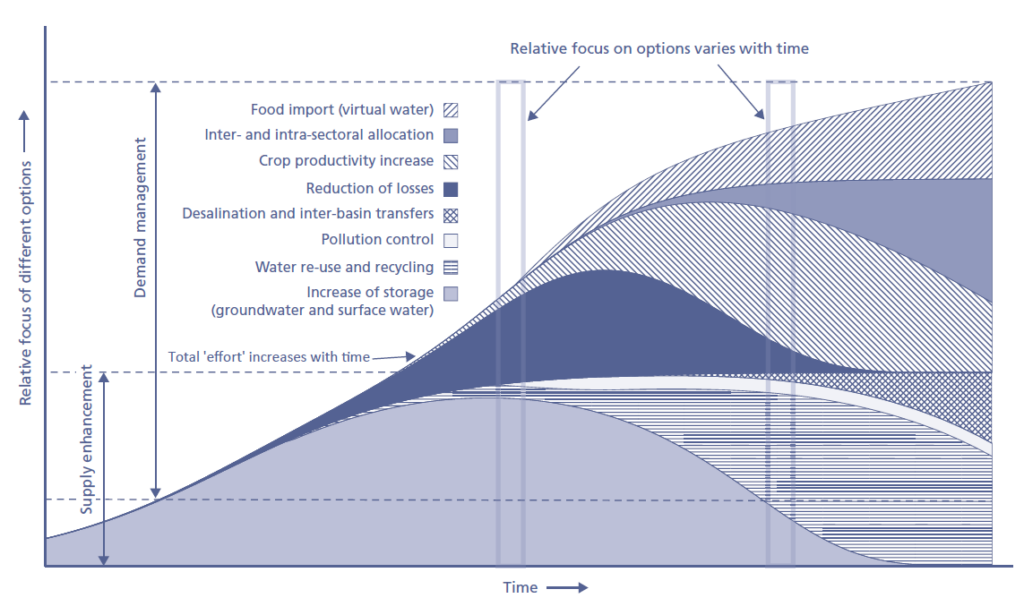
Figure 38. importance relative accordée aux différentes options pour le secteur agricole afin de faire face à des niveaux croissants de pénurie d’eau au fil du temps. Source : FAO (2012). Coping with water scarcity
Le coût de l’adaptation
En 2022, le CGAAER soulignait la difficulté à évaluer de manière exhaustive les coûts à la fois liés aux impacts et à l’adaptation du secteur agricole, au regard des déterminants multiformes du système de production et du lien étroit des couples filière-territoire. L’évaluation agrégée à l’échelle nationale (qui ne donne pas d’informations à des échelles spatiales plus fines) de l’adaptation du secteur agricole table à 3 milliards d’euros par an avec :
- un milliard d’euros par an pour les aléas climatiques, sous l’hypothèse d’un doublement à l’horizon 2050 des aléas actuels
- un milliard d’euros par an pour les coûts de l’adaptation liés à l’accroissement de l’usage de l’irrigation à un milliard d’euros par an (investissement dans les nouveaux dispositifs de stockage et dans le matériel d’irrigation sur les exploitations, sous l’hypothèse d’un doublement des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation).
- 150 millions d’euros pour une massification du conseil agricole
- 600 millions d’euros pour le renouvellement des vergers français inadaptés au déréglement climatique à venir
On peut rappeler également que dans certaines régions françaises, suite au retrait de filières en difficulté, des parcelles bénéficiant d’infrastructures d’irrigation ont été massivement urbanisées, ce qui in fine a conduit à perdre des investissements publics réalisés pour l’irrigation des terres, sans que des compensations aient été mises en place
Ce coût de l’adaptation devrait être mis au regard du coût de non-adaptation qui continue à augmenter exponentiellement tant qu’aucune action n’est réalisée. Le coût de l’inaction est généralement très supérieur à celui de l’action.
Vous trouverez ci-dessous une liste d’études à mettre en place pour analyser la vulnérabilité agro-climatique d’une exploitation agricole et son adaptation au changement climatique
Analyse de la vulnérabilité agro-climatique:
- Description de l’assolement avec classement des cultures de l’exploitation par ordre décroissant de superficie.
- Rappel des principaux aléas climatiques et de leurs impacts agricoles sur les dix dernières années (cultures, surfaces, niveau de pertes de rendement subis)
- Description des caractéristiques agro-environnementales de l’exploitation : types de sols réserve utile, sensibilité à l’érosion, pratiques d’implantation des cultures, rotation et diversité culturale …
- Analyse des cultures actuelles de l’exploitation : surface consacrée, diversité génétique, rendement (minimum, maximum et potentiel de variation) et principaux facteurs climatiques diminuant le rendement.
- Mise en avant d’une sélection d’indicateurs agro-climatiques sélectionnés en fonction des principales cultures de l’exploitation agricole : évolution comparée entre le passé récent et le futur proche.
- Matrice de vulnérabilité de l’exploitation tenant compte, pour chaque culture, de la fréquence des aléas et du niveau d’impact associé, permettant d’attribuer un score de vulnérabilité actuelle. La note de vulnérabilité est ensuite extrapolée pour le futur proche en projetant le système agricole à l’identique dans un climat changeant.
- Etude de l’évolution de l’état organique des sols agricoles selon les pratiques culturales actuelles et projetées
Adaptation au changement climatique :
- Synthèse des principales forces et faiblesses climatiques du système agricole, mais également des opportunités et menaces climatiques à anticiper pour le Futur Proche
- Mise en place d’un plan d’adaptation : composantes de vulnérabilité et classement de mesures ESR (Efficicience, Substitution, Reconception)
- Evaluation d’un plan d’adaptation avec une progressivité de dépendance à l’irrigation.
Peut-on assurer un monde qui s’effondre ?
Faut-il dans tous les cas considérer l’irrigation comme une option économique parmi d’autres (devant être déterminée et prise en charge par le secteur agricole) ou peut-elle, dans certaines configurations, correspondre à une nécessité assurantielle face à une contrainte climatique s’imposant aux agriculteurs (légitimant une intervention de la collectivité) ? Le GIEC rappelle par exemple le risque de perte de revenus ruraux suite à un accès insuffisant à l’eau d’irrigation et à la diminution de la productivité agricole ou encore de rupture des systèmes alimentaires suite à la variabilité des pluies ou encore aux sécheresses.
L’irrigation est bien à la fois un outil de résilience et de gestion des risques. Sur certaines productions, l’irrigation est à la fois une assurance rendement, une garantie de qualité mais aussi une assurance anti-impact. Si l’on veut par exemple qu’un blé dur soit classé comme un blé de semoulerie, il faut qu’il ait un taux de protéine minimum et que l’alimentation azotée en fin de cycle soit suffisante. Dans un contexte de printemps sec, le dernier apport d’azote ne sera pas valorisé correctement et l’on imagine ainsi qu’un passage d’irrigation assurerait que l’azote soit bien assimilé.
Un nexus eau-énergie
Risque-t-on de manquer d’énergie avant de manquer d’eau ? La question peut paraitre malaisante voire provocante mais elle est dans tous les cas légitime.
Nous sommes abreuvés d’énergie. L’énergie est tellement infusée dans nos sociétés que nous ne nous rendons même plus compte à quel point elle est omniprésente. Et dans le contexte de la gestion de l’eau, notamment en agriculture, c’est particulièrement préoccupant. Prenons par exemple le cas d’un enrouleur pour lequel plus de 80% de la puissance électrique est utilisée pour amener de l’eau (50% à la sortie de la pompe et 30% en entrée d’enrouleur), le reste étant dédié à l’action d’irrigation. On estime par exemple qu’un maisiculteur dépense entre 400 et 600€/ha (amortissement compris) pour l’irrigation – une grosse partie du coût étant lié à l’énergie. Les explosions du coût de l’énergie suite à la guerre en Ukraine ont certainement dû changer la donne.
Les leviers d’économie d’énergie sont assez importants. Sur la distribution de l’eau, la modernisation des réseaux de distribution d’eau permettrait déjà de réaliser des économies. Les réseaux d’irrigation (tuyaux et autres aménagements) sont d’ailleurs ce qui pèse le plus dans les analyses du cycle de vie et ces impacts peuvent poser question quant à la comparaison de scénarios de base avec retenue collinaire et/ou pompage dans la mer au regard d’un scénario plus sobre mais avec tout un réseau à mettre en place. Côté matériel, les différences de consommation énergétiques des matériels sont importantes, simplement par exemple entre un enrouleur et un pivot. Le robot d’irrigation Oscar (de la société Osiris) diminuerait visiblement l’énergie de pompage – le robot étant alimenté en énergie par de l’eau sous pression.
On peut s’attendre à ce que les matériels cherchent maintenant à travailler à basse pression pour limiter les coûts énergétiques. Certains constructeurs fournissent des goutteurs pour travailler à 0.5 bar de pression nominale. Sur les pivots, on peut faire marcher des machines avec 1 bar de pression en tête et des asperseurs à la suite. Sur le pilotage de l’irrigation en temps que tel, on comprend assez facilement que plus la quantité d’eau économisée est importante, plus l’économie d’énergie associée l’est elle aussi puisqu’il faut bien de l’énergie pour apporter l’eau jusqu’à la parcelle (les fuites d’eau sont d’ailleurs plus un problème d’énergie que d’eau en tant que tel puisque l’eau rejoint potentiellement les petits et grands cycles de l’eau). Et si l’on souhaite une eau de meilleure qualité, il faudra rajouter des filtres en tout genre dont la fabrication aura consommé de l’énergie. On pourrait d’ailleurs rajouter que les systèmes d’activation de vanne à distance (électrovanne, pompe…) permettent de réduire l’énergie utilisée pour se déplacer jusqu’à la station de contrôle.
L’eau est aussi une ressource directement utilisée pour la production hydroélectrique, qui représente plus de 12 % de la production électrique totale de la France. Plus de la moitié de la capacité de production est fournie par des installations dites « au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du débit d’un cours d’eau en continu. Elles dépendent alors totalement du débit disponible. Les installations éclusées turbinent une eau stockée pour une courte période dans une dérivation du cours d’eau et dépendent là aussi fortement du débit disponible dans le cours d’eau. Les grandes centrales adossées à des retenues d’eau artificielles fournissent un quart de la production hydroélectrique totale. Ce sont elles qui sont les plus pilotables, même si le niveau de remplissage des retenues contraint les capacités de production. Enfin, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) utilisent l’eau comme un dispositif de stockage électrique.
Un sujet pourra se poser quant au renouvellement des concessions hydro-électriques. Avec la concurrence au niveau des modes de production énergétiques, les projets de renouvellement de concession pourraient être bloqués au niveau européen.
L’eau est également nécessaire pour refroidir les centrales nucléaires. Le code de l’environnement prévoit d’ores et déjà la possibilité de modifier les normes relatives à l’utilisation de l’eau par les centrales nucléaires pour garantir la poursuite du fonctionnement d’une centrale, en situation exceptionnelle, comme une canicule ou une sécheresse. Ces dérogations répondent à un impératif d’intérêt général : continuer à assurer l’approvisionnement en électricité du pays. J’insiste ici sur le fait qu’en France, un déficit d’eau prélevable pour refroidir les centrales n’engage aucun risque de sureté nucléaire (les centrales ne vont pas se mettre à exploser si elles ne peuvent plus prélever d’eau) – le risque étant de ne plus produire d’électricité d’origine nucléaire. Il ne faut en effet pas confondre l’eau du refroidissement du circuit primaire et celle du circuit secondaire. Ces deux circuits n’échangent aucune goutte d’eau entre eux. Le circuit primaire est celui où baignent les crayons d’uranium. L’eau, en circuit fermé, y sert de modérateur et de caloporteur. Et effectivement, si l’eau vient à y manquer, il n’y a plus de modérateur, et la réaction en chaine de fission ne peut physiquement plus se poursuivre. Toutefois, ce circuit primaire n’a rien à voir avec l’eau qu’on pourrait prélever dans le fleuve ou dans la mer.
À moyen terme, on peut s’interroger sur la pérennité des centrales consommant beaucoup d’eau et rejetant une eau plus chaude que celle prélevée, c’est-à-dire des centrales fonctionnant en circuit ouvert – notamment pour celles situées sur le littoral (parce que pour celles situées proches de la mer, on considère que la quantité d’eau permettra de diluer suffisamment ces effets de chaleur). Je rappelle que la part des réacteurs en circuit ouvert et en circuit fermé dans le parc installé en France est quasi-équivalente et que les réacteurs en circuit ouvert sont ceux qui sont les plus gourmands en eau (même s’ils restituent la quasi-totalité de l’eau au milieu). La transformation d’une unité refroidie en circuit ouvert en unité à circuit fermé serait, selon EDF, trop difficile et coûteuse à mettre en place pour être envisagée. En complément de l’étude RTE sur les futurs énergétiques 2050, publiée fin 2021, EDF conduit une étude (encore en cours) dont les conclusions préliminaires laissent à penser que la fréquence de l’indisponibilité climatique de ses centrales nucléaires pourrait être multipliée par 2 ou 3, et resterait donc faible par rapport à la production totale d’énergie (la perte étant aujourd’hui de 0,27 %). La rentabilité des sites n’est donc pas remise en cause à moyen terme. L’Autorité de sureté nucléaire aurait quand même demandé à EDF d’anticiper les sécheresses des prochains étés dans ces centrales.
L’approvisionnement en eau potable est aussi soumis à une infrastructure énergétique importante avec des systèmes de pompage de l’eau des rivières et des nappes phréatiques jusqu’aux réservoirs, de potabilisation de l’eau (par ex., chloration pour éliminer les bactéries), ou encore d’assainissement de l’eau usée. Certains aménagements de renforcement de la ressource en eau que vous avons brièvement décrits en début de dossier sont plus ou moins énergivores (technologies de réutilisation des eaux usées traitées, de dessalement ou de transfert d’eau).
Les coupures électriques à prévoir, notamment dans le cadre des alertes de délestage du réseau électrique français durant l’hiver 2022-2023, posent ainsi question quant à notre capacité à maintenir nos approvisionnements en eau. Certains systèmes, comme la potabilisation et l’assainissement d’eau ne font pas partie des usagers prioritaires et pourraient être arrêtés en cas de coupure
En France, même si le risque de délestage est réel dans les prochaines années, nous avons la chance qu’il reste normalement d’ampleur limitée. Malgré tout, en France, la gestion de l’eau est une compétence que nous avons décentralisée. Chaque territoire n’est donc pas nécessairement logé à la même enseigne et n’est donc pas forcément aussi résilient face à un manque d’énergie. La planification et la préparation restent de mise, d’autant plus que le déréglement climatique fait planer le risque d’épisodes extrêmes toujours plus fréquents. En plus des risques directs sur l’approvisionnement en énergie et sur l’agriculture, les évènements extrêmes peuvent fragiliser les infrastructures, réduisant par là même la capacité du système à répondre aux besoins au moment où il est essentiel.
Avec moins de pétrole, peut-être que la collectivité décidera qu’il y a plus essentiel à faire avec celui qui nous restera que des bouteilles jetables en plastique pour transporter un produit qui arrive tout aussi bien par le tuyau
Les mécanismes d’allocation de l’eau
On peut distinguer plusieurs mécanismes d’allocation de l’eau pour les usagers du territoire (qu’ils soient agriculteurs irrigants ou non)
- L’allocation publique de l’eau, par laquelle l’État décide de la quantité d’eau allouée aux différentes utilisations. C’est le principe des quotas de prélèvements par exemple.
- les marchés de l’eau, c’est-à-dire les échanges de droits d’utilisation de l’eau ;
- la tarification, c’est-à-dire que l’utilisation de l’eau est payante.
Ces trois mécanismes sont décrits dans les sections suivantes.
Le terme « instruments économiques » couvre un large éventail d’outils différents : tarifs, taxes, subventions, permis négociables [quotas]. Il est clair que les instruments économiques ont leurs limites. La mise en place et l’application de ces approches impliquent souvent des coûts de transaction importants. Il est également peu probable que les instruments économiques permettent une allocation optimale des ressources ou une réduction de la pollution s’ils ne sont pas conçus en fonction de ces objectifs.
Quotas
Les quotas sont un outil de gestion de l’eau d’irrigation qui joue sur la demande. Ils répartissent la ressource entre usagers en limitant la quantité prélevable. Ils sont nominatifs, géographiquement localisés, plafonnés et limités dans le temps. Cependant, les systèmes de quotas existent dans des contextes hydrographiques et politiques divers, sous des formes et dénominations hétérogènes.
Les quotas sont souvent mis en avant avec quatre objectifs fréquemment cités :
- l’équité : Les quotas permettraient une répartition équitable, en garantissant une égalité des chances entre irrigants dans l’accès à la ressource. Ils seraient plus efficaces que la régulation par les prix pour réduire les inégalités sociales. L’équité reste quand même un concept vague dont la définition dépend du contexte d’utilisation.
- l’efficience économique : Les quotas permettraient de chercher à maximiser la productivité marginale de la ressource. Pourtant, les quotas représentent une contrainte administrative relativement rigide.
- la durabilité : les quotas limitent les quantités qui peuvent être extraites pour l’usage agricole et peuvent donc empêcher sa surexploitation pour limiter la pression sur les milieux
- l’autosuffisance alimentaire : Les quotas sont parfois aussi instaurés en vue de garantir une production agricole particulière (quantité ou type de culture), voire pour satisfaire les objectifs d’un pays en termes d’autosuffisance alimentaire
Les systèmes de quotas, au-delà de leurs caractéristiques communes, s’insèrent de diverses manières dans les enjeux et contraintes locales.
- L’attribution des quotas : Réaliser l’allocation initiale des quotas signifie déterminer un critère d’attribution et un indicateur pour exprimer ce critère. Les critères peuvent prendre des formes variées comme l’équité, l’ancienneté, la localisation du point de prélèvement, ou encore l’usage de la ressource
- L’insertion des quotas individuels dans une gestion collective : Les quotas sont attribués à des unités économiques spécifiques et sont donc individuels mais ils peuvent être gérés de façon collective, par exemple avec des quotas individuels issus du partage d’un quota collectif ou des quotas individuels gérés collectivement. Le volume prélevable attribué à l’agriculture irriguée est donc assimilable à un quota collectif, délivré à un OUGC (organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation) qui a ensuite la responsabilité de partager ce quota collectif entre irrigants, en déterminant des quotas individuels, qui remplacent les autorisations individuelles de prélèvement
- L’adaptation des quotas à l’indisponibilité de la ressource : Les quotas sont un moyen de répondre à l’indisponibilité structurelle de la ressource. Cette ressource peut néanmoins faire l’objet d’une pénurie ponctuelle qui demande à adapter les quotas déjà définis, par exemple en hiérarchisant les bénéficiaires des quotas (suivant l’ancienneté ou le type de culture par exemple), et/ou en partageant proportionnellement la pénurie entre irrigants
- La transférabilité des quotas : Les quotas allouent une quantité d’eau limitée à un usager déterminé. Echanger des quotas permet de rendre la ressource plus flexible avec soit des quotas non transférables, des quotas transférés de manière informelle, des quotas transférés uniquement à la marge et de façon temporaire, ou encore des quotas totalement transférables.
Le partage quantitatif de la ressource entre usagers réalisé par quotas présente une grande diversité de mises en oeuvre, permettant aux systèmes de quotas de s’adapter aux contraintes locales. Différentes combinaisons de ces caractéristiques peuvent permettre de satisfaire l’un ou l’autre des objectifs des systèmes de quotas. Les systèmes de quotas en France sont construits sur des caractéristiques communes au niveau national mais adaptés aux situations locales, ce qui les rend différents d’un bassin (ou sous bassin) versant à l’autre.
De façon assez surprenante, le mot quota n’est jamais utilisé dans la législation. Un volume prélevable est partagé entre irrigants en allocations annuelles après répartition, qui remplacent les « autorisations de prélèvement individuelles ». Le terme de quota est remplacé par des termes comme « volume autorisé », « volume prélevable » et « contingentement des eaux » pour renvoyer au quota collectif, et des termes comme « volumes homologués », « autorisations révisées » et « allocations annuelles » pour renvoyer aux quotas individuels.
Tarification de l’eau
Les défis de la tarification de l’eau dans l’agriculture comprennent les questions de recouvrement des coûts, telles que les coûts financiers généralement élevés de la mise en place de systèmes d’irrigation, ainsi que les difficultés de contrôle de l’utilisation des eaux souterraines et des prélèvements d’eau non autorisés
Le niveau de la redevance semble peut-être trop faible pour que cela joue effectivement un rôle incitatif sur le comportement des utilisateurs. Et pendant très longtemps, dans le secteur agricole en France, il n’y avait pas de redevances sur les quantités prélevées par l’agriculture. Certains irrigants sont même exonérés de redevance prélèvement s’ils prélèvent en dessous d’un certain seuil
La grande majorité des agriculteurs payent encore au forfait. Les gros consommateurs ne sont donc pas pénalisés. De plus, ce système de calcul ne contribue pas (ou pas suffisamment) aux coûts de fonctionnement des installations. Certains gestionnaires ont mis en place un système tarifaire plus incitatif et plus efficace avec une part fixe, calculée sur une surface ou un volume souscrit, et une part variable, calculée sur le volume réellement consommé.
Les tarifications reposent sur tout un tas d’hypothèses que l’on n’imagine pas nécessairement au départ. On peut distinguer trois grands types de tarification applicables :
- La tarification forfaitaire : elle est liée à une surface souscrite ou, ce qui revient au même, à un volume souscrit au départ par l’irrigant. La tarification forfaitaire, si elle a l’avantage d’être d’une mise en oeuvre très simple, présente le gros inconvénient de déconnecter la récupération des coûts de la consommation réelle d’eau. Cette tarification est majoritairement utilisée pour l’irrigation gravitaire
- La tarification proportionnelle : la facturation est directement fonction des volumes d’eau prélevés. La tarification proportionnelle présente un risque pour le gestionnaire-porteur de l’ouvrage car, en année humide où les consommations sont plus faibles, il peut y avoir des difficultés à couvrir les charges fixes. La tarification proportionnelle peut prendre plusieurs formes : constante, pallier croisant, saisonnière, blocs
- La tarification binôme : elle contient une part fixe, liée une surface ou un débit (voire un volume) souscrit, et une part variable, liée au volume réellement consommé. Plusieurs gestionnaires de réseaux collectifs d’irrigation (Compagnies d’aménagement) et d’ASA (Associations Syndicales Autorisées) pratiquent la tarification binôme qui paraît la mieux à même d’établir une juste correspondance entre l’usage effectif d’irrigation et la contribution aux coûts.
Les démarches de sobriété hydrique ont des conséquences sur le modèle économique des services d’eau et d’assainissement. En gros, si tout le monde se mettait à utiliser très peu d’eau avec un tarif faible pour les premiers m3 utilisés, les gestionnaires perdraient de l’argent. Quels modèles tarifaires mettre en œuvre pour déconnecter une partie des recette des volumes consommés ? Il ne semble pas y avoir de recette miracle. Certains de mes interviewés auront par exemple tenté de proposer des tarifications pour pénaliser des cultures de maïs et permettre ainsi à des agriculteurs avec des assolements plus diversifiés de pouvoir irriguer sur la totalité de la saison. Tarification qui aurait été largement refusée par la profession agricole, notamment suite aux pressions de maïsiculteurs influents dans la région.
Le financement de l’action publique en faveur de l’eau repose sur trois principes forts faisant l’objet d’un vaste consensus :
- 1er principe : « l’eau paie l’eau ». Les ressources financières collectées auprès des usagers de l’eau doivent servir à financer les investissements nécessaires pour améliorer la gestion de l’eau et pas autre chose. Ce circuit fermé financier se traduit par la perception de redevances dues par les usagers et non d’impôts répartis sur l’ensemble des contribuables qui seraient sans lien avec leur degré d’utilisation de l’eau.
- 2ème principe : « pollueur-payeur ». Les atteintes à la ressource en eau doivent faire l’objet d’une prise en charge par leurs auteurs des mesures de restauration du bon état de celle-ci. Le principe est simple mais sa mise en oeuvre dépend de la capacité à quantifier les atteintes à l’environnement et à en identifier les sources
- 3ème principe : « solidarité amont-aval ». Cette solidarité financière est mise en oeuvre à l’échelle du district hydrographique, c’est-à-dire sur le périmètre de chaque Agence de l’eau.
La simplicité des principes énoncés n’empêche pas une certaine complexité des circuits de financement de la politique de l’eau, qui fait intervenir une multitude d’acteurs aux capacités financières parfois très disparates, dont les infrastructures de gestion de l’eau sont, pour des raisons historiques, à des niveaux forts variables, tout comme les besoins et les projets
La facture des usagers de l’eau couvre le coût du service rendu, mais comporte aussi une part de redevances destinées à financer la politique de l’eau menée par les Agences de l’eau et qui constituent leurs principales ressources. Le bloc communal s’est vu doté d’une ressource dédiée à travers la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui est une taxe locale facultative qui s’additionne à la taxe foncière
Alors que l’essentiel des ressources financières des Agences de l’eau est prélevée sur les usagers domestiques de l’eau, la part des financements retournant au petit cycle de l’eau à travers des subventions vers les services d’eau et d’assainissement n’a cessé de baisser. Rajoutons que les Agences de l’eau sont pénalisées par le système du plafond mordant. Elles ne conservent pas la totalité de leurs recettes. Leurs dépenses sont également plafonnées avec un contrôle financier particulier. Les subventions des Agences se réduisant, l’autofinancement supporté par les intercommunalités a dû augmenter. En ne voulant pas augmenter les redevances, les collectivités ont dû trouver elles-mêmes les ressources pour poursuivre leurs programmes d’investissements. Avec la baisse tendancielle de la consommation d’eau, les volumes facturés sont en régression et seule une hausse du taux des redevances permettrait de maintenir le même niveau de recette pour les services d’eau et d’assainissement.
Marché de l’eau – Privatisation de l’eau
La manière la plus directe de s’approprier une ressource consiste à privatiser la ressource elle-même, c’est-à-dire d’en permettre l’achat par une entreprise privée. La privatisation s’accompagne donc du phénomène de marchandisation puisque l’eau devient par le fait même une marchandise que l’on peut s’approprier en fonction des coûts fixés par le marché. En la financiarisant, la valeur de la ressource est dénaturée puisqu’elle est déconnectée de cette même réalité matérielle. Concrètement, la financiarisation de l’eau passe par plusieurs mécanismes. D’une part, les individus peuvent investir dans les entreprises qui exploitent et gèrent l’eau potable à travers l’achat d’actions (chez Véolia par exemple). D’autre part, il est désormais possible de parier, à travers l’achat de produits financiers dérivés, sur les prix éventuels de l’eau, établis en fonction des changements de quantité et d’accessibilité.
Avec la raréfaction croissante des ressources en eau, l’idée d’une marchandisation des ressources en eau a progressivement fait son chemin et certains pays (États-Unis, Chili, Inde, etc.) connaissent déjà des expériences locales de marchés de l’eau aux succès divers. Dans le même temps, de nombreuses voix se font entendre à l’échelon international pour éviter qu’un tel processus ne se généralise arguant de la reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun de l’humanité.
Les défenseurs des marchés de l’eau oublient souvent de préciser ce que recouvre un marché de l’eau (qui prend plein de formes différentes comme l’échange de tours d’eau de canal entre des agriculteurs, le transfert de droits d’eau du secteur agricole vers le secteur urbain, mais aussi la réallocation des ressources en eau entre différents pays) et assimilent le marché de l’eau à un fonctionnement idéal des marchés de concurrence pure et parfaite. En théorie pourtant, un marché de concurrence pure et parfaite doit remplir cinq conditions pour atteindre l’efficience : une atomicité de l’offre et de la demande, une homogénéité du bien échangé, une transparence du marché ou une information parfaite, une fluidité de la demande et une mobilité de l’offre. Et il est relativement facile de montrer que la plupart de ces conditions ne sont pas remplies dans le cadre d’un marché de l’eau. Rappelons aussi que beaucoup de marchés de l’eau fonctionnent de manière fortement administrée. Les marchés de l’eau ne sont donc pas nécessairement synonymes de privatisation puisque l’État peut concéder des droits d’usage mais conserver la propriété de l’eau
C’est en Australie, en 2003, qu’a été lancée la première bourse au monde d’achat et de vente de l’eau – Water Find. Cette bourse agit sur le marché australien comme un médiateur entre les consommateurs et le marché. L’écrasante majorité des consommations d’eau étant liée à l’agriculture, c’est ce secteur qui est avant tout visé par la privatisation. Des quotas d’eau d’irrigation sont ainsi alloués aux agriculteurs, qui peuvent ensuite échanger leurs surplus sur le marché.
En Espagne, les volumes d’eau échangés sur ces marchés de l’eau (les centres d’échange – aussi appelés banques d’eau – et les contrats de cession) ont toujours représenté une fraction infime du volume total d’eau allouée et utilisée chaque année même en période de sécheresse. Ces marchés n’auraient non seulement pas permis de rendre le partage de l’eau plus efficace et plus durable mais auraient aggravé les dysfonctionnements de ces marchés, avec notamment une concentration des concessions dans les mains de grandes exploitations intensives produisant des cultures à forte valeur ajoutée et fortement consommatrices d’eau, une sous-allocation d’eau pour les milieux aquatiques, ou encore un pompage excessif par les agriculteurs dans les eaux souterraines et superficielles.
Le 7 décembre 2020, le NASDAQ (Wall Street) et le CME (Bourse de Chicago) annonçaient l’ouverture d’un marché à terme de l’eau en Californie. L’index utilisé, NQH20, représentait le prix moyen de l’eau en fonction du volume sans prendre en compte les pertes d’eau et autres coûts. L’index varie notamment en fonction des conditions météorologiques. N’importe qui peut alors acheter en quelques clics des actions qui correspondent potentiellement à plusieurs milliers de mètres cube d’eau, et espérer que la prochaine sécheresse fera grimper les prix.
Au-delà du symbole, en 2023, il semble que ce marché de l’eau californien à terme soit un échec, avec un volume de transactions finalement très bas. Ce type de marché, qualifié ainsi d’illiquide (parce qu’il n’y a pas assez de transactions) comporte plusieurs limitations :
- Les réglementations sur les eaux superficielles, souterraines, et issues de traitement sont différentes
- La rareté de l’eau est très différente (hétérogénéité spatio-temporelle de l’eau) entre les bassins hydrologiques et administratifs.
- Aucune eau n’est livrable en fin de contrat dans un contexte de sécheresse et de pénurie d’eau
Le manque d’information et de transparence sur les marchés physiques décourage les spéculateurs et autres investisseurs à intervenir sur le marché à terme. Et plus important encore, aucun autre marché à terme de l’eau n’est apparu depuis, alors que la plupart des opposants à la financiarisation de l’eau craignaient la multiplication de ces marchés sur l’ensemble des places financières.
Ce qui préserve sans doute l’eau d’une privatisation totale, c’est la perception de son abondance. En effet, plus de 70 % de la surface terrestre est occupée par des plans d’eau, mais l’eau douce ne représente que 3% du total (voir l’introduction du dossier). A côté de ça, il faut rappeler qu’un marché fonctionne bien quand on a un stock à gérer. Pour gérer un flux, c’est beaucoup plus compliqué (les marchés en place au Chili ou en Australie sont là pour gérer des stocks). Un marché de l’eau demande de limiter aussi grandement les contraintes (par exemple il ne faudrait pas mettre des contraintes spatiales d’échanges d’eau) au risque d’annuler tous les bénéfices liés au marché qui ne pourrait pas allouer l’eau là où il la valorise le mieux.
Dans le cas des ressources en eau, cependant, il peut y avoir des raisons importantes pour lesquelles l’allocation par le marché n’est pas souhaitable ou n’est pas pratique. Ces difficultés résultent en partie de l’importance fondamentale de l’eau pour le maintien des systèmes biologiques, sociaux et économiques. Les écosystèmes ont besoin d’eau pour fonctionner correctement et fournir des services. Les êtres humains ont besoin d’eau pour survivre et prospérer. Le simple fait d’attribuer l’eau au plus offrant est potentiellement très problématique si les humains ou les écosystèmes ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux.
L’omniprésence de l’eau, sa mobilité via le cycle de l’eau et l’énorme diversité des utilisations de l’eau rendent la tâche de création de marchés difficile (on pourrait d’ailleurs reparler ici des bassins atmosphériques évoqués en début de dossier). L’eau est inhabituelle en ce sens que, selon le contexte et l’utilisation, elle peut présenter les caractéristiques d’un bien public, d’un bien privé, ou encore d’un bien commun. En l’absence de marchés pleinement opérationnels, les prix de l’eau ne reflètent pas les impacts environnementaux de l’utilisation de l’eau et les coûts d’opportunité (c’est-à-dire la valeur maximale qui aurait pu être générée en utilisant l’eau à d’autres fins). Il en résulte une défaillance du marché : une mauvaise allocation des ressources et un équilibre sous-optimal entre l’activité économique et la pollution qu’elle produit.
Pour autant, cet échec ne doit pas éclipser la progression de la financiarisation de l’eau. Outre cette financiarisation, d’autres mécanismes comme les marchés « cap and trade » fonctionnant sous le principe d’un plafond maximum (cap) et d’échanges de quantités alloués (trade) sont imaginables. C’est déjà le cas pour le marché du carbone et en partie vrai pour le marché de l’eau où l’on a déjà depuis longtemps des systèmes de quotas en place et des gestions ou échanges locaux. Ces échanges de droits d’eau peuvent être permanents ou temporaires.
En France, les marchés de l’eau n’existent pas. La principale limite est d’ordre législative. L’eau étant considérée comme un patrimoine commun de la nation, ça n’est pas une ressource monétisable en tant que telle. Les marchés de l’eau s’appliquent aussi mal à des installations de pompage individuelles, qui sont plutôt majoritaires en France.
On pourrait néanmoins voir arriver des marchés de l’eau à l’échelle locale lors de moments de crise – sous forme de gestion de quotas par les OUGC (organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation) qui pourraient allouer l’eau aux agriculteurs qui la valorisent le mieux. Indépendamment de la crise, l’OUGC pourrait ressembler à un gestionnaire de marché de l’eau dans la mesure où il centralise les demandes agricoles et qu’il décide d’allouer l’eau à des agriculteurs en fonction de la disponibilité et des autorisations en place. L’OUGC pourrait définir des règles de fonctionnement qui pourrait ressembler à celles d’un marché (par exemple en attribuant plus d’eau à ceux qui la valorisent le mieux). En favorisant l’attribution de l’eau aux cultures à forte valeur ajoutée, on assiste en réalité à une dérogation qui est une forme de marché de l’eau basée sur une valorisation économique de l’eau.
Des pseudo marchés de l’eau peuvent également s’observer ponctuellement lorsque des agriculteurs conservent leur autorisation de prélèvement pour la revendre à d’autres dans des années critiques. Ce qui, soit dit en passant, annule complètement l’effet d’une politique de restriction d’eau.
On pourrait aussi imaginer que des arboriculteurs aient une dérogation d’irrigation et, qu’en évitant de perdre une grande partie de leur production grâce à l’irrigation, ils indemniseraient des voisins agriculteurs producteurs de foin pour la perte de production subie cette année-là, qui eux, n’auraient pas eu le droit d’irriguer (un exemple plus loin est détaillé sur la plaine de Crau). Le fait de monétariser l’eau reste un problème pour beaucoup. Ce concept heurte le raisonnement malgré le fait que des agricutleurs pourraient y être gagnant.
Pourquoi prendre le risque de laisser une gestion de l’eau à un marché alors que l’on a des instruments réglementaires pour ça ? L’eau est privatisée à partir du moment où on l’utilise sauf qu’il faut une autorisation pour l’utilisation. Cette autorisation est réglementaire et n’est pas dûe à la propension à payer plus cher que son voisin
La spéculation autour de l’eau serait même peut être un peu plus insidieuse que les marchés dont nous avons parlé. En France, il n’y a pas de spéculation sur le prix de l’eau mais sur l’accès à l’eau. La notion de prix n’est pas apparente. On spécule en réalité sur la valorisation future de l’eau. Certains souhaitent que leur foncier soit irrigable pour des questions d’assurance à court terme mais aussi pour des questions de spéculation foncière. Une terre qui a accès à de l’eau d’irrigation se vend plus cher en général qu’une terre qui n’a pas accès à l’eau. Contrairement au carbone, l’eau est localisée dans l’espace. A moins d’avoir des infrastructures très lourdes pour la déplacer, la gestion de l’eau est totalement différente de celle du carbone qui lui, est échangeable potentiellement partout.
On observe par exemple une demande forte d’irrigation de la vigne en Occitanie. Est-ce le rôle de l’état ou des régions de subventionner de telles infrastructures pour de la spéculation sachant qu’in fine, certains auront accès à l’eau et d’autres non (en partant du principe que tout le monde ne sera pas desservi), le tout sur fonds public ? Quelles priorités adresser sachant que certaines cultures alimentaires pourraient, elles, au contraire, vraiment bénéficier d’un surplus d’eau ? A l’heure actuelle, et au vu du prix de l’énergie, il faut mieux pour certains avoir une valorisation économique importante derrière la production agricole.
La privatisation de l’eau se cache aussi sous l’emprise croissante des multinationales de l’eau (Véolia), des infrastructures hydrauliques (Vinci, Eiffage), de l’hydroélectricité et du nucléaire sur les énormes marchés publics que font naître sécheresses, tempêtes et inondations. En janvier 2022, la multinationale française Veolia est devenue propriétaire à plus de 80% de son principal concurrent, Suez, sur lequel elle avait lancé une offre publique d’achat (OPA) un an plus tôt. Cette opération a permis à Veolia d’acquérir une position quasi monopolistique sur le marché de la gestion de l’eau.
Le processus est un peu similaire avec l’eau en bouteille. Avec trois grandes sociétés qui dominent le secteur – Neptune, Nestlé Water et Danone – il s’agit d’acheter, de traiter et de conditionner de l’eau municipale, qui se vend à très bas prix, pour revendre de l’eau en bouteille à des prix très largement supérieurs.
Comment gérons-nous collectivement l’eau ?
Une gouvernance de l’eau à reconsidérer
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. C’est ce qui est inscrit dans l’article L 120-1 du code de l’environnement français. Nous oublions quand même que l’eau est un bien local avant tout avec des contextes extrêmement différents d’un territoire à l’autre.
Petite histoire législative de l’eau en France : à quoi ça ressemble ?
- 1964 (Loi française). Les agences de l’eau sont créées et ce sont elles qui collectent les redevances et financent les projets de préservation et de restauration du bon état de la ressource. Le principe du pollueur-payeur est mis en place. Les Agences de l’eau (appelées Office de l’eau dans les outre-mer) ont le statut d’établissement public administratif de l’État et ont chacune pour périmètre un bassin hydrographique. L’eau se gère alors par grands bassins versants.
- 1992 (Loi française). La loi met en place les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur chacun des 12 grands bassins versants de France métropolitaine et d’outre-mer et leur déclinaison locale au travers des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
- 2000 (Directive Cadre Européenne sur l’eau – DCE) Elle fixe 4 objectifs : la non dégradation des ressources et des milieux, le bon état des masses d’eau, la réduction des pollutions, le respect de normes dans les zones protégées. L’échéance fixée initialement à 2015 a été repoussée à 2027. La mise en oeuvre nationale des mesures en faveur de l’amélioration de l’état des masses d’eau a pris du retard et l’objectif de 100 % des masses d’eau conformes à l’horizon 2027 paraît d’ores et déjà difficilement atteignable.
- 2006 (Loi Française – LEMA) La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques reprend la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) et tient compte du changement climatique. Elle refonde les principes de tarification de l’eau. Pour les bassins où les déficits sont particulièrement liés aux prélèvements agricoles, une disposition permet de créer des organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation (OUGC), chargés de définir les critères de répartition entre irrigants des volumes prélevables fixés par l’administration. Le volume prélevable pour l’irrigation est alloué par le préfet à l’organisme unique auquel il revient d’établir chaque année la répartition de ce volume entre l’ensemble des irrigants.
- 2014 (Loi française – MAPTAM) et 2015 (loi française – NOTRe). Ces lois donnent la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) traduisant un mouvement de transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les intercommunalités. Si deux tiers des services d’eau potable et trois quarts des services d’assainissement collectif sont gérés en régie par les collectivités, la gestion déléguée et la gestion en régie sont à peu près à égalité en termes de nombre d’habitants desservis. La loi MAPTAM crée le statut d’Etablissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) pour les syndicats oeuvrant à des échelles de sous-bassins ou de bassins côtiers.
- 2019 Instruction ministérielle : Arrivée des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE – nous en reparlons un peu plus loin).
- 2023 Plan National Eau lancé par le gouvernement
L’ensemble de ces lois a profondément modifié le paysage institutionnel de l’eau. Pour l’heure, la plupart des collectivités se recentrent sur leurs compétences obligatoires (les collectivités gémapiennes – en référence à la compétence GEMAPI). La gestion quantitative de l’eau reste quant à elle quelque peu orpheline, exception faite des agences de l’eau. Ce constat peut être mis en parallèle avec l’observation consistant à voir fleurir des micro-projets individuels ou pseudo-individuels (GAEC), à usage agricole exclusif, couramment dimensionnés pour passer au-dessous des radars de la réglementation sur l’eau. Néanmoins, des initiatives intéressantes ont vu le jour avec la constitution de syndicats mixtes départementaux ou interdépartementaux qui permettent de regrouper un ou des conseils départementaux et des collectivités territoriales (agglomérations, communes, EPCI, syndicats d’AEP ou d’assainissement), voire des ASA (Associations Syndicales Autorisées).
Dans un rapport de 2022, la Cour des Comptes estime que la politique de l’eau est à la fois déconcentrée et décentralisée (Figure 39). La décentralisation serait inachevée, confiant des responsabilités importantes aux collectivités locales conjuguées à une intervention permanente de l’État, qui manque de cohérence. Les trois ministères compétents (environnement, agriculture et santé) défendraient des orientations différentes dont les divergences n’auraient jamais été véritablement surmontées. La Cour des Compte point que l’organisation actuelle est inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l’eau.
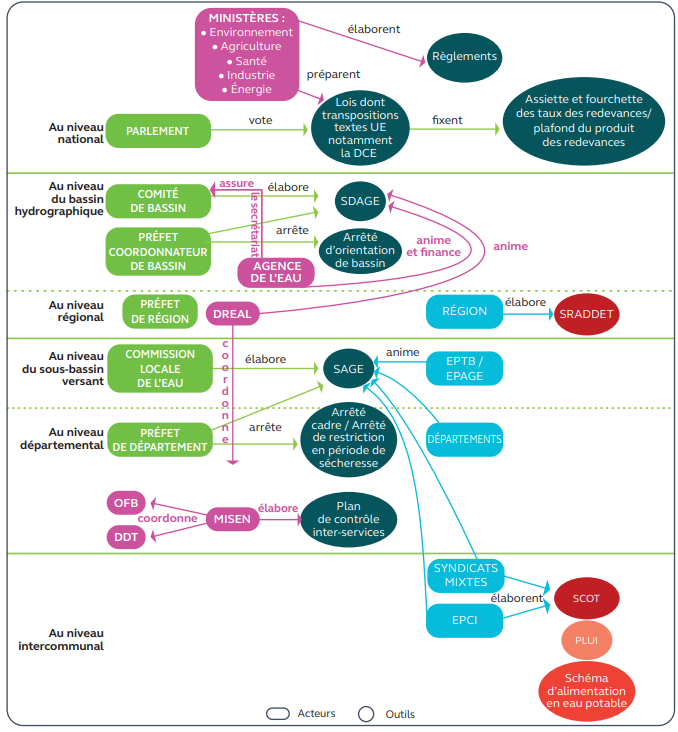
Figure 39. Schéma simplifié de la gouvernance de l’eau en France. Tous les acteurs ne sont pas représentés…)
L’intervention des collectivités locales souffre de son morcellement et elle est trop souvent conduite à une échelle géographique inadaptée. L’inadéquation entre les circonscriptions administratives et la géographie des bassins et sous-bassins hydrographiques constitue une réalité incontournable, qui oblige l’État et les collectivités locales à mettre en place de nombreuses instances de coordination
Le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) n’aurait pas amélioré la situation. De plus, comme le territoire des EPCI ne correspond pas non plus à celui des sous-bassins hydrographiques, la création d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (Epage) ou d’établissement publics territoriaux de bassin (EPTB) est nécessaire pour qu’une politique cohérente puisse être menée à la bonne échelle, celle des sous-bassins hydrographiques.
L’Etat a cherché à intégrer dans son organisation la spécificité due à la gestion de l’eau, en mettant en place des préfets coordonnateurs de bassin, qui jouent un rôle de coordination et de mise en cohérence de l’action de l’Etat entre préfets de département, à l’échelle des grands bassins (ceux des agences de l’eau). Les petits bassins versants disposent quant à eux de dispositifs de gestion concertée, de type SAGE ou PTGE (nous en parlons juste après), bien adaptés à ces territoires à échelle humaine. Par contre, la gestion, notamment quantitative, des sous-bassins de taille intermédiaire (grands affluents de nos fleuves, qui traversent plusieurs départements ou régions) pose souvent problème, faute d’outils adaptés à cette échelle. Aujourd’hui, il est indispensable d’assurer sur l’ensemble du territoire français une planification et une organisation de la gestion globale de l’eau à une échelle hydrographique opérationnelle.
Les pouvoirs de police de l’eau sont exercés par les services de l’État, en particulier ceux des DDT (directions départementales des territoires), mais aussi par les agents de l’OFB (Office français de la biodiversité). Les préfets peuvent s’appuyer sur les services compétents des DDT, chargées aussi de la mer (DDTM) dans les départements littoraux, et qui instruisent les dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et animent la politique locale en faveur de l’eau et des milieux aquatiques. Ils peuvent aussi s’appuyer sur les DREAL qui veillent à la bonne application des textes en matière d’eau, surveillent les installations classées et suivent les débits des cours d’eau.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) constituent des outils de planification de la politique de l’eau à l’échelle de chaque bassin hydrographique (sept en métropole et cinq outre-mer). Ils intègrent l’agriculture essentiellement sous une forme prescriptive par l’intermédiaire de niveaux de qualité de l’eau et des milieux aquatiques à atteindre ou à restaurer, en renvoyant à des outils souvent réglementaires : réduction des pollutions par les nitrates ou les phytosanitaires, protection des captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) en lien avec la santé humaine ; préservation/restauration des milieux aquatiques (ZH, vidange des retenues, débits réservés), DOE, DCR et économies d’eau sur la partie quantitative. Les comités de bassin ont par ailleurs établi des plans d’adaptation au changement climatique (PACC) mais ceux-ci restent à une échelle très large et peinent à être déclinés à l’échelle des territoires, où ils sont encore peu connus et valorisés.
Les SDAGE ont également un effet sur les politiques locales d’utilisation de l’espace puisque les Schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUI) et cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE. Il en va de même du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui doit prendre en compte les orientations de gestion équilibrée de la ressource en eau. Malgré le fait que les schémas d’aménagement de l’eau et les documents d’aménagements du territoire soient liés, la notion de compatibilité reste assez large et vague. Elle est principalement basée sur un principe de non contrariété entendu de façon variable selon les territoires.
Force est de constater que le rapport eau – agriculture est souvent ignoré dans les SCoT et les PLUi, que beaucoup de PCAET restent à un stade descriptif et que les SRADDET portés par les régions sont d’une ambition inégale et n’intègrent souvent pas de choix ou d’options vis-à -vis des tensions possibles entre eau et agriculture. L’Autorité Environnementale souligne d’ailleurs le risque de contradiction dans le parti-pris de ne pas traiter cette question à part entière, alors que plusieurs dispositions du SRADDET, concernant d’autres thématiques, pourraient accroître les conflits d’usage, en particulier dans des secteurs de déficit quantitatif avéré. Les SDAGE peuvent ainsi constituer un frein à l’urbanisation lorsque la ressource en eau est insuffisante ou dégradée.
Dans ces grands documents d’aménagement, la question des périmètres irrigués reste peu abordée. Les équipements en matière d’irrigation ne sont pas considérés dans l’identification des terres agricoles à préserver. Une fois que les meilleures terres privilégiées, celles disposant d’infrastructures d’irrigation seront à considérer dans la protection, leur irrigation potentielle se raisonnant en accord les autres usages de la ressource (approvisionnement en eau potable et le bon état des milieux), et du projet agricole viable économiquement prévu.
Le sujet de l’irrigation apporte pourtant son lot de questions : Comment définir les périmètres irrigables à préserver dans un contexte de réduction de la disponibilité en eau à l’avenir (en gros comment définir les bornes d’irrigation qui pourraient être maintenues dans un contexte de contraintes) et où les filières et cultures présentes sur ces périmètres peuvent évoluer avec le changement climatique ? Comment compenser la perte de productivité liée à la perte de surfaces irriguées ? Comment mieux croiser planification agricole et planification urbaine ? Et plus généralement sortir l’agriculture d’une seule approche filière pour développer une approche territoriale y compris sur la ressource en eau ? Quels sont les mécanismes de compensation lors de l’artificialisation de terres irriguées ? Quel observatoire pour les prix du foncier irrigué foncier non irrigué ? Quelle caractérisation des inégalités entre agriculteurs bénéficiant d’infrastructures d’irrigation et ceux qui n’en bénéficient pas ?
La première difficulté est de savoir ce qui entendu par terres dites irrigables, à l’échelon national ou plus spécifiquement pour un périmètre de planification opérationnelles des sols (SCoT, PLUi, PLU). Les définitions de l’Union Européenne, du recensement agricole ou encore d’autres à l’échelle locale ne sont pas toujours accordées les unes aux autres. Certains territoires ont en effet été façonnés par les aménagements hydrauliques majeurs, parfois millénaires associant étroitement eau et agriculture. Cependant, force est de constater un certain flou voire une certaine ignorance liée au fait que la superficie des terres irriguées varie en fonction du contexte climatique à un instant t et que la définition du terme irrigable fait l’objet de définitions variées, et que peu de données actualisées existent finalement au niveau national.
Si les SDAGE planifient la politique de l’eau au niveau de chaque bassin hydrographique, la gestion fine de la ressource en eau ne peut se faire à cette échelle. Les SAGE mettent en œuvre par bassin les orientations du SDAGE avec un rapport de compatibilité. Les SAGE, qui font parfois l’objet de critiques quant à leur lourdeur et à leur manque d’articulation avec les autres outils de planification territoriale, ne sont pas les seuls outils de planification et régulation locale de la gestion de la ressource en eau. Des contrats de milieu (contrat de rivière, contrat de lac ou de nappe), plus souples et concrets, peuvent être conclus entre partenaires (État, Agences de l’eau, collectivités territoriales), sous l’égide d’une structure porteuse, pour améliorer la qualité des eaux ou mieux gérer les quantités disponibles.
Près de la moitié des sous-bassins hydrographiques ne sont pas couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), dont l’élaboration conditionne pourtant la mise en œuvre concrète des orientations du SDAGE. Lorsqu’ils existent, le contenu de ces schémas n’est pas toujours satisfaisant en raison de leur durée moyenne d’élaboration, proche d’une dizaine d’années, de l’ancienneté des données sur lesquelles ils s’appuient, et de l’absence d’objectifs de réduction des consommations d’eau.
Dans tous les bassins en déficit quantitatif, il a été demandé aux préfets de déterminer le volume prélevable, tous usages confondus, garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques correspondants et donc le respect huit années sur dix des débits objectifs d’étiage (DOE – voir la section sur les débits objectifs, débits biologiques et écologiques), et de réviser les autorisations de prélèvements pour que le volume total autorisé soit au plus égal au volume prélevable.
Pour les bassins où les déficits sont particulièrement liés aux prélèvements agricoles, une disposition suite à la loi LEMA de 2006 permet de créer des organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation (OUGC). Pour les prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole, les agriculteurs ont ainsi la possibilité de s’organiser collectivement au sein d’organismes uniques de gestion collective (OUGC). Ce sont ces organismes qui détiennent une autorisation unique de prélèvement (AUP) pluriannuelle pour l’ensemble de leurs membres et qui répartissent annuellement les volumes entre agriculteurs irrigants, mettent en place d’éventuelles restrictions temporaires, organisent les tours d’eau. Le volume prélevable étant limité, les nouvelles demandes sont mises en attente le temps qu’un irrigant sorte de la liste. À plus long terme, le principal défi à relever sera de faire converger une offre en eau en diminution lors de l’étiage (dont la durée a tendance à s’allonger) avec une demande qui par endroits n’est pas satisfaite et va encore augmenter du fait du changement climatique.
C’est au travers du développement de réseaux collectifs d’irrigation, de réseaux de canaux, que s’est développée l’irrigation. À partir de 1865, les gestionnaires de ces réseaux collectifs ont progressivement pris la forme d’associations syndicales autorisées (ASA). Les ASA sont des réseaux collectifs d’irrigation (ça n’a rien d’associatif). Ce sont des établissements publics très structurés avec le même rôle qu’une commune. Ce sont au final des préleveurs parmi d’autres et ce sont des clients de l’OUGC. Les ASA représentent la moitié des prélèvements en réseau collectif en France, le reste étant des prélèvements individuels. Les ASA ne participent pas à la politique publique de gestion de l’eau, sauf la tarification au sein de leur propre réseau. L’eau d’irrigation est une charge comme une autre pour les ASA. Spontanément, la seule raison pour laquelle un ASA pourrait acter une tarification élevée ou dissuasive serait pour éviter de dépasser leur autorisation de prélèvement, ou pour éviter des surinvestissements dans leur réseau (faut mettre en place des stations de surpression, redimensionner les stations à certains endroits).
Les ASA sont soumises à une contrainte d’obligation d’équilibre budgétaire et doivent donc jongler entre plusieurs objectifs qui limitent leur marge de manoeuvre (équilibre budgétaire, inciter à l’économie d’eau, économiser de l’eau et donner un accès à l’eau à de jeunes agris, favoriser l’élevage pour sécuriser le fourrage pour faire sur contribuer les grandes cultures en faveur de l’élevage.
L’autre période de développement important de l’irrigation collective commence dans les années 1960 avec d’abord la création de sociétés d’aménagement régional (SAR). Même s’il est difficile d’estimer leur importance relative, les ASA, représenteraient la moitié de l’irrigation réalisée à partir de réseaux collectifs, les SAR de l’ordre de 20 % et le reste regroupant un ensemble hétéroclite de structures (CUMA, réseaux communaux, syndicats intercommunaux, associations loi 1901, etc.).
L’Etat ne dispose plus de compétences d’ingénierie au sein de ses services et n’ont ainsi pas de compétences pour porter un jugement sur la gestion de l’eau. Ce sont par exemple essentiellement les chambres qui portent les OUGC. La profession agricole accepte cette notion de gestion de l’eau (notamment de sobriété) si elle est accompagnée d’une création de ressource en eau. La chambre d’agriculture, en son rôle d’acteur départemental, travaille à une échelle qui ne coïncide souvent pas avec le territoire du projet. Elle n’est donc pas porteuse des décisions du SDAGE, ni de la logique du bassin versant ou du territoire du projet. Ceci peut, par exemple, la conduire à s’en tenir à des positions de principe ou entrer en conflit avec une chambre voisine. Ce sont également de potentiels conflits d’intérêts qui peuvent arriver puisque la chambre est à la fois représentante d’intérêts agricole mais aussi organisme de conseil aux agriculteurs ou d’expertise territoriale.
Les PTGE (projet de territoire pour la gestion de l’eau) ont été proposés pour gérer l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique de manière opérationnelle. Ils prennent la suite des PGRE (plan de gestion de la ressource en eau) pour encourager une démarche impliquant tous les acteurs de l’eau afin de réduire les déficits quantitatifs constatés sur les territoires. Ils intègrent une vision prospective visant à intégrer les conséquences des dérèglements climatiques sur la disponibilité de la ressource en eau, alliant l’offre et la demande en eau, et permettent l’ouverture de l’indispensable dialogue local sur le partage de l’eau entre l’agriculture et les autres acteurs de la société, notamment protecteurs de la nature. Le niveau d’avancement des PTGE est très hétérogène en France. Les PTGE doivent être construits en cohérence avec les SDAGE et les SAGE lorsqu’ils existent.
Élaborer un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est une des propositions de l’État en réponse aux oppositions croissantes et parfois très virulentes d’une frange de la population à la construction d’ouvrages de stockage ou de transfert d’eau pour l’irrigation. C’est une démarche endogène du territoire qui a l’ambition d’appréhender, sans les dissocier, les dimensions environnementales, économiques et sociale de la gestion de l’eau, et qui mise sur l’intelligence collective pour identifier une trajectoire de gestion équilibrée de la ressource puis la concrétiser à travers un programme d’actions.
Concrètement, un PTGE s’applique à un bassin versant (de 100 à 1 000 km2), souvent caractérisé par une problématique spécifique (manque d’eau, inondations, qualité de l’eau) à concilier avec différentes activités économiques (production, transformation, tourisme). Le PTGE s’appuie sur des structures de gouvernance de l’eau existantes et légitimes, dont les Commissions locales de l’eau (CLE), sortes de parlements de l’eau qui élaborent le SAGE et réunissent toutes les parties prenantes afin d’asseoir la légitimité du projet (dont notamment un Établissement public territorial de bassin (EPTB) ou un Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (Épage) lorsqu’ils existent sur le territoire).
L’outil PTGE paraît bien adapté à des bassins versants à taille humaine (permettant une gouvernance, la co-construction et le dialogue territorial entre les acteurs de terrain) mais moins pertinent pour les très grands bassins, sur lesquels il convient pourtant d’anticiper les effets du changement climatique et d’organiser la solidarité amont-aval. Certaines collectivités ne s’impliquent pas suffisamment dans l’animation des PTGE. Il en est souvent de même des filières agricoles qui devraient se mobiliser plus fortement, notamment pour aider à l’aboutissement d’engagements multi-acteurs eau et agriculture pour rendre opérationnelle la mise en oeuvre des PTGE.
Peu de PTGE sont évalués économiquement pour l’instant. L’évaluation économique est importante car elle indique si le scénario étudié est économiquement souhaitable et rentable lorsque l’on se place du point de vue de chaque catégorie d’acteurs. Mais elle ne dit pas si ce scénario est le meilleur pour la gestion des ressources en eau, ou pour d’autres critères environnementaux qui sont aussi à prendre en compte. L’intérêt d’un scénario sans projet est mal compris, et sans cette situation de référence, la négociation devient le principal outil pour arrêter la trajectoire à suivre. L’analyse coût-bénéfice est le parent pauvre de la démarche alors qu’elle est un outil d’aide à la décision pour la réalisation d’actions, notamment faisant appel aux aides publiques.
La politique de l’eau est ainsi confrontée à une crise de légitimité. Préserver une gestion de l’eau équilibrée ne peut passer que par une re-politisation de la question de l’eau en affirmant qu’il demeure possible de mieux mobiliser l’eau pour nos besoins sans dégrader la ressource ni quantitativement ni qualitativement. Le succès de cette stratégie passe certainement par un renforcement de la place des élus locaux dans la gouvernance des politiques de l’eau. Les Commissions locales de l’eau (CLE) qui jouent le rôle de parlement local de l’eau, sont une instance qui gagnerait certainement à être mieux mobilisée.
L’intrication des responsabilités de l’État et des collectivités territoriales nuit à l’efficacité de la politique de gestion de l’eau. Cette imbrication ne permet pas non plus aux citoyens de comprendre facilement la répartition des rôles entre les décideurs. Une décentralisation plus effective des compétences permettrait de renforcer la responsabilité des différents intervenants dans la gestion de cette politique publique essentielle et d’en améliorer l’intelligibilité pour le grand public
Le problème n’est plus dans le fait d’avoir toutes les données suffisantes. Les données météorologiques historiques sont disponibles. La nature des sols est connues en local. Les projections climatiques, même entachées d’incertitude, donnent quand même une bonne idée de ce qu’il pourrait se passer. Hors évènement complètement inattendu et impossible à prévoir, la trajectoire est globalement connue. Collectivement, il nous faut nous demander si nous sommes en capacité ou non de nous mettre tous autour d’une table, de nous écouter, et de se dire que l’on assume ensemble de faire des choix sur des données qui ne seront de toute façon pas fiables à 100%.
Une interrogation finale : afin de mieux gérer l’eau en France demain, faudra-t-il une nouvelle loi pour prendre la suite des lois sur l’eau de 1992 et de 2006 ? Plusieurs acteurs de la politique de l’eau ont plaidé en ce sens, notamment à l’occasion d’un débat organisé par le Cercle français de l’eau au printemps 2022.
Du besoin de concertation et de collaboration autour de la problématique de l’eau
Le conflit d’usage, terme récurrent des débats sur l’eau, traduit en fait la plupart du temps la difficile conciliation entre les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques. Chaque acteur vient remettre en cause la légitimité de l’usage de l’autre, avec une notion différente de consentement à payer et une temporalité des usages assez variable entre les usagers. L’eau apparaît alors comme le miroir de la société. Ailleurs, elle peut être le révélateur du fonctionnement de la société, mais aussi le médiateur des relations sociales. À travers l’eau se jouent des statuts individuels ou de groupe, ainsi que le rappel de l’ordre social.
Même lorsque la gestion de l’eau est présentée comme autonome et communautaire, on arrive toujours à retrouver l’influence des relations de pouvoir entre État et communautés dans la façon dont le chemin de l’eau (choix du tracé des canaux, de l’emplacement des vannes…) a été façonné, voire manipulé politiquement, pendant des siècles. Pourquoi à tel endroit l’eau est-elle apportée par une série de canaux parallèles et non par un seul canal de taille plus importante ? Pourquoi à tel autre endroit les canaux se croisent sans que leurs eaux ne se mélangent, alors que plus en aval elles se retrouvent ? Pourquoi des techniques (de partage de l’eau) très diverses coexistent dans une même région ? Aujourd’hui, avec le développement des forages, l’eau souterraine est au cœur des enjeux de pouvoir économique et politique. Les réseaux d’irrigation collectifs ont été remodelés (des canaux détruits), au profit d’une irrigation individuelle par eau souterraine.
L’irrigation est trop souvent considérée comme une activité purement technique ou économique et l’eau comme une simple ressource. Pourtant, plusieurs études montrent que sa gestion est avant tout relationnelle, dépendante des interactions entre individus, puisque les activités de distribution et de partage de l’eau, de gestion des conflits et de maintenance des infrastructures requièrent une organisation collective et, a minima, de l’information. L’eau est également un élément qui relie de nombreux domaines de la vie sociale et, à travers elle, s’expriment le statut social, le prestige, les relations de parenté ou les rapports de pouvoir.
La question de l’irrigation ne peut se passer d’une réflexion entre la dimension collective et individuelle. L’autogestion par les communautés d’usagers est d’autant plus rare à observer que bien souvent lorsque les agriculteurs font, par exemple, le pas de passer des eaux de surfaces aux eaux souterraines, c’est pour ne pas retrouver toutes les contraintes du collectif (nous avons plus haut dans ce dossier la tendance à se déconnecter du réseau collectif). En étant pleinement en charge individuellement des ressources, il n’y a donc plus de partage de l’eau.
L’irrigation peut être vue dans une logique assurantielle. Une dépense d’argent (enrouleur, pomper de l’eau) permet un certain niveau de garantie de rendement. C’est assurance est gérée à l’échelle individuelle dans le sens où chacun prend un peu ce dont il a besoin. Cette couverture individuelle pourrait pourtant être mutualisée auprès de plusieurs irrigants de manière à gérer le risque de manière concertée et collective.
La gestion de l’eau pose souvent des problèmes d’arbitrage (entre efficience d’utilisation, utilisation parcimonieuse ou encore arrêt d’irrigation choisi ou subi) et des enjeux socio-économiques. Et ces questions seront d’autant plus brulantes qu’avec le déréglement climatique, la disponibilité en eau baissera et que l’on peut s’attendre à une baisse des niveaux d’étiage. Pourquoi les groupes agro-alimentaires peuvent-ils pomper l’eau de source et la revendre à plusieurs euros du le litre alors qu’elle appartient tout le monde ? Pourquoi le gazon des golfs doit-il être arrosé avec de l’eau potable ? Est-ce qu’on veut priver d’eau ou de chance une structure actuellement économe en eau ou une qui n’en a pas besoin maintenant mais qui en aura besoin plus tard ? Dans les situations de crise, la vraie question est de réfléchir un choix acceptable pour optimiser l’usage de la ressource
Qu’est ce qui est juste ? Qu’est ce qui est économiquement le moins dommageable ? En agriculture, on pourrait penser qu’il faut sécuriser en premier lieu les cultures irriguées qui n’ont pas d’alternative agronomique dans leur contexte édaphique (le sol) et climatique, les cultures stratégiques et celles sur lesquelles repose l’équilibre d’une filière locale de transformation. Mais cela remet-il en cause le modèle d’agriculture dominant ? Que penser également de la concurrence possible entre les cultures énergétiques (méthanisation) avec les cultures à finalité alimentaire pour l’accès à l’eau? Les OUGC (Organismes Uniques de Gestion Collective) sont chargés de définir les critères de répartition entre irrigants des volumes prélevables fixés par l’administration. Or, les règles d’allocation de quotas d’irrigation en volume ou en débit ne prennent jamais en compte de priorité pour les cultures les plus intensives en valeur/unité d’eau d’irrigation consommée. Il n’existe pas non plus de tarification collective agissant dans ce sens. Peut-être faudrait-il plutôt donner accès prioritaire aux personnes qui ont utilisé le moins d’eau possible en agriculture, une sorte de récompense plutôt qu’une idée de punition
Est-ce qu’une solidarité est envisageable entre les filières en cas de manque sur la ressource ? En gros, la question est de se demander si certains sont prêts à délaisser un peu d’eau au profit d’autres. Des expérimentations ont eu lieu dans la plaine de Crau, en proche Camargue, pour voir s’il était imaginable de réduire l’allocation d’eau aux producteurs de foin pour la laisser à des arboriculteurs qui, si l’eau venait à manquer, auraient beaucoup plus à perdre que les producteurs de foin. L’objectif était de voir à quel prix (niveau de compensation payé par les arboriculteurs par exemple) les producteurs de foin étaient prêts à aller pour accepter de réduire leur utilisation de l’eau.
Contrairement à la notion d’intérêt général, souvent abstraite, l’utilité sociale fait toujours référence à une intention particulière. Il n’y a pas d’utilité sociale en soi. Il n’y a d’utilité sociale qu’autour d’un objet ou d’un projet qu’une communauté d’acteurs partage et qu’il s’agit de préserver, de valoriser, de développer. Identifier l’utilité sociale et territoriale d’un projet de gestion de l’eau et des milieux aquatiques revient donc toujours à considérer le site, le milieu et/ou la ressource concernés en tant que biens communs à un ensemble d’acteurs. Dans certains cas, il peut s’agir de renforcer ce caractère de bien commun, lorsqu’il s’agit par exemple d’élargir l’appropriation sociale d’un site resté jusque-là peu fréquenté ou réservé à quelques initiés. Une telle intention confère alors au projet une dimension politique qui, si elle peut donner lieu à quelques tensions ou conflits, est susceptible de faciliter son portage politique et l’intéressement d’un cercle d’acteurs plus large.
Bien qu’a priori rassembleuse, la question du commun et surtout celle des limites de la communauté d’acteurs pouvant en jouir, peuvent parfois susciter des débats vifs voire des réticences, notamment quand les lieux concernés font l’objet d’une appropriation ancienne par une catégorie d’acteurs particulière. Le commun n’est pas un attribut fixe : c’est un processus dynamique incarné et défendu par la volonté politique collective
Néanmoins, la question de l’eau n’a jamais donné lieu à des débats menés de manière large avec le grand public.
Le partage de l’eau ne pourra pas se réfléchir sans s’efforcer d’identifier et d’élargir le cercle des acteurs intéressés ou potentiellement intéressés à l’objet du projet pour l’eau et les milieux aquatiques et à son intention. Il ne faudra pas simplement mettre des agriculteurs autour de la table. C’est également se donner les moyens de construire collectivement ce qui fait commun au sein de cette communauté d’acteurs, notamment par l’apprentissage collectif des usages et enjeux de chacun. Des espaces de de dialogue et d’échange doivent s’ouvrir pour combler les incompréhensions mutuelles entre tous les acteurs. Des outils comme les serious game (basés ou non sur des technologies numériques) peuvent appuyer à réfléchir collectivement. C’est par exemple le cas du serious game RSEeau dont l’objectif était d’évaluer comment inciter les agriculteurs à viser un rendement un peu inférieur pour lisser la pointe de demande en passant par des contreparties (droits d’eau à d’autre période, argent pour compenser un manque à gagner…). C’est enfin en étant capable de se projeter dans des scénarios à plusieurs années ou dizaine d’années vers l’avant que les décisions les plus structurantes pourront être prises (en s’intéressant par exemple à l’évolution de la disponibilité en eau avec le déréglement climatique).
Il parait alors difficile de prendre des décisions sans avoir accès de la donnée. Certains départements ne savent par exemple même pas la quantité de surface irriguée sur leur territoire. Les modèles de gestion (ex : fixer un volume de prélèvement en se basant sur une quinquennale sèche) font en fait l’hypothèse que nous n’avons pas de connaissance sur la ressource en eau. Cette connaissance est pourtant disponible en suivant les prélèvements de manière régulière pour faire des arbitrages concertés permanents et chercher des marges de manœuvre. Connaitre le fonctionnement hydrologique de son bassin et être capable d’en modéliser l’état et l’évolution future parait nécessaire pour imaginer une gestion intégrée de la ressource en eau. Les données peuvent ainsi être vues parfois comme un facteur d’apaisement quand il y a des controverses et des tensions.
Cela passera aussi certainement par une modernisation institutionnelle de certaines règles de partage de l’eau, avec certaines structures qui ne sont pas en conformité avec les règles actuelles. C’est par exemple le cas de vieilles ASA (Associations Syndicales Autorisées) où règnent toujours des anciens droits d’eau napoléoniens. Certains droits d’eau sont toujours liés à la construction des canaux, à un moment où il y avait aussi des arrangements locaux en fonction du foncier. Ces droits d’eau étaient définis indépendamment de la réalité physique du territoire. Certains exploitants agricoles auraient eux-aussi des quotas de référence sous prétexte qu’ils étaient les premiers à accéder à de l’irrigation, sans remise en question de ces références au vu de l’évolution du contexte actuel.
Le modèle universel de l’eau n’existe pas. Attention à ne pas tomber dans une rationalisation trop puissante de la lecture de l’eau. A vouloir trop objectiver les aspects quantitatifs de l’eau, on a parfois tendance à désensibiliser et dépolitiser les débats sur l’eau. Les raisonnements actuels sont effectivement très orientés sur la gestion quantitative de l’eau avec des débats sur des niveaux de prélèvements (les études volume prélevable) avec quand même l’idée que tout ce qui est disponible est potentiellement encore prélevable. Cette tendance à la dépolitisation peut aussi se retrouver avec la délégation de l’eau en régie et le transfert de compétences sur la gestion de l’eau a des échelles administratives plus larges.
Arrêtez de me bassiner
L’actualité récente nous laisse à penser qu’une forme de guerre de l’eau ou tout du moins d’appropriation de l’eau aurait commencé. En écho aux combats menés au niveau du barrage de Sivens dans le Tarn en 2014 (et qui ont causé la mort du militant Rémi Fraisse), les débats sur l’usage de l’eau ont été relancés fortement suite à la controverse de la méga bassine de Saintes Solines dans les deux sèvres en 2023. Le gouvernement y a déployé une force armée incommensurable, plus de 3000 policiers, pour défendre un projet de construction de méga-bassine, ou plutôt en l’état actuel des choses, pour défendre un trou, vide. Après un déchainement de violence pendant un week end entier par les policiers en place et par la brigade en quad (BRAV-M), des dégâts sont à déplorer des deux côtés, et deux militants ressortent de la manifestation plongés dans le coma (le gouvernement ayant donné l’ordre de ne pas laisser intervenir le SAMU). Malgré des images et vidéos accablantes de violence, le gouvernement reste campé sur ses positions et n’ose même pas assumer l’inhumanité des forces en présence (la BRAV-M n’aurait visiblement jamais tabassé à coups de matraque les militants malgré les preuves irréfutables ayant tourné sur les réseaux) et les réponses de violence totalement déséquilibrées des forces de l’ordre (LBD, grenades de désencerclement, Brav-M) par rapport à la violence des militants. Pire encore, le gouvernement a poussé la dissolution du collectif des Soulèvements de la Terre en juin 2023.
En France, en dehors des grands barrages qui servent également d’autres usages (production d’électricité, d’eau potable), beaucoup de retenues sont utilisées essentiellement pour l’irrigation. Si le principe est simple – créer des réservoirs d’eau – il existe de nombreuses manières de le faire. Le nombre de ces retenues existant en France et le volume total qui y est stocké ne sont pas précisément connus, pas plus que la part de celles qui sont réellement utilisées pour l’irrigation agricole. On sait seulement qu’elles sont plusieurs dizaines de milliers et stockent plusieurs centaines de millions de mètres cubes d’eau. L’absence de gestion collective de leurs conditions de remplissage, d’entretien, d’utilisation et de vidange, et de fait l’absence de contrôle de leur impact sur l’environnement, ainsi que leur objectif exclusivement tourné vers l’irrigation, conduisent à ce que les agences de l’eau ne les subventionnent pas. Par ailleurs, une part significative d’entre elles n’est plus utilisée ou seulement partiellement. La remobilisation de ces retenues abandonnées ou sous-utilisées pour l’irrigation pose des questions techniques, financières et juridiques qui la rendent hypothétique en l’état actuel du droit français.
Les projets de retenues sont portés le plus souvent par des collectifs d’agriculteurs, assurant une gestion collective de la ressource en eau à l’échelle d’un sous-bassin et non pas une gestion individuelle de cette ressource sans coordination entre exploitants.
Les concernant, les méga-bassines (appelées aussi retenues de substitution) sont des énormes structures qui ne se remplissent pas en captant l’écoulement de l’eau, mais uniquement par pompage de l’eau dans les rivières et les nappes phréatiques. Les méga-bassines diffèrent des réservoirs ou retenues de barrages classiques puisqu’elles ne se situent ni sur un cours d’eau ni sur une zone de relief. Le réservoir doit donc être excavé et endigué tout autour, ce qui lui donne cette forme de bassine. Ces méga-bassines sont censées jouer le rôle d’assurance-eau pour les producteurs agricoles en sécurisant une ressource qui pourrait ne pas être disponible pendant les mois d’été. Contrairement aux autres infrastructures de stockage, les méga-bassines pourraient, elles, être subventionnées à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau. Une cartographie dynamique des bassines en place est disponible ici : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bassines_779169#7/46.263/2.153.
Le projet de retenues de substitution de la Coopérative de l’eau des deux Sèvres a pour objectif de répondre à la diminution programmée des volumes prélevables courant printemps-été en substituant certains de ces prélèvements estivaux par des pompages hivernaux et un stockage de cette eau dans des retenues en vue de son utilisation pendant la période printemps-été.

Figure 34. Les formes de captage d’eau. La méga-bassine de Saintes Solines est une bassine de type 1. Note : Les lacs de barrages ne se remplissent pas en stockant la pluie qui tombe. La somme de ces prélèvements peut alors contribuer à augmenter la durée de la sécheresse. On parle d’ailleurs pour cette raison de sécheresse « anthropique ».
Le cas de Saintes Solines a été particulièrement médiatisé parce que selon des informations relayées par de nombreux médias, une étude du BRGM aurait démontré l’innocuité de cette retenue de substitution sur les milieux. Plusieurs voies se sont ensuite déployées pour critiquer la qualité du rapport qui était en réalité un document produit par la section d’études commerciales du BRGM en réponse à une prestation privée d’une coopérative d’irrigants locale du marais Poitevin. Le BRGM avait alors proposé un document qui répondait uniquement aux questions posées (et aux scénarios demandés) par la coopérative et qui n’aurait jamais dû être considéré comme un document de référence sur l’installation de la dite méga-bassine. Le BRGM a d’ailleurs dû présenter en urgence un communiqué de presse – plutôt très bien écrit – à la suite de l’excitation grandissante autour du sujet (https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/expertise-brgm-projet-reserves-substitution-deux-sevres-note).
Le rapport initial du BRGM n’apportait que des résultats d’un point de vue hydro-géologique sur la nappe et les rivières associées avec des limites méthodologiques mises en avant pour son client (notamment la résolution du modèle de simulation à la maille kilométrique qui ne pouvait pas être utilisée pour en déduire quoi que ce soit à des mailles plus fines). On y voyait en plus que les valeurs de seuil limite d’élévation de la nappe – fixés par la coopérative – étaient inférieurs à la moyenne quinquennale sèche (voir la section du dossier sur les débits d’étiage et débits biologiques), mettant en avant que les seuils étaient là pour garantir le remplissage des bassines mais pas de s’assurer que les cours d’eau couleront bien et que les nappes seront bien rechargées.
La coopérative aurait dû s’intéresser à des enjeux complémentaires :
- La prise en compte d’une période climatique récente voire même d’une période dans le futur. L’étude a en effet considéré une période climatique dans le passé entre 2000 et 2010, bien loin des conditions climatiques actuelles. Cette période aurait néanmoins permis d’évaluer ce qui se serait passé si les réserves de substitution avaient été mises en place au cours des années 2000-2011, sachant que ces années sont représentatives de situations météorologiques contrastées (années humides et sèches).
- La prise en compte des coûts financiers et énergétiques du pompage, et les kilomètres de réseaux d’alimentation à mettre en place
- La prise en compte des impacts sur la retenue (évaporation, développement d’algues et de bactéries…)
- La prise en compte de la complexité des cours d’eau (la trop faible résolution spatiale des données ne permettait pas de la considérer). La sinuosité et la multiplicité des cours d’eau est un facteur essentiel à l’infiltration et à la décharge de la nappe
Les méga-bassines pourraient être à l’origine d’une double déconnexion, à la fois spatiale et temporelle. Une déconnexion temporelle parce que les moments de pompage et de remplissage (pluviométrie) ne se succèdent pas nécessairement. Rajoutons à cela les temps de latence parfois très importants qui font que les nappes peuvent ne retrouver leur étiage qu’au bout de plusieurs années. Et une déconnexion spatiale parce que les nappes ne se rechargent pas nécessairement là où il y en a le plus besoin et là où l’eau est justement pompée.
Le modèle d’infrastructure de stockage n’est pourtant pas nouveau et certains pays limitrophes à la France – l’Espagne par exemple – en a déjà fait en parti les frais. Ce modèle ne résiste pas aux périodes de longue sécheresse. Avec plus de 1200 bassines et lacs artificiels, la péninsule ibérique est la championne d’Europe des retenues d’eau et ce modèle, principalement centré sur l’offre s’avère en réalité assez limité. L’Espagne a fondé son développement économique sur l’eau via la mise en oeuvre d’une politique reposant sur la construction de grandes infrastructures (canaux, barrages, …) permettant de mobiliser les ressources en eaux disponibles et de transférer une partie des eaux des bassins atlantiques vers les bassins méditerranéens déficitaires. Selon le Conseil scientifique du comité de bassin Rhône-Méditerranée, un modèle centré sur l’offre est la cause de concurrences territoriales entre agriculteurs traditionnels et nouveaux irrigants, entre activité agricole et usages autres, de défiance entre les régions autour du partage de l’eau ou encore entre autres choses de détérioration dramatique de la qualité de l’eau de rivières
Le plan national français d’adaptation au changement climatique (PNACC2) souligne l’importance de réaliser, là où c’est utile et durable, des projets de stockage hivernal de l’eau, sur la base des meilleures connaissances possibles, en conciliant les activités entre elles et avec la préservation de l’environnement, notamment des écosystèmes aquatiques, en priorité sur les territoires en déséquilibre quantitatif ou susceptibles de l’être dans un futur proche (Action NAT-2).
Les prélèvements hivernaux en nappe supposent que la recharge sur la période sera suffisante, ce qui est quand même relativement difficile à prévoir au vu des effets du changement climatique et notamment de la variabilité interannuelle des précipitations. Un deuxième point d’attention est lié à l’impact des prélèvements hivernaux sur le régime hydrologique et les milieux aquatiques, y compris sur le fonctionnement écologique des estuaires et des écosystèmes littoraux. Quels qu’ils soient et s’ils sont mis en place, les prélèvements doivent être aussi mis en écho avec les pratiques d’irrigation pour s’assurer du maintien des différents débits d’étiage (biologique, écologique etc… – je vous renvoie à la partie du dossier correspondante). Il est notamment important de questionner à quel point des avancements prévus de calendriers d’irrigation pourraient compenser les étiages plus précoces et plus sévères prévus par les hydrologues, du fait du changement climatique, et quelles adaptations des pratiques d’irrigation doivent être mises en place pour amplifier les effets positifs de l’avancement phénologique (dates de semis, choix de variétés plus précoces) et limiter ainsi les prélèvements en période d’étiage
Gardons néanmoins en tête que les retenues peuvent aussi avoir des impacts positifs. Ceux principalement mis en avant tournent autour du développement économique d’une région et d’un impact sur les acteurs économiques des bassins concernés, mais on peut également en trouver en lien avec la biodiversité présente sur place.
Les méga-bassines sont particulièrement clivantes parce que pour beaucoup d’entre nous, telles qu’elles sont proposées, elles ne semblent être à la faveur que d’un nombre restreint d’agriculteurs, souvent représentatifs d’un modèle agricole qui a atteint ses limites. Il reste très compliqué de savoir si les chartes sensées être signées pour faire partie du programme des bassines sont suffisamment ambitieuses et surtout si elles sont soumises à obligation et à un futur audit chez les agriculteurs concernés. Le message principal semble être plutôt au contraire une volonté de sécuriser un accès à un volume d’eau donné – calculé sans conscience des réserves naturelles – au détriment de toute l’agriculture du territoire et de jeunes agriculteurs voulant s’installer sur le territoire. Certains parlent même d’un vol généralisé de nappes.
Les travaux mis en avant prennent souvent un angle hydrologique, centré sur les milieux et l’environnement. Et les critiques sont souvent nombreuses : des impacts dans la retenue (évaporation, piège à sédiments, stockage du phosphore, risques d’eutrophisation, espèces invasives éventuelles), des impacts en aval (modification du régime hydrologique et du transport solide, réduction du débit moyen annuel …) et des impacts écologiques (perturbation de la continuité écologique) en fonction de l’emplacement de la retenue, de ses caractéristiques et de son mode de gestion.
Il est pourtant très important de mettre tout le monde autour de la table, notamment les hydrologues, les hydro-géologues, les agronomes, les climatologues, et les agriculteurs. Un premier élément de lecture est que toutes les régions françaises sont différentes. Il y a par exemple les régions méditerranéennes, structurellement en déficit hydrique annuel, et le sud-ouest de la France, où le déficit annuel n’est pas systématique, et où les scenarios climatiques du Giec ne prévoient pas qu’il le devienne dans un avenir proche. Il peut y avoir un intérêt à utiliser la topographie d’un bassin versant pour récupérer des écoulements là où l’eau manque, à condition de ne pas assécher le cours d’eau principal
Le débat sur les méga-bassines ne peut pas faire le luxe d’occulter la problématique agricole. L’idée ici n’est pas de diaboliser les agriculteurs, surtout que certains agriculteurs dans la région de Sainte Solines ont bien fait d’énormes efforts pour s’orienter vers des pratiques plus résilientes ou pour sortir du modèle agricole dominant même si l’étau est parfois si serré qu’il est presque impossible de s’en séparer.
Le débat ne porte donc pas tant sur l’usage de l’eau, mais sur son mésusage. L’irrigation en soi n’est pas un problème parce que certaines productions (par exemple le maraichage), surtout dans certaines régions françaises, sont tout bonnement impossible sans apporter de l’eau. Au final, les opposants aux retenues contestent l’utilité de dépenses publiques importantes pour mettre en place des infrastructures qui ne bénéficient qu’à quelques agriculteurs utilisateurs de l’eau, ce qui constitue à leurs yeux une atteinte inacceptable au caractère de bien public attribué à l’eau. Mais disqualifier globalement le stockage d’eau ne paraît pas fondé scientifiquement. C’est une analyse au cas par cas, à travers des procédures déjà très exigeantes, qui doit déterminer s’il est possible, territoire par territoire, de créer de nouvelles réserves. Il faut par ailleurs éviter l’effet rebond qui fait que l’accès sécurisé à une ressource en eau accroît l’utilisation d’eau et la dépendance des systèmes.
Le risque ne peut pas porter que sur les agriculteurs
Il est assez facile de l’extérieur de donner des conseils aux agriculteurs sur la meilleure manière de gérer l’eau. C’est pourtant eux qui prennent le risque et qui jouent potentiellement toutes leurs économies avec les décisions qu’ils prennent. La gestion de l’eau a un côté très stressant, c’est une énorme responsabilité pour les agriculteurs – notamment lorsque les salariés et la famille rentrent dans la balance. Les réflexions sur des cultures ou filières plus économes en eau sont plus rares ou parfois très difficiles, faute d’alternative agronomique aux cultures existantes, avec le risque de déprise voire de disparition de l’agriculture du territoire concerné. A coté, les arrêtés sécheresse étant évolutifs, l’exploitant ne sait pas à l’avance s’il ne va pas se retrouver en interdiction d’irriguer.
C’est sur cette notion de partage du risque (de la même manière qu’il y a un partage de la valeur) qu’il faut travailler avec par exemple (CGEDD, CGAAER, 2020) :
- La mobilisation des acteurs économiques des filières pour concevoir et mettre en place des chaines agricoles fondées sur des cultures plus économes en eau. L’exploitant est confronté aux seules filières en place sur son territoire et se retrouve parfois dans un système verrouillé lié à la structuration des systèmes agricoles en place (les contributions volontaires obligatoires – CVO – confortent par exemple le plus souvent les filières existantes). Les filières ne doivent pas abandonner les agriculteurs et porter leur part de risque, en évitant par exemple de délocaliser leurs usines de transformation ou leurs sources d’approvisionnement pour les cultures sous contrat si les limitations en eau en France deviennent plus importantes. Les filières doivent se transformer et se restructurer : modèles économiques, rôle des SIQO, politiques d’investissement des acteurs, relocalisation de certains outils, downsizing des outils industriels…
- La mobilisation de l’aide publique par la généralisation du pilotage de l’irrigation, l’achat de matériel, le déploiement des outils d’optimisation de l’irrigation, ou encore les appels à projets pour de nouvelles filières plus économes en eau (soja, tournesol, légumineuses,)
- La mobilisation du secteur assurantiel avec, par exemple, l’obligation de mettre en place des contrats de conversion climatique pour appuyer la prise de risque de l’agriculteur. Le manque de connaissances sur ces cultures alternatives, mais aussi l’incertitude liée à leur mise en marche contribuent à freiner le changement
- La mobilisation des consommateurs (ou plutôt des consom’acteurs) avec leur capacité à accompagner, voire à susciter cette transformation par le biais de leurs préférences d’achat ou des changements des régimes alimentaires.
Une politique agricole commune (PAC) qui ne favorise pas assez une utilisation plus rationnelle de l’eau
Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la consommation d’eau à des fins agricoles au niveau de l’Union Européenne aurait baissé de 28 % depuis 1990, tandis que l’excédent d’azote et la concentration de nitrates dans les fleuves ont diminué respectivement de 10 % et de 20 % depuis 2000. Toutefois, les nouvelles améliorations enregistrées dans les années 2010 ont été modestes, et les pressions qui continuent d’être exercées sont loin d’être viables.
Les paiements directs de la PAC n’encouragent pas véritablement une utilisation plus rationnelle de l’eau. Actuellement, les paiements au titre du régime de paiement unique à la surface et du régime de paiement de base ont un effet neutre sur l’irrigation : ils n’incitent ni à utiliser l’eau de manière rationnelle, ni à irriguer ou à utiliser davantage d’eau. Les indicateurs de performance de la PAC tendent à s’intéresser par exemple au nombre d’hectares couverts par une gestion environnementale favorable à l’eau plutôt qu’au volume d’eau consommé pour l’irrigation utilisé en agriculture ou au taux de pollution par les nitrates. Les aides de la PAC favorisent le drainage des parcelles plutôt que la rétention d’eau. Les tourbières drainées peuvent ouvrir droit à une aide au revenu au titre de la PAC 2014-2020, tandis que les tourbières humides cultivées sont parfois considérées comme non admissibles lors des inspections.
Ni ces deux régimes de paiements directs ni le régime de paiement vert n’imposent d’obligations aux agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation durable de l’eau. Le régime de paiement vert peut toutefois avoir des effets positifs indirects du fait de l’obligation faite aux agriculteurs de préserver les prairies permanentes (qui, contrairement aux terres arables, ne sont normalement pas irriguées
Le second pilier de la PAC permet de financer des projets et des pratiques destinés à améliorer l’utilisation durable de l’eau au titre des programmes de développement rural. Il finance par exemple des mesures de rétention d’eau, des équipements de traitement des eaux usées et des projets améliorant l’efficacité des systèmes d’irrigation. De tels projets bien menés ont contribué à une meilleure gestion de l’eau au niveau local ou régional et ainsi à une protection de la ressource eau à cet échelon. Toutefois, d’autres types de projets peuvent également être financés par le deuxième pilier de la PAC, alors qu’ils sont susceptibles d’accroître la demande en eau. On peut penser par exemple à l’extension de surfaces irrigables ou de nouveaux projets d’irrigation.
La politique des Etats membres n’est pas toujours alignée sur la politique de l’Union dans le domaine de l’eau. Les systèmes d’autorisation de captage et les mécanismes de tarification de l’eau comportent de nombreuses dérogations quand il en va de l’utilisation de l’eau à des fins agricoles. Rares sont les régimes de la PAC qui subordonnent les paiements au respect d’exigences strictes en matière d’utilisation durable de l’eau. La conditionnalité, mécanisme qui peut entraîner des réductions – généralement faibles – des subventions versées aux agriculteurs en cas de non-respect avéré de certaines exigences, favorise l’utilisation durable de l’eau, mais ne s’applique pas à l’ensemble des aides de la PAC, ni à tous les agriculteurs.
Au total la PAC n’aurait pas conduit à des économies d’eau, ni à améliorer significativement la qualité des eaux de surface. Dans un rapport spécial de 2021, la Cour des Comptes conclut que le financement des projets d’irrigation par l’Union Européenne n’est pas assorti de mesures de sauvegarde suffisantes pour une utilisation durable de l’eau.
La nouvelle PAC 2023-2027 ouvre une opportunité pour avancer sur le sujet de l’eau parce que la mise en oeuvre des plans stratégiques (les PSN – Plans Stratégiques Nationaux) et le déboursement des sommes du budget européen sont conditionnés par le suivi et l’atteinte d’objectifs. Mais le constat de l’Autorité environnementale est celui d’un infléchissement notable des moyens du plan stratégique français sur le sujet par rapport à la précédente période de la PAC. L’Autorité laisse à penser que la trajectoire tracée par le futur PSN ne rejoindra pas d’ici 2030 celle de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), ni celle du plan biodiversité, ni celle de la directive cadre sur l’eau. L’Autorité environnementale note que l’intégration d’un paramètre relié à l’étendue du territoire concerné conduit à lisser le niveau d’enjeu pour certaines problématiques qui pourtant sont particulièrement aiguës localement, notamment pour l’eau. Une application stricte des réglementations nationales et européennes ne semble pas non plus être une solution suffisante pour améliorer la situation (comme par exemple le respect des débits réservés en période d’étiage, ou des objectifs de la directive cadre sur l’eau d’atteinte du bon état des cours d’eau à l’horizon 2027).
Le plan de relance français est doté de 100 milliards d’euros dont 40 sont financés par l’Union Européenne à travers le programme « Next Generation EU ». Malgré tout, 85 % des mesures sont évaluées comme neutres par rapport à la ressource eau, sur base d’une auto-évaluation en forme de simple déclaration affirmative dans le plan, manquant le plus souvent d’éléments plus analytiques justifiant cette position (Institute for European Environmental Policy, 2022). Parmi la douzaine de mesures considérées comme ayant un impact positif pour l’eau, environ la moitié semble évaluées de manière exagérément optimiste. Par exemple, la mesure « budget vert » du volet 3 est considérée comme positive pour l’eau au motif que les dépenses correspondantes sont classées selon six classes environnementales.
Les divers instruments européens susceptibles de préserver l’eau en tant que ressource naturelle et d’en améliorer la gestion sont présents et, en première analyse, globalement suffisants pour progresser. Malgré tout, ces instruments manquent de coordination entre eux, voire risquent certaines contradictions soit par manque de priorisation du sujet eau (dans les plans de relance notamment) soit par empilement de mesures à vocations divergentes (entre le 1er pilier de la PAC et le 2ème par exemple).
Le rapport spécial du CGEDD/CGAEER proposait d’ailleurs, sur le sujet de l’eau de :
- subordonner le soutien aux investissements dans l’irrigation octroyé dans le cadre du développement rural à la mise en oeuvre de politiques favorisant l’utilisation durable de l’eau dans les États membres;
- lier tous les paiements relevant de la PAC en faveur des agriculteurs, y compris ceux effectués via l’organisation commune des marchés, à des exigences environnementales explicites en matière d’utilisation durable de l’eau, grâce notamment à la conditionnalité;
- d’exiger la mise en place de mesures de sauvegarde afin de prévenir l’utilisation non durable de l’eau pour les cultures financées au moyen du soutien couplé facultatif.
Les calendriers du plan de relance et de la PAC ne sont pas non plus très cohérents. D’un côté le dispositif des plans de relance réclamait une action rapide de la part des Etats. De l’autre côté, la PAC était retardée de deux ans afin que les plans stratégiques soient établis par les Etats en tenant compte des objectifs du Green Deal. Ce calendrier empêche toutefois que les investissements relatifs à l’eau contenus dans les plans de relance soient alignés sur les besoins hydrauliques de l’agriculture tel qu’ils découlent des plans stratégiques de la PAC, puisqu’ils ne sont pas encore finalisés
Une actualité politique qui s’intéresse doucement au sujet
Pour certains, la France vit son lot de paradoxes sur la gestion de l’eau. Malgré un pays en soit-disant abondance hydrique, la France est déjà confrontée à une forte insécurité hydrique et promis à un climat devenant espagnol et à des sécheresses des sols extrêmes. La France stocke, irrigue et investit peu dans les infrastructures d’irrigation et elle importe massivement de l’eau virtuelle de pays voisins. Nos voisins planifient et investissent mais surexploitent leurs ressources ce qui pose des questions structurantes quant à notre dépendance alimentaire qui ne risque que de s’accroitre. Si les pays qui nous alimentent en eau virtuelle viennent eux aussi à manquer d’eau, c’est globalement le début de la catastrophe.
En mai 2021, le gouvernement a fait grand bruit en lançant le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, qui a fait suite aux Assises de l’eau de 2019. Ces évènements ont notamment permis de définir une série d’actions dont la mise en place d’une gestion collective et de règles de partage de l’eau, avec pour objectif de réduire les prélèvements liés à tous les usages (domestiques, industriels et agricoles) de 10 % d’ici 2025 et de 25 % d’ici 2035. En début 2023, le gouvernement lance un Plan National Eau suite aux crises et sécheresses profondes des années passées. Ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de mesures qui sont proposées, certaines directement liées au secteur agricole (voir ci-dessous). On reste néanmoins surpris en voyant que les objectifs de réduction de prélèvements ont déjà été repoussés depuis les Assises de l’Eau puisque le Plan National Eau de 2023 ne fait état que d’une réduction de 10% des prélèvements à horizon 2030 contre les quasi 25% annoncés aux dernières Assises de l’eau. Cet objectif reste certes ambitieux mais il traduit potentiellement une volonté de ne pas aller trop vite non plus…
Quelques grands éléments du Plan Eau directement liés au secteur agricole :
- Sobriété d’usages pour tous les secteurs (avec un objectif de réduction de 10% des prélèvements d’ici 2030) avec une meilleure planification territoriale et une meilleure mesure de l’état des ressources
- Pour les agriculteurs : 30 M€ supplémentaires par an seront consacrés au soutien des pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au gouttes à gouttes, etc.).
- L’installation de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés sera rendue obligatoire pour tous les prélèvements importants (correspondant aux seuils d’autorisation environnementale).
- Optimiser la disponibilité de la ressource en réduisant les fuites (jouer sur la demande), en valorisant l’utilisation d’eau non conventionnelles (jouer sur l’offre) et améliorer le stockage dans les sols, ouvrages et nappes (jouer sur l’offre).
- La préservation des zones humides sera renforcée avec 50 M€/an supplémentaires de paiements pour services écosystémiques et le Conservatoire du littoral consolidera sa stratégie d’acquisition foncière.
- Un fonds d’investissement hydraulique agricole sera abondé à hauteur de 30M€/ an pour remobiliser et moderniser les ouvrages existants (curages de retenues, entretien de canaux…) et développer de nouveaux projets dans le respect des équilibres des usages et des écosystèmes.
- Préserver la qualité de l’eau et restaurer des écosystèmes sains et fonctionnels en prévenant les pollutions des milieux et en développant les solutions fondées sur la nature pour restaurer les cycles de l’eau.
- Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture bio seront revalorisées sur les aires alimentation de captage à hauteur de 50M€/an. Les expérimentations de paiements pour services environnementaux (PSE) seront conservés jusqu’à la prochaine PAC à hauteur de 30M€/an
- En phase d’installation de nouveaux agriculteurs sur des aires d’alimentation de captage, les projets s’inscrivant dans une démarche agro-écologique, d’agriculture biologique seront favorisés. Cette ambition sera portée dans le cadre de la concertation du Pacte et de la Loi d’orientation et d’avenir agricoles.
- Mettre en place les outils de régulation et de concertation pour améliorer la gestion de l’eau en retravaillant sur la gouvernance de la gestion de l’eau, en investissant dans la recherche et l’innovation, et en utilisant des instruments économiques (tarification de l’eau, financement de la gestion de ressource en eau).
Le gouvernement planche actuellement sur un pacte loi d’orientation agricole (LOA) dont on peut espérer que les questions d’adaptation au changement climatique et que les questions liées à l’eau seront centrales – aucun document national agricole ne considérant pour l’instant suffisamment ces questions. Certains documents de planification ou de programmation nationale et régionale du domaine agricole intègrent toutefois la prise en compte du changement climatique. Il s’agit principalement des programmes de développement rural régionaux (PDRR) et des programmes national et régional de développement agricole et rural (PNDAR et PRDAR).
Citons pour finir le PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) « One Water » lancé en 2022 par le gouvernement pour penser la gestion de l’eau dans un contexte de changement global où les pressions sur l’eau vont grandissantes.
Tout le monde doit se former – continuer à alerter
L’ensemble des acteurs du territoire doivent recevoir un minimum de culture hydrologique pour comprendre les grands principes à l’œuvre. Il nous faut assumer que nous n’avons pas compris les cycles de l’eau. Pour certains auteurs, le fait que les activités humaines ne soient pas mises en avant lorsque les cycles de l’eau sont présentés n’a pas pour objectif une volonté de simplification de ces cycles pour le grand public (Abott et al., 2019). Ce serait au contraire une omission qui rendrait le cycle hydrologique incompréhensible à l’ère de l’anthropocène. Il n’est en effet plus possible de comprendre la distribution spatio-temporelle de la quantité et de la qualité de l’eau sur Terre sans tenir compte de l’activité humaine. Les altérations humaines de l’eau, de la terre et du climat ont tellement modifié le cycle de l’eau que les simulations de modèles basées uniquement sur la dynamique naturelle de l’eau (sans intervention humaine) ne permettent plus de prédire de manière fiable le niveau des eaux souterraines, les sécheresses, les inondations ou les précipitations. Les messages importants doivent également s’axer autour de la quantité d’eau disponible, ou plutôt de la faible quantité d’eau réellement utilisable pour les humains et les écosystèmes au regard de la totalité de l’eau disponible sur le globe (voir section sur les ordres de grandeur en début de dossier).
Le grand public est déjà relativement peu informé des enjeux relatifs à l’eau et des politiques menées. La mise en œuvre effective de la politique de gestion de l’eau suppose l’adhésion de la population mais l’information diffusée est généralement très, voire trop, technique. L’échelle territoriale de la gestion de l’eau ne correspond pas non plus au bassin de vie du grand public qui, de fait, se mobilise peu dans les débats publics et les concertations sur ces sujets (même si les manifestations à Saintes Solines ont relancé les débats sur l’eau).
La politique de l’eau est méconnue, et on peut le comprendre au vu de la complexité de l’organisation des acteurs sur le territoire (Fig 39). Les instances et outils de gestion de l’eau (Agence de l’eau, Comité de bassin, Commission locale de l’eau, SDAGE, SAGE, Commissions consultatives des services publics locaux, PTGE…) sont généralement peu connus et jugés particulièrement confus. L’échelle du grand bassin hydrographique, donc des SAGE/SDAGE, n’a pas de réalité pour la population.
Les agriculteurs, eux aussi, ont bien évidemment faire évoluer leurs compétences à la matière et l’on pourrait imaginer que les agriculteurs, sur un modèle proche de la certification Certiphyto du plan EcoPhyto, puisse accéder à une certification du type Certirrig pour attester d’un niveau de formation et de connaissance assurant une utilisation des équipements et de pratiques économes en eau. Est-ce qu’un agriculteur mieux informé fait plus attention ? On pourrait être tenté de croire que oui au moins dans les territoires où il y a des manques d’eau. La sensibilisation n’est bien évidemment pas une condition suffisante pour un passage à l’action, mais elle en est un pré-requis absolu. Certains agriculteurs sont aussi très démunis et embarqués dans un système qui les dépasse. La diffusion de la connaissance et l’installation massive des réseaux de ferme pilote expérimentaux/démonstratrices est importante. Les agriculteurs sont profondément ancrés dans la réalité de la campagne culturale en cours (météo de l’année), avec une vision restreinte bien souvent aux deux à trois dernières campagnes culturales. Ainsi, il est souvent utile de rappeler les évènements climatiques passés en termes de chronologie et de magnitude sur une période de plusieurs dizaines d’années. La notion d’adaptation, au cœur des grands enjeux du moment, doit être largement vulgarisée et explicitée.
La valeur et la notion même d’existence des ressources est à questionner. C’est un véritable contrat social à réinventer
En guise de conclusion
La proposition numérique est assez foisonnante sur la thématique de l’eau en agriculture. Entre les outils de mesure et d’observation de l’eau dans les différents compartiments plante-sol-atmosphère, les outils de modélisation et d’aide à la décision sur le pilotage de l’irrigation, ou encore les infrastructures pour mettre à disposition la donnée à destination des usagers ou des décideurs, on peut penser que les technologies numériques sont une des cordes à notre arc pour penser une gestion multi-usage dynamique d’une ressource en eau pour lesquelles les pressions ne vont que s’intensifier.
Les surfaces irriguées ne représentent encore une fois que 7% de la surface agricole utile française en 2020. Et l’irrigation reste encore le prisme d’attaque principal des technologies numériques agricoles. Les outils actuels sont encore calés sur l’agriculture que nous connaissons, et se pose alors la question d’un potentiel pilotage de l’irrigation dans des systèmes agricoles qui évoluent avec des dynamiques de l’eau différentes. Pour éviter cette focalisation sur l’irrigation, il nous faut inverser les priorités, c’est-à dire commencer par adapter l’agriculture pluviale au déréglement climatique en cours et ne considérer l’irrigation qu’en dernier recours. Le progrès de l’agriculture pluviale sera certainement encore plus décisif que celui des cultures irriguées.
Les outils numériques, en tant que fournisseurs de données potentiellement objectives, peuvent assurer le rôle de juge de paix et participer à une réflexion collégiale concertée. Malgré tout, à vouloir toujours tout compter et mesurer, on peut se retrouver à masquer les intentions réelles d’un suivi et d’un pilotage fin de la ressource en eau. La mesure et la quantification d’une ressource toujours plus limitée est bien évidemment louable mais elle doit se faire au service d’une transition vers une politique responsable de l’eau, centrée sur la demande, et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Dans leur rapport « Changement climatique, Eau, Agriculture » de 2020, les conseils généraux de l’agriculture et de l’environnement appellent à considérer l’eau dans une logique pluri-annuelle, à territorialiser la problématique agricole en la rendant cohérente avec les enjeux locaux (et donc les documents d’aménagement du territoire), et à retravailler la gouvernance de l’eau avec des instances de décisions bien articulées.
Le modèle historique de gestion de l’eau est encore un modèle de gestion illimitée, centré sur une stratégie de l’offre avec la volonté de pourvoir l’eau aux usagers tant qu’ils en ont besoin. Une politique basée sur la demande doit prendre le relai et il semble que l’agriculture n’y soit pas encore préparée. Les enjeux économiques sont importants et les transitions peuvent être particulièrement lourdes. Il y a pourtant d’autres manières de penser l’eau, sa gestion, son partage et sa gouvernance. Nous devons sortir d’une logique simple d’efficience de l’eau en agriculture pour revisiter des concepts plus larges de gestion renforcée de la ressource en eau.
Finalement, nous devons accepter le fait que ne sommes encore que très peu acculturés au sujet de l’eau et à sa complexité. Nous méconnaissons les cycles de l’eau et l’intrication forte de l’humain dans ces cycles. Nous manquons encore de connaissances sur l’écophysiologie des plantes et la manière dont la plante régule ses flux d’eau. Et bien que la gestion de l’eau doive être aussi pensée à une échelle locale et opérationnelle, nous ne devons pas oublier que les enjeux de l’eau dépassent très largement nos frontières. Des nouveaux concepts comme ceux des bassins atmosphériques sont là pour nous le rappeler.
Bibliographie complémentaire aux entretiens
Abbott, B., et al. (2019). A water cycle for the Anthropocene. Hydrological Processes, 33, 3046-3052
Abbott, B., et al. (201). Human domination of the global water cycle absent from depictions and perceptions. Nature Geosciences, 12
Abiodum Abioye, E., et al. (2020). A review on monitoring and advanced control strategies for precision irrigation. Computers and Electronics in Agriculture, 173
ADEME (2010). Climator. Changement climatique, agriculture et forêt en France : simulations d’impacts sur les principales espèces.
Ademe (2020). Life AgriAdapt. Adaptation de l’agriculture au changement climatique. Caractériser la vulnérabilité au changement cliimatique d’exploitations agricoles afin d’identifier des actions d’adaptation durables. Rapport – 44p.
Ademe (2022). Transitions 2050. Adaptation au changement climatique : transports, agriculture, forêts, industries, bâtiments. Rapport – 4pages.
Agence de l’eau Loire-Bretagne (2022). Analyses Hydrologie – Milieux – Usage – Climat (HMUC). Guide et recommandations méthodologiques. Rapport -64p
Agence de l’eau Rhône Méditérrannée Corse (2022). L’utilité sociale et territoriale. Une opportunité pour les projets du grand cycle de l’eau. Rapport – 20p
Ahmad, U., et al. (2021). A Review of Crop Water Stress Assessment Using Remote Sensing. Remote Sensing, 13
Association nationale des élus de bassins -ANEB (2022). Le livre bleu – l’eau en commun, 60 p.
Autorité Environnementale (2021). Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027
Berger, M., & Finkbeiner, M. (2012). Methodological Challenges in Volumetric and Impact-Oriented Water Footprints. Journal of Industrial Ecology
Berger, M., Pfister, S., Motoshita, M. (2016). Water Footprinting in Life Cycle Assessment – How to Count the Drops and Assess the Impacts? Chapitre 3 – LCA Compendium – The Complete World of Life Cycle Assessment
BRGM (2022). Simulation du projet 2021 de réserves de substituion de la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres. Rapport final – 143p
CGAAEER (2022). Parangonnage sur les techniques et pratiques innovantes de gestion de l’eau en agriculture. Rapport – 90p
CGEDD, CGAAER (2020). Changement climatique, eau, agriculture : Quelles trajectoires d’ici 2050 ? Rapport – 333 p.
CNDP (2022). La participation sur l’eau : Bilan de 25 ans de débats publics et concertations. Rapport – 6p.
Collard, A-L., et al. (2019). Un compteur « intelligent » pour mesurer les usages de l’eau : l’entrée en scène d’une nouvelle connaissance. Développement durable et territoires, vol 10.
Comité 21 (2022). Guide sectoriel de l’adaptation aux changements climatiques
Cour des Comptes Européenne (2022). La PAC et l’utilisation durable de l’eau dans l’agriculture: des fonds davantage susceptibles d’encourager à consommer plus qu’à consommer mieux. Rapport spécial – 63 p.
Cour des comptes (2023). Rapport Public Annuel. La décentralisation, 40 ans après.
De Ponti, T., et al. (2012). The crop yield gap between organic and conventional agriculture. Agricultural Ecosystems, 108, 1-9
Ezenne, G.I. et al. (2019). Current and potential capabilities of UAS for crop water productivity in precision agriculture. Agricultural Water Management, 218, 158-164
FAO (2015). Yield gap analysis of field crops : Methods and case studies. FAO Water Reports. 41
FNCCR (2022). Encourager les économies d’eau. Apport des sciences comportementales. Les fiches recommandations du club des économies d’eau
France Stratégie (2023). Coût de l’inaction face au changement climatique en France : que sait-on ? Document de travail
Galabert (2022). Comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l’eau pour restaurer la fécondité des sols et prendre soin du climat, Documentation ISI — Initiatives et Solutions Interculturelles, Version 2
Gong, X.Y., et al. (2010). Tradeoffs between nitrogen- and wate-use efficiency in dominant species of the semiarid steppe of Inner Mongolia. Plant Soil
Inrae (2022). Société – L’agriculture va-t-elle manquer d’eau. Ressources. N°2
Institute for European Environmental Policy (2022). La gestion de l’eau en agriculture. Que prévoient les plans de relance européens ? Rapport – 42 p
IPCC (2022). AR6 Climate Change : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 13
Loubier et al., (2013). L’irrigation diminue-t-elle en France ? Premiers enseignements du recensement agricole de 2010. Sciences Eaux et Territoires.
Marechal, J-C., & Rouillard, J. (2020). Groundwater in France: resources, use and management issues. Sustainable Groundwater Management. Chapter 2
Mounier, B. and Uso, T. (2022). La financiarisation de l’eau, menace fantasmée ou réelle ? Attac, 33
Hatfield, J.L., & Dold, C. (2019). Water-Use Efficiency: Advances and Challenges in a Changing Climate. Frontiers in Plant Science, 103
Petit, O. (2004). La nouvelle économie des ressources et les marchés de l’eau : une perspective idéologique ? VertigO – La revue en sciences de l’environnement, vol 5
Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du bassin Adour Garonne (2023). Améliorer l’efficience de l’eau d’irrigation grâce au pilotage.
Reghezza, M. and Habets, F. (2022). Les mega-bassines sont-elles des solutions viables face aux sécheresses ? Bon Pote
Rockstrom, J., et al. (2023). Why we need a new economics of water as a common good. Nature
Schneider, L. et al. (2021). Partager l’eau d’irrigation dans les bassins versants : usages et intérêts des quotas. 15èmes Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS).
Sénat (2022). Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l’avenir de l’eau. Rapport – 166 p
Serra-Wittling, C., & Molle, B. (2017). Evaluation des économies d’eau à la parcelle réalisables par la modernisation des systèmes d’irrigation. Rapport – 150p.
Serra-Wittling, C., & Ruelle, P. (2022). Guide pratique de l’irrigation – 4ème édition. Editions Quae
Van Ittersum, M.K., et al. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance – A review. Field Crops Research, 143, 4-17.
Yao et al. (2023). Satellites reveal widespread decline in global lake water storage. Science. Global Hydrology, vol 380
World Meteorological Organization (2022). State of Global Water Ressources 2021. N° 1308.
Séminaires & Vidéos
2021 – Séminaire AgroTIC – Le numérique au service des intrants ?
2022 – Séminaire AgroTIC – Gestion de l’eau en agriculture : quel rôle le numérique peut-il jouer ?
2022 – Crise de l’eau, planète terre invivable ? Interview d’Emma Haziza sur Thinkerview
Personnes Interviewées
| Nom | Structure |
| Maïder ARREGUI | BRL exploitation |
| Nicolas BAGHDADI | INRAE |
| Gilles BELAUD | UMR G-Eau |
| François BRUN | ACTA |
| Denis BOISGONTIER | Cap 2020 |
| Anne-Laure COLLARD | UMR G-Eau |
| Rémi DECLERCQ | Ecofilae |
| Valérie DEMAREZ | CESBIO |
| Sophie GENDRE | Arvalis |
| Jean-Christophe MARECHAL | UMR G-Eau |
| Bruno MOLLE | UMR G-Eau |
| Julien LECONTE | Chaire EAU |
| Marine LEMOIGNE & Marjorie DABRIN | Vegetal Signals |
| Sébastien LOUBIER | UMR G-Eau |
| Charlotte PRADINAUD | Chaire ELSA |
| Alice RACTMADOUX | SCP |
| Dominique ROLLIN | Ex-CGEDD |
| Thibaut SCHOLASCH | Fruition Sciences |
| Vincent SIMONNEAUX | CESBIO |
| Dominique THERIEZ | Aquasys |
| Arnault TRAC | Hydroclimat |
| Benoit WIBAUX & Marion VIGUIER | Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du bassin Adour Garonne |
| Serge ZAKA | ITK |

1 commentaire sur « Gestion de l’eau et technologies numériques en agriculture »